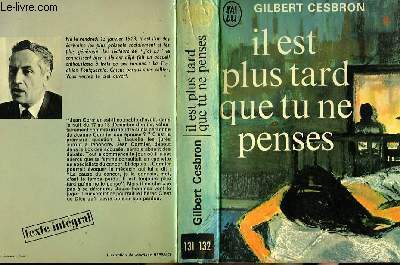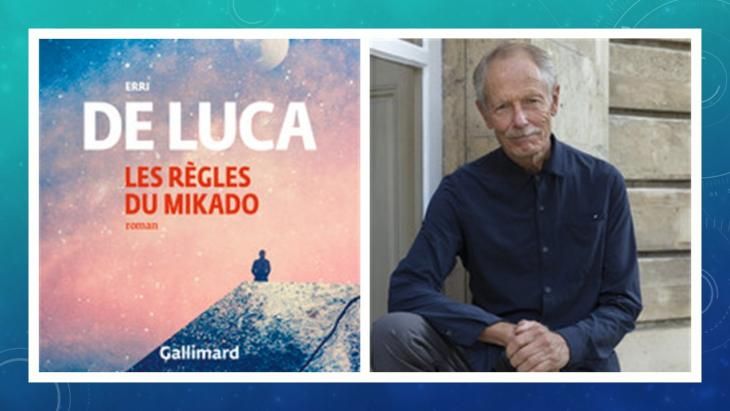Je poursuis ici ma lecture critique de l’intégralité de l’œuvre romanesque de l’écrivain Gilbert Cesbron (1913-1969), auteur prolifique et très connu des années 1950 à sa mort, qui a produit une petite vingtaine de romans et des recueils de nouvelles[1]. Ce roman est le dixième de sa production, publié par Robert Laffont en 1958. C’est donc l’œuvre d’un écrivain confirmé, qui maîtrise bien son métier. Il s’est d‘ailleurs vendu à plus de 1 million d’exemplaires, comme cinq autres de ses livres. Il s’agit donc d’un écrivain populaire, dont les ouvrages ont été largement repris en collection de poche. Rappelons, pour les lecteurs qui n’ont pas lu mes précédents articles, que Cesbron est un romancier catholique qui s’est d’ailleurs exprimé sur sa foi dans un Ce que je crois, collection des années 1970.
Ce roman au titre ambigu pourrait être une « romance » avant l’heure. Pourquoi est-il trop tard ? C’est ce que nous allons découvrir au fil de la lecture. Mais les premières pages semblent dessiner une histoire d’amour, entre un homme et une femme qui portent le même prénom, Jean et Jeanne. Et cette piste n’est pas fausse, elle est même essentielle à toute la dramaturgie de l’histoire. Cependant, dès la deuxième page, une lézarde se fait jour dans la romance : la jeune femme souffre « depuis des mois, depuis que ce mal singulier lui endossait à l’improviste un harnais de douleur » (p. 16[2]). L’histoire d’amour, bien réelle, est parasitée par une douleur récurrente au côté que Jeanne garde pour elle. Son silence est dû à la fois à la peur sourde d’une maladie grave et à la région concernée, ses seins. L’auteur nous fait comprendre, par petites touches, que Jeanne a une fort belle poitrine et que Jean en est très épris. Se joue donc ici, dès le début, une histoire d’érotisme et de peur.
Nous sommes en 1958, le roman est contemporain de son édition. C’est la modernisation de la France d’après-guerre, au-delà de la reconstruction. La prospérité est au rendez-vous, même si certains en profitent plus que d’autres. Jean appartient à ceux qui en profitent. Il n’a aucun souci matériel, il gagne très bien sa vie en travaillant dans une grande agence de publicité. Ce temps est en effet favorable à cette activité, puisque ce sont les prémices de la société de consommation et que l’image et le message publicitaire envahissent les murs et les ondes des radios nouvelles, dites périphériques[3]. Nous reconnaîtrons, au passage, tous les signes extérieurs de richesse des gagnants de cette période (résidence secondaire, belle voiture, appartement parisien moderne…). Jeanne n’a pas d’activité professionnelle, ils ont largement assez de ressources pour lui éviter cela. Elle passe donc ses journées à attendre le retour de l’être aimé dans son bel appartement. Ils ont quarante ans tous les deux, ils sont mariés et s’aiment comme des fous depuis dix ans.
C’est, presque, une sorte de chromo caricatural de la société française parisienne à l’arrivée du Général de Gaulle au pouvoir. Jean a sans doute inconsciemment construit sa vie comme une publicité pour le bonheur conjugal. De fait, Cesbron a soigneusement évité toute allusion au contexte politique ou social de cette époque. Le lecteur étranger ne saura pas qu’il y a une guerre en Algérie, qu’on n’ose pas nommer et qui est euphémisée par l’expression « événements d’Algérie[4] ». Il ignorera la grave crise du logement qui a créé le mouvement Emmaüs en 1954, comme il ne saura rien des conditions de vie du peuple français. C’est évidemment un choix d’auteur, car on ne saurait reprocher à Gilbert Cesbron de se désintéresser du fait social et humain, c’est même la pâte dont sont pétris la plupart de ses grands livres. Il voulait que rien ne vienne faire écran ou diversion à son sujet. Il fallait donc que les rares personnages du livre soient comme isolés dans une bulle. Il a parfaitement réussi : on ne vit que pour les trois personnages principaux, et surtout pour le couple Jeanne-Jean. Les autres figures sont soit secondaires, soit très fugitives et destinées à souligner le propos central. Presque tout le livre se passe entre deux personnages, variables selon les chapitres.
Ce n’est pas une fresque humaine, mais bien plutôt un drame qui pourrait assez aisément être transformé en pièce de théâtre. La distribution serait courte : Jean et Jean sont les personnages centraux, Bruno est le troisième de ces personnages, c’est le frère de Jeanne et c’est un jeune prêtre, affecté dans une banlieue pauvre (c’est d’ailleurs à son propos que seront données les seules mentions du peuple, et de manière très rapide). Ensuite quelques personnages secondaires : Maria, la vieille nourrice devenue la bonne du couple, Bernard, l’ami d’enfance de Jean et un médecin parisien, le docteur Louville. Les autres ne sont que des ombres. Ah ! j’allais oublier un personnage capital et muet, le petit Yves-Marie, appelé Yves le plus souvent.
Car le vrai personnage central est celui que l’on n’ose pas nommer, pour lequel on use, encore de nos jours, des périphrases qui ne trompent plus personne, comme « longue maladie », maladie incurable », « mal insidieux », etc. Vous avez reconnu le cancer. La douleur sourde et soudaine de Jeanne, c’est lui ! Le « plus tard que tu en penses », c’est lui aussi[5]. Lui partout présent, dans ce livre, à chaque page, même quand il n’est pas évoqué. Ce livre est un livre sur le cancer et sur ce qu’il peut entrainer comme conséquences tragiques. Vous avez bien compris que ce n’est pas un livre drôle et que, pour le lire, il faut accepter la dureté de la vie.
Je ne raconterai évidemment pas l’intrigue détaillée, ce serait vous priver de la belle lecture de ce roman. Disons, pour la compréhension de cet article, les choses suivantes. Jeanne découvre qu’elle a un cancer du sein, le cache à son mari, qui le découvre assez fortuitement et, à son tour ne le lui dit pas. Mais vient un moment où la vérité éclate : opération, rémission, rechute, et très lente agonie, puis mort de Jeanne. À ce moment, nous sommes au milieu du roman et nous comprenons alors que l’auteur avait un projet plus vaste que celui de la description des ravages de cette maladie.
C’est au moment de la mort de Jeanne que tout bascule. Jean lui injecte une surdose massive de morphine, à sa demande, et elle meurt calmement très vite. Aux yeux de la loi française (encore aujourd’hui), Jean a tué Jeanne. Et ici commence donc un second livre, celui de jean face à son geste et à la justice. Passons sur les péripéties qui l’amènent au tribunal (mais elles sont passionnantes au plan moral et Cesbron est maître en ce domaine). Le morceau de roi de cette deuxième partie du roman est le procès, pour lequel l’auteur se mue en chroniqueur judiciaire attentif. Il nous rapporte, entrecoupés de remarques d’observation ou de commentaires, les discours des protagonistes du procès, surtout le procureur et l’avocat de la défense. Le lecteur ne s’y trompe pas : le second nœud central est bien la question de l’euthanasie, posée à partir d’un cas précis dont l’écrivain nous a livré tous les détails.
Si l’on s’en tient aux clichés qui s’attachent au terme romancier catholique, on aurait pu craindre le pire de cette partie. Or, n’oublions pas que ce sont des « clichés », des caricatures qui ne sauraient représenter l’ensemble des fidèles de Rome. Ne vous attendez pas à trouver dans ces pages l’artillerie lourde contre l’aide à mourir. Le procès est fait en termes juridiques, pas moraux, comme il se doit, ou se devrait. D’ailleurs, Jean est acquitté et ressort libre et innocenté officiellement de ce crime par les jurés. L’affaire est donc légalement close.
L’auteur peut alors commencer sa troisième et dernière partie : celle du chemin moral et spirituel de Jean. C’est là que le romancier catholique refait surface. Il va offrir à Jean une issue à sa crise morale. Car l’acquittement juridique est un fait bien réel : Jean est innocent de tout meurtre sur son épouse Jeanne, mais l’acquittement personnel qu’il peut ou ne pas se donner à lui-même est une autre chose. À l’issue du procès, Jean va rester hanté par une question : ce qu’il a pris pour la demande de Jeanne d’en finir était-ce bien cet appel, ou n’était-ce pas plutôt son désir de mettre un terme à sa propre souffrance de voir l’être aimé souffrir et se transformer en spectre ?
Cesbron fait alors revenir en scène Bruno, le petit frère, jusqu’alors mis un peu en retrait. Jean a toujours considéré Bruno comme une énigme, pour le moins un cas spécial d’inadapté au monde moderne. Il le traitait avec une certaine condescendance, celle des gens qui gagnent de l’argent. Voici que les rôles changent : Bruno devient celui qui a les cartes en main, qui a certaines réponses que Jean ne possède pas. La scène centrale est un beau morceau de littérature, celle où Jean rend visite à Bruno et vient, au bout du rouleau, chercher de l’aide. Il est, pour la première fois, en position de demandeur, il a perdu de sa superbe, c’est un homme brisé. Bruno ne va pas chercher à le rassurer à bon compte, mais lui tenir un langage de vérité sur son geste et sur ce qu’il croit être après la mort. Nous sommes là dans des pages qui font irrémédiablement penser à Georges Bernanos dans ses grands romans spirituels. C’est le combat de la raison raisonnante et de la conscience. Cesbron en donne une issue positive ; Jean s’ouvre à la douleur d’autrui et devient auxiliaire d’hôpital, dans les services de cancérologie terminale. Le mur du néant est tombé, la vie trouve un sens, même dans la mort, et la mort douloureuse.
On pourra ironiser sur cette fin, reprocher à Cesbron cette échappatoire. Mais il n’est ni Albert Camus ni Jean-Paul Sartre, il ne croit pas que le monde et la vie sont absurdes et qu’il faut s’en accommoder ou mourir. Il prend position dans cette délicate question de la vie et de la mort. Et il le fait avec beaucoup de tact et de prudence. Il n’y a jamais, à aucun moment, un jugement ex abrupto du geste de Jean. Tout est dit dans le débat intérieur du personnage et je trouve que c’est superbement dit. La foi retrouvée est une des issues possibles. À travers le personnage de Bruno, le prêtre, Gilbert Cesbron nous montre bien que le doute est toujours là, que seuls les intégristes abrutis peuvent prétendre l’ignorer. On pourra apprécier son livre même si l’on ne croit en rien, car il sera alors un combat moral, et nul n’échappe à ce type de combat intérieur, quoiqu’il en dise.
Il me faut dire un mot sur le petit enfant, Yves, que j’ai cité dans les personnages secondaires. Cet enfant est présent tout au long du livre, mais comme une ombre. Il est celui que le couple aurait pu adopter et qu’ils ont choisi de laisser à l’orphelinat pour vivre plus égoïstement leur amour fusionnel. Et quand l’enfant fait retour, c’est dans un tout autre contexte que je vous laisse découvrir. Je trouve qu’il y a là une belle invention d’écrivain-moraliste. C’est pour des raisons comme celles-ci que j’aime cet auteur, en sus de ces qualités littéraires et dramaturgiques.
Ce livre n’est, bien sûr, plus édité, mais il est partout disponible en occasion chez les bouquinistes à des prix dérisoires. Il vaut bien plus que ces tarifs modestes. Il faut le lire et le méditer, en ces jours où la loi met en place une « aide à mourir » que le Président de notre République à la dérive appelle un geste fraternel. Le propos de Gilbert Cesbron n’a pas pris une seule ride.
Jean-Michel Dauriac – Beychac – Août 2025
[1] Voir l’article de Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Cesbron qui présente la liste de ses œuvres, classées par ordre chronologique.
[2] Toutes les références sont issues de l’édition Rencontre des œuvres romanesques de Gilbert Cesbron, volume VIII.
[3] « Une radio périphérique est une station de radio reçue en France entre les années 1930 et les années 1980, dont l’émetteur ne se situe pas sur le sol français. On peut citer, parmi les plus connues, Europe 1, RTL, RMC, respectivement basées en Allemagne de l’Ouest, au Luxembourg et à Monaco ainsi que Radio Andorre ou encore Sud Radio. » source : wikipédia.
[4] Sans établir aucun lien politique entre les deux cas, rappelons que Vladimir Poutine et la Russie ne livrent pas une guerre en Ukraine (en 2025) mais s’y livrent à « une opération spéciale », selon le lexique officiel du Kremlin.
[5] La phrase fait directement allusion au retard mis par Jeanne et Jean à identifier ce cancer et donc, à le laisser proliférer au-delà de la limite où on peut le circonscrire, avec les moyens de l’époque.
Leave a Comment