Folio- Gallimard – 2001
Avec ce roman, publié en 2001, Erri De Luca poursuit sa double entreprise romanesque et autobiographique. Ce roman se distingue des précédents en ce qu’il utilise les codes du roman contemporain de manière plus large. L’auteur a pu ou voulu dissimuler les petits cailloux de sa propre histoire au milieu de la vie de personnages romanesques, qu’ils soient totalement inventés ou inspirés de personnes réelles.
Montedidio, c’est d’abord un lieu : le Mont de Dieu, littéralement. Soit une colline de Naples occupée par un quartier populaire et, plus spécifiquement une rue, sans doute montante, puisque par elle on accède aux terrasses qui dominent la ville, sur la hauteur. Chez De Luca « populaire » n’est pas un terme péjoratif, comme chez beaucoup d’écrivains français du XXe siècle. « Populaire » ne veut nullement dire « misérable », mais plutôt « pauvre ». La misère est absolue, elle est manque du nécessaire vital, la pauvreté est relative, elle nait de la comparaison avec les gens plus aisés. Bien sûr, dans certaines circonstances, il est assez facile et rapide de glisser de la pauvreté à la misère : une maladie, un accident du travail, une famille qui éclate… La rue de ce roman est plutôt une rue de gens pauvres, de classes laborieuses qui vivent chichement. Ce qui n’empêche nullement de connaître la joie et le bonheur, contrairement à ce que pensent les bourgeois qui associent argent et état heureux. Il y a de vrais moments de bonheur à Montedidio et De Luca nous les fait partager. Ils ne sont pas spectaculaires, ce sont des petits bonheurs, mais tout bonheur n’est-il pas petit par nature en ce qu’il est fugace et instable. Associé à Montedidio, il est un autre lieu, qui joue un rôle important, c’est le port et ses quais. Ces deux lieux sont reliés entre eux par la rue et les activités des personnages. Le reste de la ville n’existe pas. Ou alors seulement comme superstructure métaphysique. De Luca ne fait pas d’esthétisme descriptif. Il est difficile au lecteur d’avoir une idée de la beauté ou de la laideur des lieux, cela n’a d’ailleurs aucun intérêt. Ce sont les lieux de vie des acteurs du récit et, comme souvent avec les lieux de l’habitude, ils ne sont plus vus ou dépourvus de toute valeur esthétique. Un quartier populaire ne brille pas par l’architecture et l’aménagement. Il est « vécu », diraient les géographes bien plus qu’il n’est regardé. Qui vit donc dans cette rue ?
Une population nombreuse, avec beaucoup d’enfants et de jeunes. On est juste après « l’année zéro » de la fin du second conflit mondial, les Américains sont encore là, le souvenir de la guerre est très présent, mais il ne joue aucun rôle actif dans cette histoire. Tout au plus sent-on qu’il n’est pas facile pour une famille de se nourrir, car il y a encore des pénuries. Mais l’auteur ne joue pas sur la corde du misérabilisme, c’est estimable. Ceux qui ont connu la pauvreté savent bien qu’elle peut être vécue parfois plus sereinement que l’aisance. Dans ce cadre modeste, De Luca fait vivre devant nous une collection de personnages attachants. Il a su en choisir une palette variée et ne pas en mettre un trop en avant, même si, par le choix de la narration à la première personne, il y a une prééminence du conteur.
Erri De Lucca à son bureau
Ce narrateur est un enfant de treize ans, au tournant de l’adolescence, que nous allons voir, au fil du livre, devenir adulte précocement. Quand débute le récit, il vient d‘être placé en apprentissage chez un menuisier de la rue. L’atelier sera un des endroits d’importance dans l’histoire. Vers la fin du livre, il nous dit :
« Au printemps, j’étais encore un enfant et maintenant le suis en plein dans les choses sérieuses que je ne comprends même pas. Il a raison, don Ciccio, chez nous on doit grandir au pas de course et moi j’obéis, je cours. » p. 386.
Les « choses sérieuses » sont ce qui le fait devenir adulte, sans doute trop vite à son gré. Il va en effet traverser des moments de vie difficiles et certains autres heureux ; il ne sera plus jamais un enfant après ça. Nous ne connaîtrons jamais le prénom du narrateur. Il a un père et une mère, ils vivent à trois dans un modeste intérieur qui est tenu très propre, justement pour garder la dignité humaine malgré la pauvreté. Nous ne connaîtrons pas plus les noms ou prénoms du père et de la mère : ils sont d’abord dans leurs rôles, ils sont le père et la mère du personnage principal. Le père est docker au port et travaille dur pour faire vivre sa famille. La mère reste au foyer et s’occupe des travaux domestiques. On comprend assez vite qu’elle est fragile, sans doute dépressive et de santé fragile. Elle quittera la scène assez vite, étant hospitalisée, pour une tuberculose vraisemblablement. Elle mourra à l’hôpital. Premier des événements qui vont entraîner la mue de l’adolescent. Dès lors la vie familiale est bouleversée. Le père passe beaucoup de temps à l’hôpital et le fils doit veiller au minimum de fonctionnement de la maison ; il ne reverra pas sa mère. L’enfant va se construire sans ses parents, présents-absents.
Le patron menuisier, Mat’Errico, devient un peu une sorte de substitut partiel du père. Il est un repère quotidien, stable. Sa boutique, ouverte sur la rue est un lieu de contact avec la population du quartier. Ce patron a une passion, c’est la pêche en mer. Il y consacre ses loisirs ; visiblement, il n’est pas marié, en tout cas nous n’en saurons rien. Il représente l’apprentissage du métier : le métier, c’est ce qui désigne et identifie l’homme dans les milieux populaires. Avoir un bon métier est l’assurance de gagner son pain. Nous retrouvons ici l’amour du métier et du travail manuel de De Luca. On le sent fraternel avec ces travailleurs. Dans les livres de l’auteur, les métiers et ceux qui les exercent jouent toujours un rôle majeur. Ils sont une composante forte de la personnalité humaine. Jusqu’à une époque récente, la fierté du métier était l’apanage des classes populaires. Même cela, le capitalisme financier l’a détruit.
Ce menuisier partage gratuitement son atelier avec un cordonnier, dont nous apprendrons au fil du récit qu’il est réfugié politique de la guerre, un juif qui a pu fuir avant la déportation de ses coreligionnaires. Il vient d‘un Shtetel de l’Europe de l’Est, où il était cordonnier, mais sans doute aussi rabbin de la communauté. Il est seul et travaille beaucoup pour les gens du quartier. Il a été surnommé Rafaniello car son prénom était trop difficile à prononcer pour les Napolitains. Rafaniello est un être plein de bonté et il va peu à peu devenir l’ami du narrateur. Malheureusement, il est bossu, affublé d’une énorme excroissance dorsale, et son dos le fait souffrir. Ce personnage est vraiment le chef-d’œuvre de De Luca. Il illumine le récit, il est inoubliable. Le cordonnier travaille très souvent gratuitement pour les pauvres gens. Il a capacité à redonner une seconde vie à toutes les sortes de vieux souliers[1]. Il est ainsi devenu populaire dans la rue. De manière très discrète, il donne des leçons de vie et de philosophie au jeune garçon. Il lui raconte que si son dos le fait souffrir c’est parce que dans sa bosse se trouvent des ailes d’ange et qu’elles travaillent à leur éclosion. Quand elles seront sorties, il s’envolera pour Jérusalem. On sourit en entendant cela, mais l’auteur nous réserve un coup de théâtre final superbe.
Et puis il y a Maria, une jeune fille qui habite l’immeuble voisin de celui de notre garçon. Maria est en train de devenir une belle femme, ce qui ne laisse pas du tout indifférent le propriétaire qui loue à sa mère son appartement. Il la harcèle, la serre de près et, sans doute, a abusé d’elle – De Luca ne nous le dit pas, mais il y a des indices. Maria tombe amoureuse du garçon qui n’osait pas espérer cela. L’auteur brosse avec infiniment de délicatesse la naissance de cet amour et ses manifestations. Maria est une femme-fille forte et, grâce à l’amour trouvé, elle aura la force de briser cette situation et de reprendre sa liberté et sa dignité. Dans cet univers de pauvreté, l’amour de deux jeunes gens est une lumière ; leurs rencontres vespérales au sommet de la rue comptent parmi les plus belles pages de ce beau livre.
Erri De Luca réussit ici un alliage parfait entre les diverses intrigues et personnages. C’est le premier livre de lui et j’avais été subjugué par cet art. Dans ce quartier, le long de cette rue montante (une sorte de rue Lepic à Paris) se côtoient le plus sordide de la vie, en la personne du propriétaire ou de la mère de Maria qui encourage sa fille à se soumettre à lui, et le plus pur de l’existence, avec l’idylle de Maria et du narrateur ou la bonté de Rafaniello. Ainsi est le tissu de nos vies, mélange de beau et de laid, mais où la pauvreté peut jouir du bonheur, où la mort survient quand la vie se dresse pour l’avenir, quand le père, éploré et désemparé, perd son épouse, mais gagne une belle-fille qui prend soin de lui. Et puis, il y toujours l’espoir des ailes d’ange et la splendeur rêvée de Jérusalem pour le rescapé de la shoah. Il finit par communiquer son rêve à ses jeunes amis. La vie n’est pas perdue tant qu’il reste un rêve et un espoir.
Je me rends compte que j’ai oublié un « personnage » important, au moins autant que la bosse et les ailes d’ange de Rafaniello : le boomerang. Cet étrange objet a été offert au narrateur par un ami de son père, qui lui en a raconté l’usage. Durant tout le récit, le jeune homme s’entraîne au geste sûr du lanceur de boomerang. Il muscle ainsi son bras régulièrement et transporte son boomerang avec lui partout, caché sous ses vêtements. De Luca réussit un final époustouflant en associant ailes d’anges et boomerang. Mais au-delà de cette fin romanesque, il reste la symbolique de ces choses. Rafaniello croit dur comme fer à ses ailes et accepte pour cela sa souffrance. Il attend sa rédemption, son envol. Le jeune homme attend le moment où il saura qu’il peut lancer son boomerang sans risque d’être ridicule. Ces attentes sont des joies. Il y a là un message clair pour les gens de notre époque, toujours pressés d’aboutir. Cela participe de la philosophie de vie de De Luca. Ses livres sont des odes à la lenteur, au temps des événements, de la nature, des étapes de la vie.
Ce roman est un des plus beaux de l’auteur, c’est celui que je citerais si on me demandait d‘en choisir un seul. Je l’ai encore plus apprécié à la seconde lecture, qui ne sera sans doute pas la dernière. De Luca est un écrivain précieux, ses livres sont comme des petits bijoux ciselés qu’on a envie de conserver dans un écrin à portée de main.
Jean-Michel Dauriac – Décembre 2024.
[1] ON trouve un personnage extraordinaire de cordonnier, assez semblable à celui de De Luca, dans un des contes de Léon Tolstoï, Où est l’amour est Dieu, de 1885, malheureusement jamais réédité depuis la parution des œuvres complètes de Stock, au début du XXe siècle.
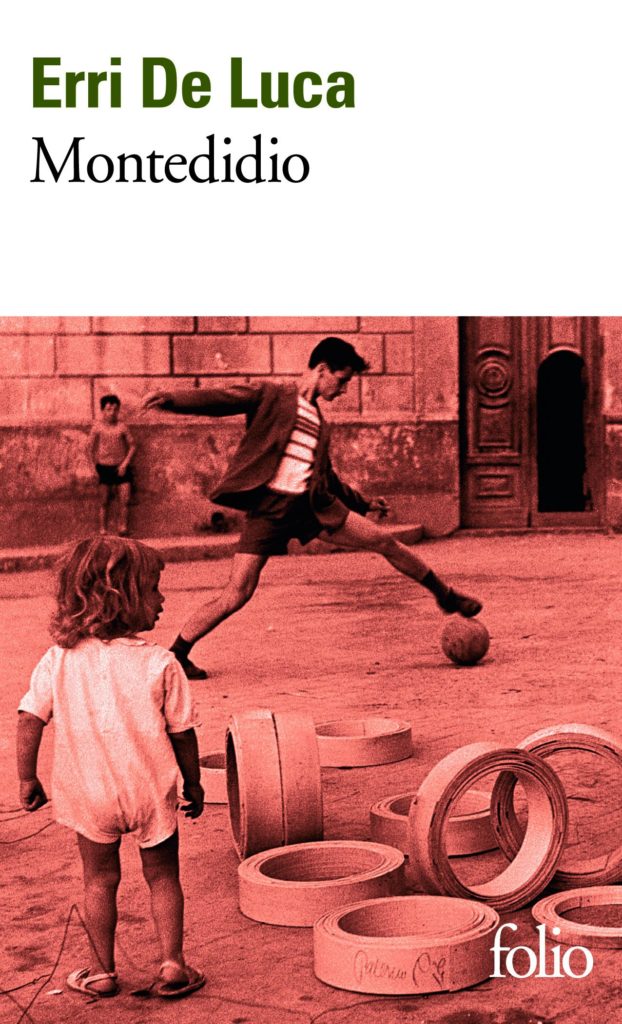
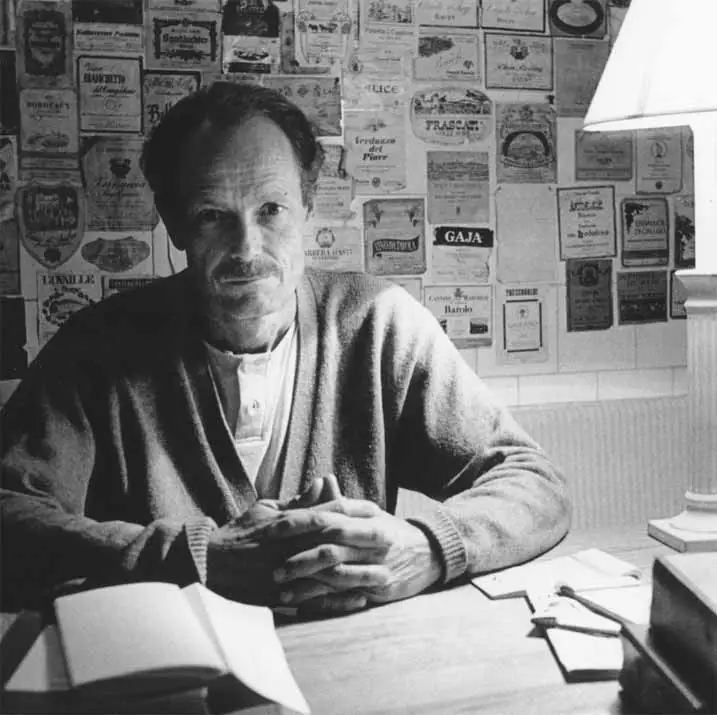
Comments