Éditions du Seuil, collection Livre de vie, 1995 (1ère édition 1966)
J’ai déjà chroniqué un autre recueil de cette auteure, La joie de croire, qui comme celui-ci est une compilation de textes issus de différents contextes et interventions de cette femme assez exceptionnelle que fut M. Delbrêl. Je ne redirai pas ici ce que j’ai exposé dans l’article évoqué ci-dessus : j’y renvoie le lecteur curieux.
Ce qui constitue l’originalité de cette compilation est le cadrage résolument mis sur les années passées à Ivry par Madeleine D.. Soit la moitié de sa vie : trente années à Ivry sur soixante années d’existence. Or, à cette époque existe ce que l’on a nommé la « ceinture rouge » ou « banlieue rouge », autour de Paris. Ce sont toutes les villes de résidence ouvrière qui votent communiste et constituent le plus fort bastion électoral du PCF, parti alors parfaitement aligné sur l‘URSS, et qui œuvrait à la venue d’un régime de type soviétique en France. Le Parti communiste était alors le parti le mieux structuré du pays et portait l’espérance de millions de travailleurs et d‘intellectuels. Les municipalités communistes étaient des laboratoires sociaux et politiques pour établir les conditions de la révolution prolétarienne. De notoriété publique les communistes étaient athées et le plus souvent antireligieux. Le catholique était, par excellence, l’ennemi de classe et de pensée. Une série cinématographique et littéraire italienne popularisera cette lutte, celle des Don Camillo. Le plus souvent, catholiques et communistes ne se parlaient pas, ou alors seulement pour s’invectiver. Chacun considérait l’autre comme l’ennemi exemplaire. C’est ce contexte d’incompréhension et d’incommunicabilité que trois jeunes femmes catholiques décident de venir vivre au cœur d’Ivry et d‘y travailler. Ce sera le début d‘une présence constante de ces femmes au sein de la ville rouge. Madeleine Delbrêl est assistante sociale : par profession elle va côtoyer au quotidien les dirigeants et les militants du Parti et apprendre à les connaître et à se faire connaître d’eux. Le cœur de ce livre est le compte-rendu, par fragments, de cette vie missionnaire au sein de la planète rouge.
L’ouvrage démarre par une copieuse introduction de Jacques Loew, un prêtre qui a connu Madeleine et a effectué le choix de ces textes. Une postface conclut le livre. Comme pour La joie de croire, les extraits sont rassemblés en grandes parties thématiques : Le missionnaire, L’Église (1949-1954), Les deux abîmes (1954-1960), Les combats de la foi (1961-1964), La leçon d’Ivry (16 septembre 1954). Il est ainsi possible de suivre l’évolution de la pensée de l’auteure. Ses positions religieuses ne changent pas, elle reste enracinée dans sa fidélité à l’Église et aux divers papes.
Les grands thèmes de ces écrits et interventions sont peu nombreux. Il s’agit d’abord de l’évangélisation, véritable vocation de Madeleine. Elle a une vision réelle de ce que ce mot signifie. Dans le cadre temporel de sa vie, il est clair que ses positions ne sont pas majoritaires. Alors que la grande majorité des catholiques sont sur la défensive et dans la tradition d’un entre-soi, elle croit à la nécessité d’aller vers ceux qui ignorent ou combattent le message du Christ. Le témoignage passe aussi bien par la présence persévérante que par l’action concrète ou la parole qui éclaire. En cela elle est vraiment une disciple de Charles de Foucault ; elle reproduit à Ivry, ce qu’il a fait dans le Hoggar avec son ermitage. Le plus important n’est pas de compter les conversions, mais que le Christ soit présent au milieu de ceux qui le rejettent ou l’ignorent. On comprend très bien alors pourquoi Madeleine D. s’est senti en phase avec le mouvement des prêtres-ouvriers et pourquoi elle a protesté lors Rome leur a demandé de revenir dans leurs églises et d‘abandonner le travail manuel. Bien qu’elle n’ait pas publiquement combattu la décision du Vatican en la matière, elle a pris position contre cette interdiction. Elle comprenait mieux que n’importe cardinal de Rome la grandeur de cette mission si humble et souvent muette. Certes le risque existait que ces prêtres soient finalement attirés par le combat politique des communistes et perdent la foi et renoncent au sacerdoce. Si cela s’est produit, ce fut tout à fait à la marge et ne saurait constituer une raison valable à la décision de Rome. Avec le recul du temps, nous savons aujourd’hui que cette position accéléra encore la déchristianisation de notre société et favorisa l’éloignement du peuple de l’Église.
Voici un extrait sur ce thème de l’évangélisation :
« La mission c’est faire là où nous sommes l’œuvre même du Christ. Nous ne serons ‘Église, nous ne diffuserons le salut jusqu’aux extrémités du monde, que si nous travaillons au salut des hommes au milieu desquels nous vivons. Et nous ne travaillerons à ce salut, nous ne le laisserons passer que si, au milieu d‘eux, nous sommes inaltérablement, purement l’Église.
Nous sommes dans un monde où le salut semble ne pas passer. Un autre morceau du monde « garde indûment pour lui la plus grande partie du sang ou de la nourriture de ce corps ». Il faut en souffrir à mort. Mais il faut faire en sorte que donner la vie à ceux-ci ne prépare pour demain l’agonie mortelle de ceux-là » (Article Église et Mission. 108).
On voit bien, dans ce court extrait que l’enjeu de la mission est de garder l’équilibre entre l’annonce au monde et la vie interne de l’Église. Pour Madeleine cela n’est nullement un problème, mais elle sait très bien quelles sont les réticences massives du peuple catholique à ces immersions au milieu des « pécheurs ». La courte phrase « Il faut en souffrir à mort » montre fort bien qu’il n’y pas le choix ; l’enseignement du Christ est tout entier dans cette tension lorsque, par exemple, il envoie ses disciples en mission dans les villes et villages d’Israël (voir Évangile de Luc, chapitre 10, versets 1 à 16) et qu’il leur dit, en guise d’encouragement (!) : « Allez ; voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Sous diverses formes, usant d’images variées et d’exemples nombreux, Madeleine D. délivrera inlassablement ce message d’envoi en mission.
Le second thème qui est traité assez régulièrement est celui de l’athéisme, de sa signification réelle et des moyens de s’adresser aux athées. Madeleine D. Insiste bile fait que l’athéisme est une tendance lourde de son époque et que les communistes n’en sont que la troupe la plus visible et militante. Ce qui se joue entre 1930 et 1970 est bel et bien la « mort de Dieu » qui survient pour des millions de Français. Face à ce phénomène qui n’est que l’aboutissement de plus de deux siècles de rationalisme des Lumières, il est capital que les chrétiens ne soient ni fatalistes ni absents. L’athéisme est pour Madeleine un défi à la foi. Elle aborde par différents angles ce défi et illustre d’exemples ses propos. Elle est alors invitée par de nombreux publics catholiques pour apporter sa connaissance pratique et présenter une démarche positive de réaction. Ce sont tantôt des religieuses, tantôt des étudiants ou des travailleurs sociaux. Chaque texte étant situé, nous pouvons ainsi avoir une petite idée de son audience dans le pays. Pour Madeleine, l’athéisme est une manière de vivre une foi réfléchie et de l’entretenir.
« Un monde athée ne naît pas à côté de communautés chrétiennes sans que celles-ci soient coupables, au moins, d’égoïsme aveugle. Les causes économiques paganisantes elles-mêmes sont la somme de cœurs pécheurs. » ( Article Le risque de la soumission, p. 143).
J’entends déjà les moqueurs s’exclamer à la lecture de ces lignes : « Ces cathos, toujours hantés par la culpabilité ! » Ne confondons pas, avec une évidente mauvaise foi, la culpabilité ressentie par le pécheur face à son péché, qui est la condition première d’accès au salut par Jésus-Christ, selon la foi chrétienne, et la culpabilité dont il est ici question. Ici, Madeleine Delbrêl parle d’une faute sociale dont les chrétiens sont responsables : ils ont laissé se développer un athéisme à leur proximité, preuve qu’ils n’ont pas réussi à porter la vie nouvelle du Christ avec assez de force. On peut, bien sûr, tout à fait légitimement ne pas adhérer à cette position ; on peut faire de l’athéisme, au contraire, une liberté retrouvée en face de l’obscurantisme de l’Église. Cela, Madeleine le sait parfaitement, c’est le discours des communistes qu’elle a côtoyés pendant trente ans. Mais pour elle, ce n’est pas la véritable raison. Elle se sent, à son niveau, co-responsable de l’émergence de cet athéisme.
Madeleine Delbrêl dans le jardin de sa maison, à Ivry
En effet, le troisième thème récurrent, qui se mêle souvent aux autres, est celui de la foi. Rappelons que Madeleine Delbrêl est une convertie. Elle a donc elle-même vécu ce retournement de vie, de pensée et de cœur qu’est la raison même d’une conversion. Sa foi n’est pas un héritage culturel, mais un don de Dieu qui oblige celui qui l’a reçu. Qui l’oblige à son tour à vouloir la communiquer, faire connaître celui qui la donne. Je crois à la force de la foi des convertis, je crois d’ailleurs que toute vraie foi ne peut résulter que d’une conversion, quelle que soit la façon dont elle se déroule. Une foi non personnelle ne peut tenir face aux défis du monde moderne. Mais s’il faut posséder une foi personnelle pour vivre la vie du Christ, il faut aussi accepter de la remettre en question, surtout dans sa forme, de la laisser être interpellée par ceux qui ne l’ont pas. C’est ici que le communisme fait retour. Il est le moyen parfait pour mettre sa foi à l’épreuve et la faire évoluer pour qu’elle porte plus de fruit, notamment dans l’amour du prochain. Madeleine parle sans cesse de la foi, elle est toujours là dans ses discours ou écrits, explicitement ou implicitement. Je donne seulement quelques petites perles trouvées dans cette lecture.
« Il serait absurde de penser que la foi ne puisse tenir dans les milieux pour lesquels elle semble précisément exister.
Il serait absurde de penser que le chrétien est fatalement entraîné à perdre la foi dans les milieux où elle n’a pas été annoncée. » (Article Temps d’aujourd’hui, temps de notre foi, p. 221).
Elle revient ici sur la grande peur des catholiques bien-pensants : le risque de perdre la foi en allant vivre au milieu des incroyants. Elle parle à ce propos d’absurdité, terme plutôt fort. Une foi qui ne saurait résister au milieu à évangéliser serait une foi vaine et mal fondée.
« La foi est chargée de nous faire accomplir, dans le temps, de l’éternel. Elle est chargée de nous faire agir sur les épisodes de nos histoires, de notre histoire, pour faire, avec chacun de ces épisodes passagers, un événement éternel ; un événement éternel, non seulement pour nous, mais pour toute l’humanité.
La foi, c’est l’engagement temporel de la charité de Dieu, c’est l’engagement de la vie éternelle dans le temps. C’est manquer de foi que de ne pas se laisser enseigner par la foi sur le sens du temporel, comme de ne pas se laisser enseigner par elle sur le sens de l’éternel. » (Même source, p.225).
La foi est en lieu avec l’amour du prochain ; elle est notre source de formation perle, tant pour les choses ordinaires de la vie (le temporel) que pour la vie spirituelle (l’éternel).
« Il faut aussi que nous sachions qu’évangéliser, ce n’est pas convertir. Qu’annoncer la foi, ce n’est pas donner la foi. Nous sommes responsables de parler ou bien de nous taire, nous ne sommes pas responsables de l’efficacité de nos paroles. » (Même source, p. 229).
La foi est un don de Dieu. Aucune femme, fût-ce Madeleine Delbrêl, aucun homme, fût-ce l’apôtre Paul ne peut donner la foi. Le croire c’est prendre l’acteur pour l’auteur de la pièce. Le travail du chrétien est de porter la parole qui mène à Celui qui donne la foi. C’est tout, et c’est déjà tellement grand et difficile.
Nous autres, gens des rues est un manifeste de combat. Même s’il est composé de textes divers qui n’ont jamais été pensés pour constituer une œuvre unique, leur cohérence évidente apparaît au fil de la lecture. Que les compilateurs soient remerciés pour le travail qu’ils ont fait, car il est vraiment utile et réussi. Comme pour La joie de croire, ce livre est un livre-compagnon que l’on doit laisser à portée de main.
Jean-Michel Dauriac – Les Bordes, novembre 2024.
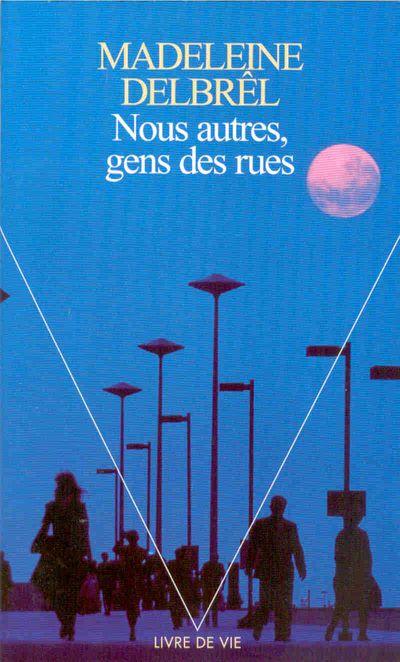

Comments