J’ai LU éditions – 2024 (1re édition 2023)
Je suis le travail de Michel Onfray depuis ses débuts dans la fin des années 1980. Je dois dire que j’ai vite compris que je devais renoncer à lire tous ses livres, compte tenu du rythme épuisant des parutions. Il faut aussi ajouter que certains des thèmes abordés ne m’exaltaient guère. J’ai donc décidé de devenir un intermittent d’Onfray. Ce dont je m’acquitte avec régularité et sélectivité. Ceux qui fréquentent mon blog (fondée il y a presque vingt ans) ont pu y lire plusieurs critiques argumentées de ses ouvrages qui croisaient mes centres d’intérêt. J’ajoute une pierre à cet édifice lectoral aujourd’hui avec Anima, un des derniers ouvrages parus – avec Onfray, il ne faut jamais écrire « le dernier ouvrage paru », c’est quasiment à coup sûr une « fake news ».
Au terme d’une introduction qui part de la conquête lunaire par les Américains en 1969, il annonce son projet :
« Anima propose l’histoire de l’Homo sapiens via celle de son âme. » (P.32).
C’est donc dans une de ces fresques au long cours que l’auteur va se lancer, des Grecs à Elon Musk en quelque sorte. L’auteur nous propose un plan en trois étapes : Construire l’âme, Déconstruire l’âme et Détruire l’âme. Tel quelle, cette progression nous semble logiquement aboutir à la néantisation de l’âme, ce qui correspondrait à la position d’Onfray, pour lequel l’âme est une invention des religieux. Mais quand on arrive à l’épilogue, le moins que l’on puisse dire est que le doute plane sur nous : quelle est vraiment la position de l’auteur ? En effet, face au risque transhumaniste, on le voit se poser quasiment en défenseur de l’âme humaine, au nom de l’humanité menacée. Peut-être ai-je mal compris, mais je n’ai pas trouvé ce que j’attendais in fine, à savoir le triomphe du matérialisme sur la superstition religieuse et l’acte de décès de l’âme.
Ce livre est tissé des paradoxes habituels que l’on trouve dans les écrits de Michel Onfray et que j’ai déjà signalés plusieurs fois. Pourquoi mettre tant de talent et d’énergie à détruire ce qui n’existe pas ? L’obsession de plus en plus nette d’Onfray est le christianisme, qu’il identifie, pour des raisons personnelles, historiques et culturelles, au catholicisme romain. Les deux cents premières pages, soit la première partie du livre, sont une instruction à charge contre le christianisme et ses prêtres, avec au premier chef celui qu’il abhorre le plus, Paul. Bien sûr, l’auteur concède que ce sont bien les antiques anté-chrétiens qui ont inventé la notion d’âme, en particulier Platon, mais il ne retient que le rôle du christianisme. Sans doute en raison de sa prédominance en Occident. Les prêtres et papes n’auraient usé de e que pour terroriser les peuples chrétiens en les menaçant au nom de Dieu des affres de l’Enfer et du Purgatoire. Même s’il n’a pas entièrement tort en ce qui concerne la stratégie catholique, il la confond avec le message de libération du Christ. Lui qui connaît de choses ignore complètement qu’il existe une contre-histoire du christianisme comparable à celle qu’il a menée contre la philosophie dominante. Il faut aller la chercher dans des sources peu connues et peu diffusées hors de l’Église catholique. J’ai rédigé un essai sur un de ces ouvrages, mis en ligne sur mon blog : http://www.regard.eu.org/Livres.2/Pelerinage.douloureux/Depart.html ; on peut non seulement y lire une critique détaillée, mais aussi télécharger gratuitement cet ouvrage.
Michel Onfray met donc toute sa verve à décrire l’œuvre asservissante de l’Église au fil du temps, avec moultes citations, après avoir présenté l’œuvre préparatoire des grecs (Pythagoriciens, Platon et Plotin dont il fait un compagnon de route des chrétiens sur le plan de l’âme, ou peut-être est-ce l’inverse ?). Il est évident qu’il a lu les Pères de l’Église avec attention. Il impute donc aux chrétiens et à l’Église l’installation de l’âme en Occident. Ce qui pour lui est un grand crime, car il est évident que c’est un mensonge puisqu’elle est immatérielle. Je ne discuterais pas ici ce que cette position a de fragile, car elle revient à nier tout ce qui n’est pas matériel, ce qui s’avère une impasse intellectuelle. Le matérialisme absolu ne tient pas, d’ailleurs Onfray lui-même le sait, lui qui a écrit des livres sur les bonheurs spirituels. Pourtant, malgré les neurosciences, rien ne peut expliquer l’émotion ressentie à l’écoute du Requiem de Mozart, surtout pas l’émission de substances par certaines zones du cerveau. Mais le scientisme est bien ancré, même chez les plus grands esprits. Après avoir déchargé pendant près de deux cents pages sa fureur sur l’Église Catholique, il entreprend de voir comment une série de penseurs a déconstruit ce que l’Église (et la philosophie grecque) avaient édifié.
Dans cette deuxième partie, Michel Onfray fait du recyclage. Il va aborder successivement les auteurs qu’il a traités dans sa vaste contre-histoire de la philosophie. Il y a donc pour ses fidèles lecteurs ou auditeurs, à l’époque de Caen, un air de déjà vu. Partant de Descartes, il montre que le cartésianisme est une mauvaise lecture de l’œuvre du philosophe tourangeau ; lesquel restait déiste et partisan de l’existence de l’âme. Mais, comme on n’est jamais mieux trahi que par ses disciples, le cartésianisme est devenu la matrice des Lumières et de l’émergence d’un athéisme matériasliste, dont nos philosophes scolaires ne sont pas les défenseurs, mais plutôt le curé Meslier – un des héros préférés de Michel Onfray, sans doute par une certaine identification intellectuelle – dont le Testament, publié fort tardivement, est l’acte de décès de l’âme et de Dieu. Onfray évoque aussi d’autres penseurs du même bois, comme La Mettrie ou Gassendi. C’est un parcours intéressant dans les arrière-boutiques de la pensée française, où le talent de pédagogue et la verve critique de l’auteur font merveille.
La troisième partie nous annonce donc logiquement la destruction de l’âme. Et effectivement, repartant de La Mettrie il passet par d’autres auteurs connus comme Condorcet, Darwin ou Kant. Il réserve un sort particulier à Jean-Jacques Rousseau qu’il accuse d’être le père de doctrines néfastes et un homme exécrable. Celui-ci en sort laminé. Les mots d’esprit fusent en tous sens, même si on se rend bien compte que c’est extrêmement partial. La Révolution et ses suites ont quand même pas mal œuvré à une certaine destruction religieuse de l’âme, tout en conservant l’aspect philosophique et intellectuel. Donc, au XIXe siècle, le cadavre de l’âme remue encore.
Onfray consacre la dernière partie de cette troisième étape à notre second XXe siècle, celui d’après 1945. Ce en quoi je ne peux que l’approuver. Il y a en effet une rupture intellectuelle majeure en 1945, dont Hiroshima peut être l’acte fondateur. Je renvoie au cher Albert Camus d’Onfray pour des textes décisifs en la matière. Ce qui intéresse l’auteur ce sont les penseurs qui vont émerge après la guerre et marques, surtout en France, la pensée des soixante-dix années suivantes. Nous allons assister là, durant environ cent pages à une véritable pyrotechnie verbale. Sont successivement étudiés (pas nécessairement dans cet ordre) Deleuze, Foucault et Lacan, trois des bêtes noires du philosophe normand depuis ses débuts. Je dis bien qu’ils sont étudiés et pas seulement raillés : Onfray donne de larges extraits de leurs œuvres. Un exemple jubilatoire : les larges citations commentées du livre de Deleuze sur le structuralisme. C’est cruel mais tellement bien vu. Deleuze ne définit rien, pose l’indémontrable comme sûr, délivre des formules incompréhensibles. On ne saura jamais ce qu’est le structuralisme et une structure (alors que l’inventeur de cette analyse, Lévi-Strauss en a donné de bonnes approches dans ses œuvres sur la parenté. Onfray passe aussi par Lacan, le pape parisien de l’incompréhensible, donc du sublime pour la petite foule qui se pressait à ses séminaires. On termine par Foucault, avec une belle perspicacité sur l’ensemble du parcours du gourou le plus cité dans les thèses depuis trente ans (souvent sans aucun rapport avec le sujet, mais comme caution de l’appartenance au bon troupeau). Auparavant, Onfray avait zigouillé Heidegger d’une phrase et tiré une salve de plus sur Freud, un grand charlatan pour lui.
Et on arrive, assez logiquement, au dernier rebondissement de l’histoire de l’âme : le transhumanisme. Il brosse assez rapidement le projet de l’homme augmenté, à travers le personnage d’Elon Musk. Il cite quelques-uns de ces propos qui font froid dans le dos, tant ils font fi de l’humanité. Voici ce qu’écrit Onfray :
« L’heure venue, ce post-humain supposera probablement des âmes numériques chargées sur des encéphales humains, peut-être clonés, eux-mêmes appariés à des exosquelettes. …Aujourd’hui dépourvu d’âmes, qui nous dit que les hommes acéphales que nous sommes devenus ne sont pas déjà morts ? » (P.565.)
Notons la dernière phrase. Je la lis comme une prophétie de malheur, mais aussi comme un regret qui ne dit pas son nom. Finalement, Michel Onfray, face au péril transhumaniste d’un humain détruit et numériquement recomposé, n’en viendrait-il pas à préférer la bonne vieille âme humaine platonicienne et chrétienne ?
Ce livre est éblouissant d’érudition. Il traduit bien la vie intellectuelle de moine que mène l’auteur (voir son livre récent sur les monastères). Je dirai ici à nouveau ce que j’ai dit sur d’autres livres : Onfray lutte désespérément contre l’idée même d’une foi chrétienne, contre l’existence de Jésus et la perversité de l’Église, mais parmi ses amis on trouve des moines, dans ses lectures, toute la littérature chrétienne occupe une grande place, comme dans sa bibliothèque. On pourrait, à son propos, paraphraser Pascal : « Me combattrais-tu autant si tu ne me connaissais pas déjà ? ».
Une autre qualité remarquable de ce livre est la clarté de son style. Il est d’une grande facilité à lire, sauf les citations absconses de certains des auteurs étudiés. De plus, l’auteur ne retient plus ses coups et manie une ironie cinglante autant qu’il fait preuve d’une admiration assumée pour certains. La qualité de l’écriture d’Onfray a beaucoup progressé au fil du temps. ON ne s’ennuie jamais en le lisant. Essayez, si vous ne l’avez jamais fait.
Jean-Michel Dauriac – Décembre 2024.

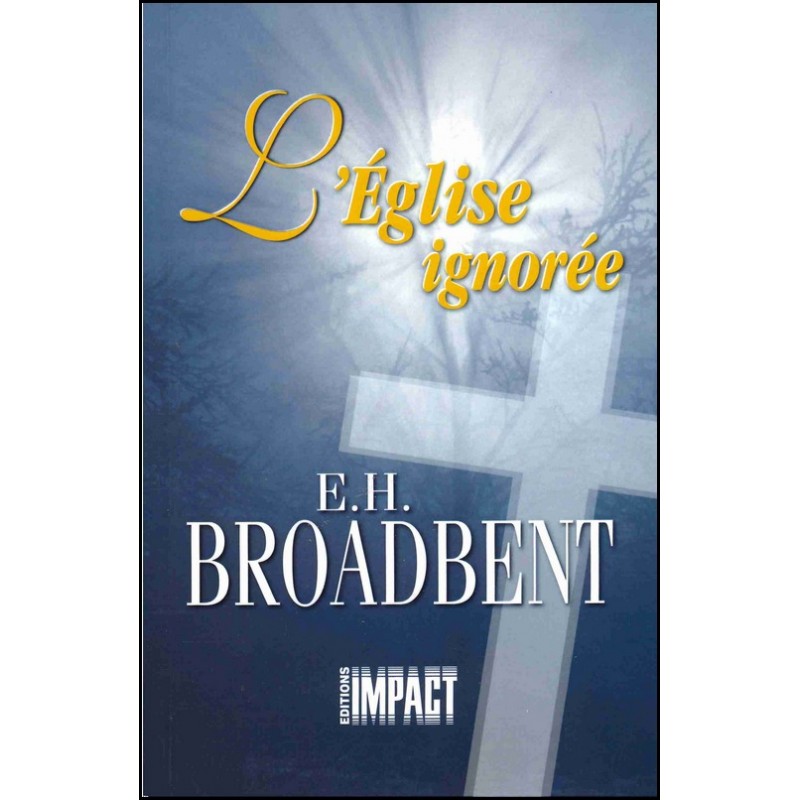
Comments