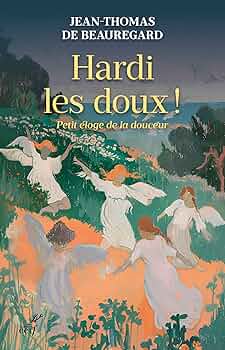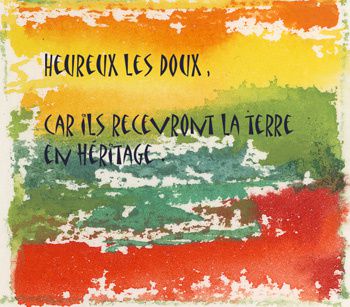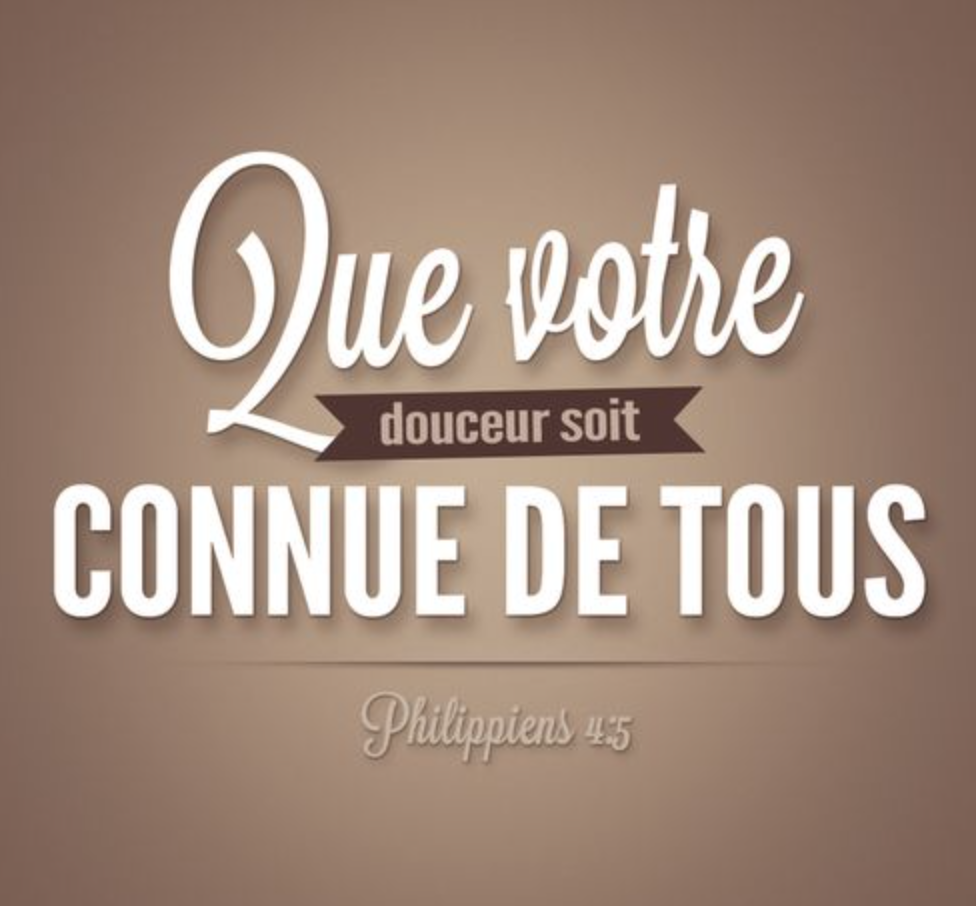Les éditions du Cerf, 2024.
L’Ordre des prêcheurs (O.P.) fut le premier nom de cette création de Dominique de Guzman, lors de la lutte contre les hérétiques cathares, afin de les ramener, par l’exemple – et non par l’Inquisition, au départ -, au sein de la vraie foi. L’ordre est voué essentiellement à la prédication. Celle-ci peut prendre des formes diverses, tant à l’oral qu’à l’écrit. Depuis toujours cet ordre est une pépinière d’auteurs, d’enseignants et de grands prédicateurs, comme son rival, l’ordre jésuite.
Le frère Jean-Thomas de Beauregard appartient à la génération montante de l’ordre, celle des trentenaires qui fourmillent d’idées et s’attaquent à des sujets jusque là ignorés de leurs prédécesseurs. Dans cet ordre d’idée, j’ai déjà chroniqué un autre auteur de la même génération, Sylvain Detoc et son livre étonnant, La gloire des bons à rien. Leur angle d’attaque est celui de la surprise, du contre-pied, dont on comprend bien qu’il est un moyen d’éviter de mettre ses pas dans les pas de ses pères et de produire un énième livre sur la charité ou l’eucharistie. Cela correspond bien au caractère des jeunes dominicains que j’ai pu rencontrer. En cela, ils rejoignent la cohorte des auteurs protestants de leur génération, preuve que c’est une démarche globale d’adaptation du discours religieux à l’époque et au public nourri aux réseaux (a)sociaux. Ceci étant dit, je doute sérieusement que ce public de digital natives, comme disent les cuistres sans racines, lise ce livre : il est écrit dans une belle langue française, et il n’y a ni images, ni QR codes, ni émoticônes.
Le frère dominicain Jean-Thomas de Beauregard
J’ai dû découvrir ce livre dans une revue catholique où il était présenté. Comme pour celui de S. Detoc, c’est le titre qui m’a accroché, preuve que leur analyse d’auteur est juste. Associer la hardiesse à la douceur a quelque chose de l’oxymore dans notre pensée actuelle. J’avais hâte de voir comment notre jeune prêcheur allait s’en sortir. Alors, disons-le de suite, quitte à briser un suspens insoutenable, il s’en sort très bien !
Le livre débute par un avant-propos titré La querelle du romancier et du philosophe, qui s’appuie sur les positions de deux auteurs catholiques du XXe siècle, le philosophe Jacques Maritain, thomiste de référence, et George Bernanos, écrivain flamboyant, toujours révolté et merveilleux peintre de l’âme humaine et de ses méandres. Bien que tout à fait opposés dans leurs caractères, ils aspirèrent tous deux à être des doux, à leur manière. C’est sur ces différences d’approche de la douceur que l’avant-propos se développe. Je n’hésiterai pas à dire que ces pages sont brillantes. Elles joignent un style impeccable à une structure passionnante fondée sur une citation du Britannique Chesterton, autre enfant terrible du catholicisme, qui dénonçait les « vertus chrétiennes devenues folles » (p. 9). Parodiant cette expression, L’auteur utilise la méthode de l’anaphore « La douceur chrétienne devient folle… » pour dénoncer tout ce que la douceur dont il veut parler n’est pas. C’est de la théologie négative sous forme littéraire. Il va au combat d’entrée contre Machiavel et Nietzsche, contempteur de la douceur comme vertu des faibles ou des efféminés. Il clôt cet avant-propos par les mots suivants :
« La douceur est la vertu des forts et l’apanage des saints. Elle se reçoit et s’apprend. Heureux les doux, hardi les doux ! » (P.20).
Le reste du livre ne se maintient pas à ce zénith de pensée et de formulation, mais c’était quasiment impossible. Le frère de Beauregard reprend alors sa plume de professeur de philosophie et de théologien, pour nous offrir un plan basé sur la Trinité. Le Père est révélateur de la douceur, le Fils est douceur paradoxale, l’Esprit Saint est une onction de douceur. Ces trois chapitres permettent de visiter la Bible et les textes de la tradition.
Qu’est-ce que la douceur de Dieu ?
« La douceur de Dieu consiste donc à rencontrer les créatures et à accompagner sa propre action et celle de toutes les créatures pour les conduire vers leur bien. » (P.25)
Dieu veut le bien pour sa création et c’est par sa révélation qu’il veut y conduire l’humanité. La Bible nous raconte cette révélation et comment Dieu a le souci de ses créatures.
« Dès lors, si Dieu ne renonce jamais à accompagner vers le bien toutes ses créatures à titre singulier, et le monde général, le plus souvent sa grâce se coule dans les dispositions naturelles des créatures qu’il vient guérir et surélever pour les faire rayonner d’un peu de sa gloire. C’est ce qui fait qu’il passe inaperçu.» (P.33-34).
La révélation de Dieu est progressive, comme le montre l’auteur :
« Il y a une progressivité de la Révélation, depuis Abraham jusqu’à l’incarnation du Christ achevée dans le don de l’Esprit-Saint à la Pentecôte. Dieu ne se révèle pas tout entier en une seule fois. » (P.35).
Pourquoi la douceur de Jésus est-elle qualifiée de « paradoxale » ?
« Charité, humilité et douceur. Seules vertus pour lesquelles le Christ se donne explicitement en exemple ; ce sont précisément ces vertus qu’il nous commande d’imiter, contre la promesse de nous « procurer le repos », à nous qui peinons sous le poids du fardeau (Mt 11 :28). » (P.44).
Le Christ est donc le modèle à suivre, sur ces trois vertus associées et interdépendantes. Sa venue sur terre est faite dans cette optique.
« La douceur de l’Incarnation se réalise dans l’humilité et pour la charité. »(P. 46 ).
Cette affirmation se doit d’être corroborée par l’ensemble de la vie de Jésus. Il est manifeste qu’il a été humble toute sa vie. Il s’est toujours mis derrière le Père, il n’a jamais recherché les honneurs, a refusé l’idolâtrie du peuple. D’où lui venaient ces qualités ? De Beauregard avance une hypothèse :
« … on peut émettre l’hypothèse que Jésus, en son humanité, a appris la douceur sur les genoux de la Vierge Marie, quand bien même il la possédait parfaitement en vertu de sa divinité. » (P. 51).
On pourra apprécier la contradiction : soit il possédait la douceur ab origine, soit il l’a apprise. Mais on peut combiner les deux. Sauf, évidemment, à vouloir donner à Marie un rôle de plus, pour épaissir la légende construite hors de toute base biblique. Le vrai problème est la divinité ou l’adoption divine de Jésus, débat qui fut très vif dans l’Église primitive.
Le paradoxe de Jésus est celui de la douceur et de la colère, deux sentiments ou comportements antagoniques, au moins en apparence. En apparence seulement, car il existe une colère positive. Pour la définir, l’auteur cite Aristote et l’Éthique à Nicomaque.
« L’homme donc qui est en colère pour les choses qu’il faut et contre les personnes qui le méritent, et qui en outre l’est de la façon qui convient, au moment et aussi longtemps qu’il faut, un tel homme est l’objet de notre éloge. Cet homme sera dès lors un homme doux. » (P. 52).
La douceur n’exclut donc nullement la colère pour la philosophie grecque. Ce qui compte est la maîtrise de soi dans cette colère. Il faut donc admettre qu’il existe des circonstances et des gens contre lesquels il faut être en colère. L’auteur cite ensuite plusieurs exemples de moments où Jésus contient sa colère ou ne répond pas à la colère de ses adversaires. À l’inverse, il cite trois femmes converties par la douceur du Christ (la Samaritaine, la femme adultère et la pécheresse au parfum).
D’où vient cette douceur de Jésus, inatteignable à l’homme.
« La douceur de Jésus est le rayonnement sur la terre de la douceur divine qu’il partage avec le Père de toute éternité au ciel. Elle est d‘autant plus grande qu’il est tout entier pacifié, conformé par tout son être à la volonté du Père. » (P. 60).
Jésus parvient à concilier la douceur divine et une colère sainte contre le mal et le péché. C’est le chemin à suivre : non bannir toute colère au nom d’une charité mal comprise, mais la contrôler et l’accompagner d’une douceur au quotidien. Vaste programme ! Tout l’enseignement du Christ doit être considéré à cette mesure. Jusqu’à la Passion, tout est transmission aux disciples ;
« L’enseignement de Jésus sur l’amour inconditionnel des ennemis et la -violence doit être médité à l’aune du récit de la Passion. Car c’est de Gethsémani au calvaire que Jésus accomplit son enseignement. » (P. 67).
L’onction de douceur du Saint-Esprit n’est pas la plus simple à comprendre.
« Des trois personnes de la Trinité, l’Esprit-Saint est la plus insaisissable. Son œuvre auprès des hommes et dans le monde se fait sous le signe de la discrétion. Pourtant, dès lors qu’un acte de foi, d’espérance et de charité est posé ici-bas, dès lors que quelque œuvre bonne est produite par un homme, l’Esprit-Saint est là qui en a suscité le désir, soutenu la réalisation, et qui lui a donné de porter du fruit. » (P.71).
En effet, notre connaissance est, paradoxalement, la plus limitée sur le Saint-Esprit, alors même que c’est Dieu en nous, donc ce que nous devrions le mieux ressentir et comprendre ! L’auteur n’ignore évidemment pas cette difficulté, mais il ne l’affronte pas directement. Il préfère passer par l’exemple d’Augustin et des extraits des Confessions, abordant ainsi la douceur des premiers temps de conversion. Ensuite, dit-il, les choses se corsent, car la douceur suave des débuts fait place à un chemin plus mitigé où la découverte du mal rend les choses plus âpres. La vie devient plus combat. Mais c’est alors que l’onction de l’Esprit est la plus utile et qu’il faut savoir la rechercher et la cultiver. L’Esprit devient la force qui nous aide à saisir la Parole, à la méditer, à la faire esprit et vie en nous. Pour le dominicain, la douceur de l’Esprit se manifeste principalement dans les sacrements.
« L’édifice sacramentel de l’Église n’est donc rien d’autre que la manière douce dont l’Esprit-Saint entend communiquer la grâce du Christ à tous les hommes pour les amener au Père. » (P. 84).
Voici une phrase qui vous semblera peut-être anodine et sans équivoque. Mais elle est pourtant, pour le moins discutable. D’abord par la dimension donnée aux sacrements : l’Église romaine en reconnaît sept, alors que les protestants n’en comptent que deux ! la différence tient à leur historicité : pour les réformés, seuls ceux mis en œuvre par le Christ lui-même sont dans cette catégorie. Les autres n’ont en effet pas de racines bibliques, Jésus ne les ayant pas mis en action (mariage, confession – ou réconciliation en termes modernes -, extrême onction, la confirmation et l’ordination[1]). Il faut aussi parler de leur administration : pour les catholiques, seuls les ordonnés peuvent donner les sacrements, c’est une affaire de religieux exclusivement ; pour les protestants, le sacerdoce est universel, donc les sacrements sont à disposition de tous les fidèles, avec discernement évidemment ! Enfin il faut déminer le terme « Eglise » qui, pour notre auteur, comme pour tous les catholiques est synonyme d’Église catholique romaine. Or, ceci est également inacceptable pour les protestants, qui appellent Église l’ensemble des croyants du monde entier, soir l’Église universelle invisible, par contraste avec l’église locale, visible. Les sacrements sont à disposition, par l’enseignement apostolique, de toutes les églises locales fondées sur la parole du Christ.
Ces distinctions étant posées, je puis accepter le propos de notre auteur, dans un sens bien plus « inclusif » que celui qu’il lui donnait, sauf procès d’intention de ma part.
En effet l’onction de l’Esprit amène le croyant à rechercher la communion fraternelle sous toutes ses formes et c’est dans la communauté des croyants qu’elle peut s’accomplir.
J’émets donc des réserves théologiques et ecclésiologiques sur ce chapitre, tout en acceptant son contenu général.
Après cette étude trinitaire de la douceur, l’auteur aborde la question de la grâce et des vertus face à la douceur. On rentre donc dans l’éthique de la douceur.
À ce propos, il pose un principe que je ne puis que partager :
« La conversion est la grande affaire des chrétiens. Non pas seulement de ceux qui ne le seraient pas encore, mais aussi de ceux qui le sont déjà, mais pas assez. » (P. 99).
Avant de discuter ce point, soyons clairs : on n’est jamais assez converti au Christ tant que l’on est sur cette terre des hommes. Je ne puis que me réjouir de cette affirmation, car elle n’est pas si évidente que cela dans l’histoire du catholicisme. Sans remonter à l’antiquité ou au Moyen Âge, je parlerais simplement de ce que j’ai vécu au début des années 1970 lorsque je rencontrais de jeunes catholiques ou des prêtres. La conversion était alors une notion non utilisée dans la vie courante des croyants. J’ai vu revenir ce mot progressivement à partir du pontificat de Jean-Paul II. Il est aujourd’hui courant dans tout discours de l’Église romaine. Je pense qu’il ne s’agit pas seulement d’un hasard ou d‘une mode. Longtemps religion d’État et ultradominante, l’Église catholique n’avait nul besoin de la conversion, on naissait catholique et tout le système sacramentel s’enclenchait, avec plus ou moins de succès. Ce n’est plus du tout le cas. Si le catholicisme reste statistiquement première confession de France (pour combien de temps encore face à l’islam ?), il a connu une décrue énorme que l’on peut mesurer à la fréquentation des offices ordinaires. La sécularisation l’a touché de plein fouet. Les mariages se sont effondrés, comme les baptêmes ou communions solennelles. Le recrutement vocationnel des prêtres est très problématique (il en va de même pour le protestantisme historique). L’Église s’accroit surtout maintenant par conversion et baptême d’adultes : elle s’est donc « protestantisée » dans son recrutement. Du coup, la conversion est une expérience qui a gagné droit de cité, et je m’en réjouis, car je crois qu’il n’est d’Église réelle que de convertis.
Mais la conversion n’est pas la fin du chemin, elle en est juste le portail. Dès que l’âme a été sauvée par la grâce divine, elle doit se battre contre le mal qu’elle découvre en elle et autour d’elle. C’est ici que les vertus interviennent. Elles seront les armes dans cette lutte de toute la vie. Or, sur le chemin des vertus, l’homme rencontre deux ennemis, nous dit l’auteur, deux ennemis issus du protestantisme : Kant et Luther. L’un prônant le bien comme devoir absolu, avec son impératif catégorique, qui exclut tout plaisir et toute joie – il est vrai que Kant n’est pas resté dans l’histoire comme un boute-en-train! -, et l’autre refusant à l’homme toute possibilité de sortir de son péché, sauf le salut par grâce. Ce qui refuse toute idée de progrès spirituel et repose entièrement sur la foi, comme seule bouée de sauvetage. Ce qui, nous dit notre dominicain, enlève tout rôle à la conversion. Et donc tout travail des vertus.
Il est étonnant, au XXIe siècle, un homme aussi brillant que notre auteur, se t=retrouve les pires clichés sur Luther et le salut pas la foi. Comme si le chemin de la réconciliation n’avait pas été acté par l’Église avec ce que l’on appelle la Concorde de Leuenberg[2]. Il faut malheureusement dire que, chez les dominicains, Luther est traité comme le Diable ! Vieille haine qui remonte à la Réforme !
L’amusant dans ce passage est que la conversion a été l’apanage des Églises protestantes depuis leur origine, alors que l’Église romaine n’en faisait même pas mention, et qu’il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que ce moment décisif de la vie chrétienne revienne dans le vocabulaire usuel de Rome. Ce pas sage du livre est donc, de facto, obsolète et partial.
Notre auteur revient donc à Augustin pour enterrer Kant. Ce sera plus difficile pour Luther, lui-même moine augustinien de haute volée. Il est évident que tout chrétien cherche à accomplir le bien et use des grâces divines que notre auteur appelle vertus. Il existe malheureusement depuis toujours de croyants qui refusent ce combat, ou le croient déjà gagné ; ils sont aussi bien chez les catholiques, les orthodoxes ou les protestants. Le livre propose une définition de la vertu :
« C’est une disposition à agir bien dans un domaine particulier, avec aisance et joie. Or la vertu s’acquiert par répétition d’actes dans un sens donné. » (P. 109).
D’où nous inférons que la vertu est donnée par Dieu à la créature, avec l’assistance de l’Esprit-Saint pour la mettre en œuvre. En effet, seul, l’humain ne peut marcher dans le bien sans broncher, c’est la définition même du péché. Il appartient, en effet, à celui qui est bénéficiaire de cette vertu -soit tout être racheté par le christ – de la faire croître et porter du fruit. C’est le chemin de la douceur à cultiver. À travers l’exemple de Thérèse de Lisieux, De Beauregard montre que ce combat est difficile, même s’il paraît aisé vu de l’extérieur. La douceur n’est donc pas une grâce innée, mais un chemin de travail. Mais ce travail, souvent douloureux, se traduit par un progrès et une joie qui surpasse largement les douleurs de la lutte.
De la vertu, on passe quasiment naturellement à la sainteté. La douceur est la voie de la sainteté. Là encore, le mot est piégé : notre auteur parle là des personnes canonisées par l’institution, alors que le bibliste paulinien sait bien que ce terme s’applique, par son étymologie du « mis à part », à tous les croyants. Nous sommes tous des saints du Nouveau Testament, et nous avons tous à emprunter le chemin de la douceur, même si beaucoup d’entre nous n’ont aucune envie de voir leurs noms dans le calendrier. La lutte est infinie sur cette terre, car les occasions de chute sont multiples :
« La focalisation sur les péchés de chair, certes graves mais surtout plus culpabilisants, risque d’obnubiler la conscience et de la rendre aveugle à d’autres péchés qui peuvent être plus importants comme l’orgueil, le refus de pardonner les offenses, la négligence dans la relation à Dieu, l’absence de souci des pauvres et des petits ou le manque de serviabilité au quotidien. » (P. 118).
Je suis tout à fait d’accord avec cet avis, il faut rappeler que c’est l’Église romaine qui a établi la hiérarchie des péchés et a rendu culpabilisants les péchés de chair par son centrage exclusif sur ceux-ci. La lecture de l’enseignement du Chris ramène à une doctrine bien plus saine du péché.
Dans cette lutte du péché, le dominicain va exposer deux théories sur la manière de combattre et vaincre le péché, donc d’avancer sur le chemin de la sainteté ordinaire : la « loi de gradualité » et la « loi des seuils ».
La loi de gradualité a été promue par Jean-Paul II ; elle peut se résumer ainsi :
« La « loi de gradualité » est une pédagogie de la douceur au service du meilleur possible pour chacun à un moment donné. C’est la vertu des petits pas. » (P. 122).
Le père Régamey, dans un livre titré « Portrait spirituel du chrétien » (1963) pose une autre loi, celle des seuils.
« …il existe un type d’homme plus commun qu’on ne le croit qui dans un même domaine s’avère incapable d’un petit effort, mais peut se révéler parfaitement capable d’un effort bien plus important si on le lui demande ou qu’il se convainc lui-même de le faire. » (P. 122).
Ces deux démarches se complètent et ne s’opposent pas. Il s’agit seulement de bien savoir fixer le seuil acceptable. Dans les deux cas, le but est de progresser dans la douceur. Toute la difficulté consiste à ne pas prendre pour travail de l’Esprit-Saint ce qui n’est qu’émotion sentimentale. Et ce n’est pas facile !
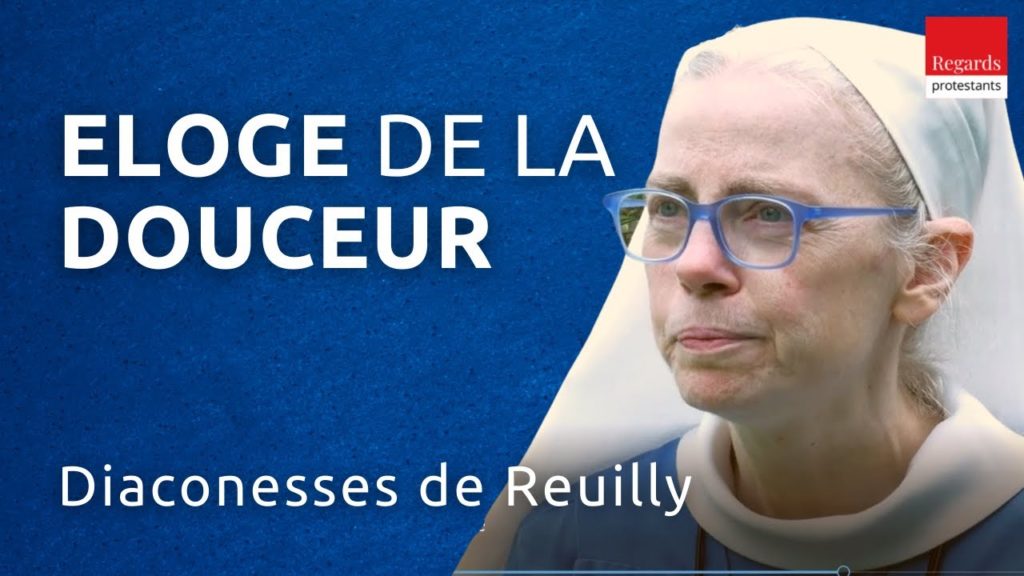
Pour voir cette vidéo: https://youtu.be/v0GQYUX_Drg
Le livre s’achève par un chapitre qui se veut une série de conseils pratiques pour développer la douceur. On se doute bien que ce n’est pas le plus facile à écrire ; tant que l’on reste dans un discours pastoral général ou théologique, on avance dans un cadre balisé par tous les grands ancêtres, on peut toujours trouver tel ou tel passage d’Augustin, Irénée ou Thomas qui vienne servir d’appui. Mais lorsqu’il s’agit de donner des pistes pratiques, l’auteur avance en terrain vierge et découvert. Là, le piège est de ne pas tomber dans le traité de « développement personnel », ce gloubi-boulga qui encombre les rayonnages des librairies et fait leur chiffre d’affaires. Un chrétien expérimenté saura d’entrée que les conseils seront peu nombreux et empreints de généralités. C’est obligatoire pour rester dans la pastorale.
Le frère De Beauregard s’en tire plutôt bien. Il commence par faire un état des lieux de la violence du monde contemporain, en le rapportant au cadre familial et à la société d’individualisme narcissique forcené qui est la nôtre. C’est en effet à partir de ce qu’est le monde où vit tout chrétien qu’il faut trouver le chemin de la douceur et la manière de la vivre. L’auteur reconnaît que la douceur ne procède pas de nous seuls :
« La douceur est donc une vertu ou bien reçue – de Dieu – ou bien acquise – par l’effort _ et le plus souvent un mélange des deux. » (P. 141).
En acceptant cette dualité, le chemin va se trouver tracé avec deux voies concomitantes : celle qui nous tourne vers Dieu pour la réception et l’entretien de cette grâce et celle qui nous tourne vers nos frères pour la mise en œuvre par l’effort personnel de la douceur envers le prochain.
Le premier chemin use des moyens de salut et de grâce, au premier chef la prière. Le dominicain fait ainsi l’éloge du chapelet, associant Jésus et Marie comme modèles de douceur[3]. Nous nous contenterons donc de prendre appui, comme il le fait plus loin, sur François de Salles qui recommande chaque matin de prier Dieu à ce sujet. Un peu plus loin, il cite Paul en Philippiens 4 : 6-7 :
« …mais en tout besoin recourez à l’oraison et à la prière, pénétrées d’action de grâces, pour présenter vos requêtes à Dieu. 7 Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées, dans le Christ Jésus. »
La paix que Dieu donne au chrétien qui le prie est la condition sine qua non de la douceur. Mais cette douceur n’exclut pas la colère :
« La douceur à l’égard d’autrui n’exclut pas la juste colère, qui a ses lettres de noblesse jusque dans l’Ecriture Sainte. » (P. 146.
C’est de cette colère que Lytta Basset (théologienne protestante) a tiré un livre fort éclairant, Sainte colère, que je recommande à mon lecteur. Il faut rester fortement indigné par tout ce qui est injuste et mauvais. L’auteur fait allusion au petit libelle de Stéphane Hessel, Indignez-vous, très célèbre en son temps, qui posait le devoir d’indignation comme force civique. Le chrétien a aussi ce devoir de sainte colère, à condition de rester dans la sainteté du cadrage. Ce que l’auteur traduit ainsi :
« Autrement dit il convient de ne laisser la colère s’exprimer qu’en dernier recours et jamais comme exutoire ni sans la régulation de la raison. » (P. 151).
Il s’agit donc de trouver le bon équilibre entre la douceur et l’indignation, voire la colère. Pour ce faire, l’homme dispose de moyens naturels (ses ressources propres et celles de l’humanité) et de moyens surnaturels (ceux de Dieu et de l’Esprit-Saint). C’est uniquement en les combinant que le chemin de la douceur évangélique est possible à emprunter. Donnons une dernière fois la parole à l’auteur :
« Les moyens surnaturels doivent être posés en préalable à l’examen des moyens naturels. Et tout d’abord la fréquentation des sacrements, la lecture de la Parole de Dieu, la prière du chapelet, ma méditation des mystères de la vie du Christ ainsi que la contemplation de la douceur des Trois Personnes de la Sainte Trinité. Sont nécessaires également l’adoration eucharistique et l’oraison, ainsi que la lecture de la vie des saints. Les Pères de l’Église y ajouteraient la considération fréquente de nos propres péchés, qui nous détourne de la colère à l’égard des péchés d’autrui. Moins envisagée par les auteurs antiques, l’autodérision, qui désarme la colère à l’égard du prochain avec souvent plus d’efficacité que la considération des péchés personnels. » (P. 154).
Je ne reprendrai pas ici mes remarques restrictives sur certains moyens indiqués. Mais je puis valider la démarche d’ensemble qui est proposée, car elle repose sur les deux jambes de la marche chrétienne : le surnaturel de Dieu et le naturel humain.
À la longueur de cet essai, le lecteur aura compris que je considère ce livre comme un travail important sur un sujet assez peu travaillé en théologie. Il comprendra aussi que mes remarques critiques de protestant sont destinées à poser les bases d’un œcuménisme réel, qui ne tente pas de gommer les aspérités, mais se vit malgré elles.
Jean-Michel Dauriac – Les Bordes – août 2025.
[1] L’auteur, pour justifier la pertinence des sacrements passe par LA référence incontournable, Thomas d’Aquin et cite une analogie corporelle développée par le « docteur angélique », pages 86-87. Hormis la poésie du texte, je ne suis guère convaincu par la démonstration !
[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Concorde_de_Leuenberg donne l’histoire de ce texte, https://infocatho.cef.fr/fichiers_html/oecumenisme/uniteaccords/accordleunberg.html pour le texte lui-même, sur le site d’information catholique officiel. Il semblerait donc utile que les dominicains se rangent sous la bannière de leur propre église.
[3] Le théologien protestant est encore obligé de signaler que mettre sur le même plan Jésus et Marie est une prouesse extrabiblique qu’il ne saurait valider.
Leave a Comment