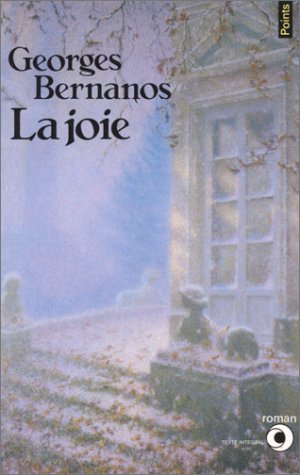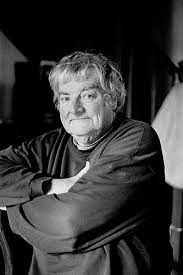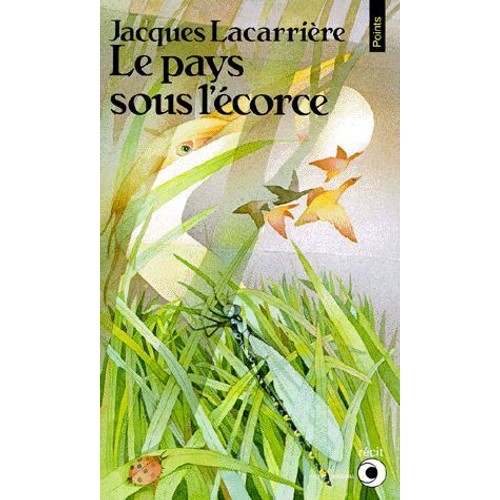La joie est un roman âpre. Le titre est une antiphrase dont le lecteur découvre le sens en avançant dans l’histoire. Car, au commencement, est la joie pure. Mais très vite le ciel s’obscurcit peu à peu et, chapitre après chapitre, devient de plus en plus sombre. Cependant, le dénouement surprend quand même, car on ne pensait pas que l’auteur oserait aller jusque là.
Ce livre, comme toujours chez Bernanos, est à dimension spirituelle : le mal et le bien s’y affrontent tout du long. De fait, il s’agit d’un roman sur la sainteté et la médiocrité, entendue ici comme le contraire de la sainteté, soit en termes religieux, l’état du pécheur. Mais cette médiocrité est à double signification ; en effet, les protagonistes médiocres le sont aussi au plan personnel, en dehors de leur état peccamineux, comme dit l’Eglise, qui n’a pas peur des gros mots ! Il y a d’abord le cadre, unité de lieu absolue, qui finit par devenir une chape de plomb sur l’héroïne, cette maison de campagne cossue qui sert de résidence estivale. L’héroïne, parlons-en justement. C’est une jeune fille de bonne famille, de dix-sept ans, orpheline de mère, vivant avec son père, intellectuel d’une certaine renommée. Cette jeune fille assume les fonctions de maîtresse de maison et de surveillante de son père, sans donner à ce terme un sens dépréciatif. Elle se soucie constamment de son père, qui apparaît comme un être nerveusement très fragile. Chantal, c’est le nom de la jeune fille, illumine la première partie du roman de sa joie et de sa sainteté inconsciente. Elle survole les problèmes, s’occupe de tous et agit envers chacun avec l’amour évangélique du Christ. Son père, Monsieur de Clergerie, poursuit un unique but : être élu à l’Académie, ce pour quoi il dépense depuis des années une énergie folle et des trésors de stratégie. Autour du père et de la fille gravitent des personnages de deux types : les amis de la famille, habitués de cette maison de vacances campagnarde, et la domesticité. Le roman passe d’un type à l’autre, selon les besoins de l’avancée de l’intrigue.
Mais y-a-t-il vraiment intrigue ? Celui qui cherche un roman « romanesque » sera très déçu : ce n’est pas le genre de la maison Bernanos. L’intrigue se réduit à quelques jours de la vie de cette maison, sans aucun événement extraordinaire. Au contraire, l’auteur ramène tout à un quotidien banal et, somme toute, très répétitif. Ce ne sont donc nullement les actions des protagonistes qui intéressent notre écrivain, mais bien plutôt leurs pensées et leurs dires. Comme Sous le soleil de Satan, tout se joue en quelques rencontres et dans des échanges qu’il faut savoir décrypter. Autant dire d’emblée que ce n’est pas un livre facile, pas le genre de roman à apporter à la plage. Il faut souvent relire les paragraphes pour en saisir tout le contenu. Cela est en grande partie dû au style de Bernanos. Il écrit de manière massive, dense et, parfois, lourde. Il creuse son idée comme Rodin creusait la matière. Il ne donne au lecteur aucune facilité. Tu me suis ou te refermes le livre, mais je ne vais pas édulcorer mes propos ! C’est que l’enjeu est colossal. Il s’agit, au travers de Chantal de tenter d’approcher in situ le mystère de la sainteté en action. Du côté de cette jeune fille, on pourrait dire que, dans la première partie, le style de Bernanos est assez lumineux, comme son sujet. Il arrive tout à fait à nous donner à voir une jeune fille vivant l’amour du Christ naturellement, toute habitée par le souvenir de son mentor spirituel , l’abbé Chevances, lui-même un saint homme, mort très récemment, et que Chantal a accompagné jusqu’au bout. Ces deux-là sont le tandem de la sainteté. Bernanos ne la refuse pas au prêtre, mais on sent bien que ce n’est pas à l’Eglise qu’il en accorde la grâce, mais à la vie de chaque croyant. En contrepoint de cet abbé disparu mais omniprésent, il nous offre un autre religieux, l’abbé Cénabre, un penseur reconnu, mais dont la vie spirituelle s’avèrera vide. Un saint prêtre d’un côté, un érudit desséché dans sa foi de l’autre. On sait évidemment très vite vers lequel va la préférence de l’auteur. La seconde partie du roman nous dévoile une longue scène de face-à-face entre la jeune fille et le vieux prêtre désabusé, dont il faut relire plusieurs fois les échanges pour saisir la tension de ce qui se joue ici. On retrouve là l’opposition déjà rencontrée dans Sous le soleil de Satan entre deux conceptions du ministère de prêtre. Chantal de Clergerie se trouve prise entre des forces contradictoires qu’elle a cru pouvoir contenir et qui, soudain, la déstabilisent. Mais le mal est présent sous les traits du chauffeur russe, Fiodor. Le lecteur saisit bien toute l’ambiguïté du personnage, mais Bernanos n’est jamais vraiment explicite et nous devons donc essayer deviner ce qu’il en est de cet homme et de ses mensonges permanents. Toujours est-il qu’il apparaît comme fasciné par Chantal. On le suit à travers le roman, présent même quand il n’est pas là, tant il trouble même la domesticité. La vraie question est la nature de sa fascination : est-il remis en question par la sainteté ou s’agit-il de la contemplation de la victime innocente ? Nous l’ignorerons jusqu’à la fin, mais ils seront réunis pour toujours dans la mort, sans que nous sachions vraiment pourquoi et comment. La porte est ouverte à de multiples interprétations. Je crois qu’il faut se garder d’aller trop loin dans ce chemin, puisque Bernanos ne nous a pas fourni de clés pour toutes les portes.
La médiocrité triomphe de la sainteté, au moins de manière terrestre. Mais qu’en est-il après ? A chaque lecteur de se poser la question et d’y apporter sa réponse.
Cet âpre roman s’avère aussi être un roman amer dont le goût ne passe pas. Le coup de théâtre final nous laisse interloqués. Pourquoi fallait-il que cette jeune fille meure ? Pourquoi Fiodor l’a-t-il tué avant de se suicider ? La réponse est à construire avec le retour nécessaire sur les scènes antérieures. Où était la faiblesse cette jeune sainte ? Qui est responsable ? Son père, l’abbé Cénabre, le docteur La Pérouse ? Le criminel est Fiodor, certes, mais ce n’est pas lui le responsable. Tout autour de la sainteté joyeuse de Chantal les médiocres se sont ligués, eux qui ne connaissaient ni la joie, ni la grâce, ni la paix, ni l’innocence. Il n’y a pas de place pour les saints dans un monde d’ambitions et de petitesses humaines.
J’ai dit plus haut que le style de ce roman était massif et parfois lourd, à la limite de l’ennui. C’est que Bernanos se moque de « faire du style » ; ce qui l’intéresse uniquement c’est la compréhension psychologique de ses personnages et leurs états d’âme au sens religieux du terme. La frontière entre le saint est le médiocre est tracée par ces « états d’âme », expression magnifique souvent rendue péjorative. Le chrétien, pour Bernanos, est celui qui se préoccupe de son âme et de l’âme des autres : Chantal était de ceux-là, comme l’abbé Chevances. Pour avoir des « états d’âme », il faut savoir que l’on a une âme. Le cas du psychiatre est tout à fait emblématique de ce que le matérialisme fait quand il veut ignorer l’âme. Le docteur La Pérouse, qui fut un grand psychiatre est sur le déclin personnel (sans doute atteint d’un début de Parkinson) et refuse de le voir. Il veut ramener toute personne à un « cas ». mais Chantal lui est proprement incompréhensible et elle le lui fait bien comprendre. A travers ce portrait de médecin, on retrouve la plume enflammée du Bernanos pamphlétaire et combattant. La description de la personnalité du docteur est d’une rosserie talentueuse, tout comme le portrait initial de Monsieur de Clergerie. Dans ces lignes nous avons le meilleur Bernanos, celui qui frappe ce qu’il combat : la bêtise, la suffisance, la fausse science… Il est évidemment dommage que tout le roman ne reste pas à ce niveau littéraire. Mais est-ce possible ?
Lire La joie est à la fois un grand plaisir et un effort. Ce n’est pas un livre facile, mais cependant un bon livre, dans le sens où il nous marque à jamais, nous remet en question et, une fois refermé, continue de nous tarabuster. Il faut l’accepter tel qu’il est pour l’apprécier. Pour ma part, je préfèrerais toujours un livre qui se gagne de haute lutte à un livre qui se prostitue dans la facilité pour me séduire. Après tout, qui a dit que la lecture de Madame Bovary ou de L’insoutenable légèreté de l’être était facile ? Ne sont-ce pas d’immenses romans ? Il y a un temps pour tout, un temps pour des lectures faciles et un temps pour des livres robustes qui se défendent.
A bon lecteur, salut !
Jean-Michel Dauriac
Les Bordes 10-11 août 2022
Leave a Comment