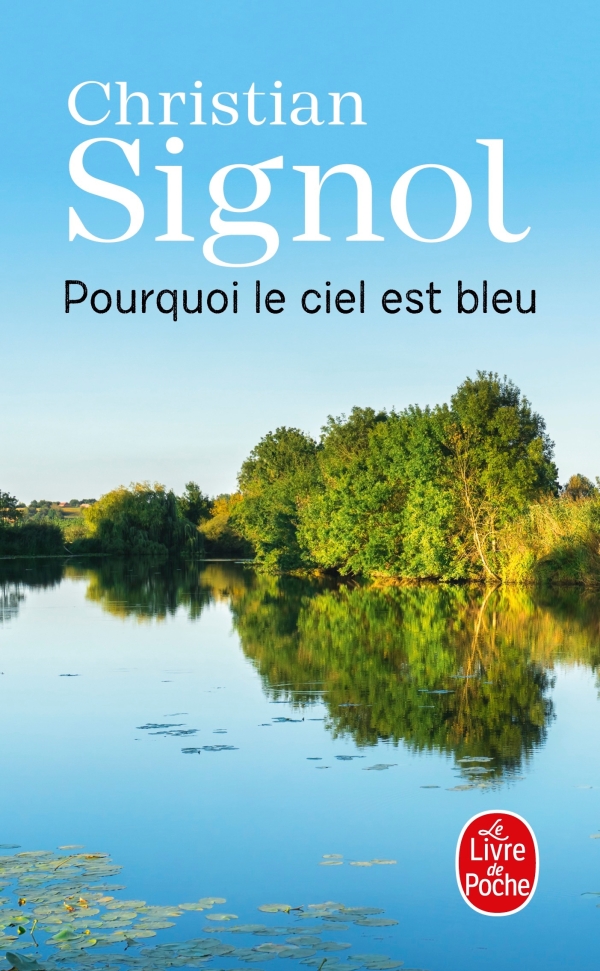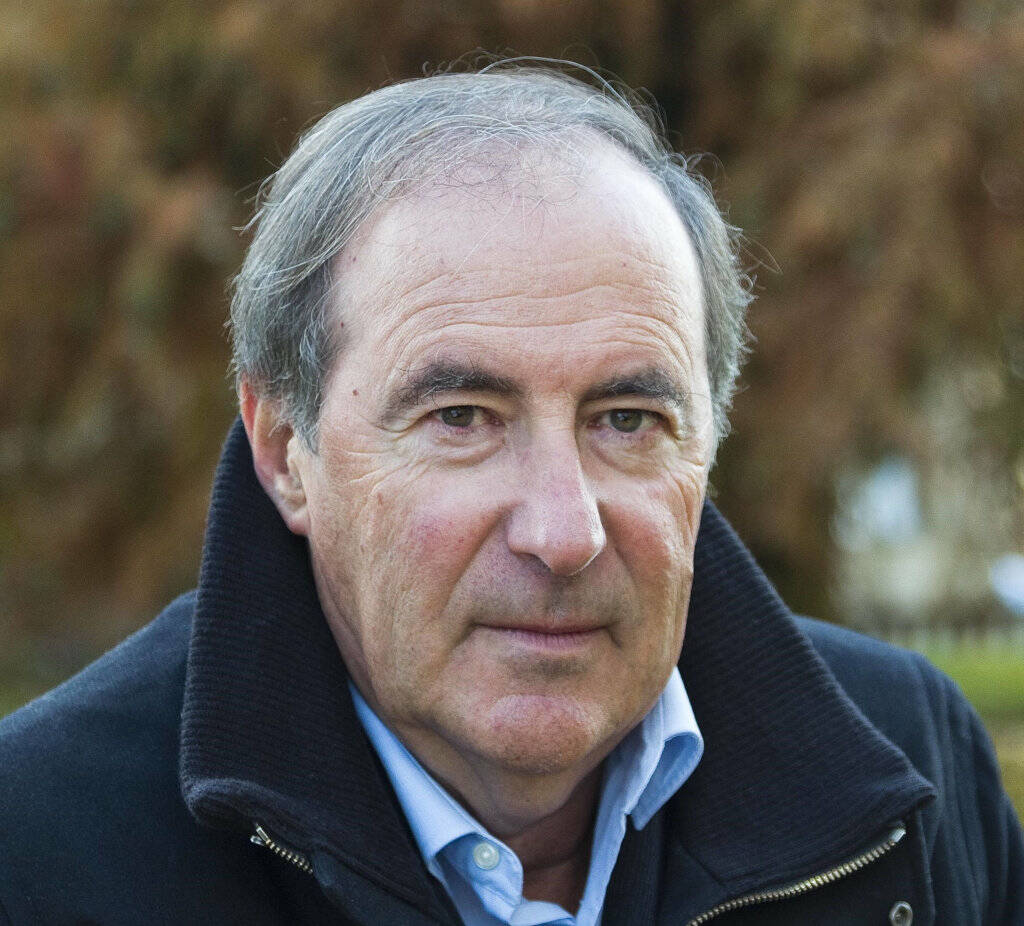Le spectacle de la basse-cour médiatique et artistique se déchirant à plaisir autour du nom et de la personne de Gérard Depardieu est proprement insensé pour le commun des Français[1].
Voici notre plus grand acteur vivant – spécialiste des frasques de mauvais goût, genre uriner dans un avion hors de toilettes -, est accusé de violences à caractère sexuelles par plusieurs femmes actrices ou du monde du spectacle. En soi, une énième affaire à démêler pour les juges d’instruction. Mais hélas, l’accusé n’est pas Clampin-Dupont, mais Depardieu. Lequel, entre plusieurs énormes défauts, a celui d’être l’ami de Poutine, ce qui, depuis que nous sommes en guerre aux côtés de l’Ukraine[2], est un crime de haute-trahison. Ces affaires tombent donc au mieux pour le déboulonner définitivement (to cancel en anglais, « effacer », selon la liturgie woke).
Nous assistons donc depuis quelques semaines à d’interminables débats sur les chaînes télévisées, avec des (inter)minables protagonistes, venus se faire mousser à peu de frais. Là-dessus, une émission de grand reportage diffuse des images où notre Gégé national tient des propos orduriers sur les femmes cavalières, les selles et les chevaux. Et la Révolution est en marche !
Je suis tout à fait outré par ces propos, sans doute accompagnés d’un fort taux d’alcoolémie, ce qui ne les excuse nullement. Mais, quoiqu’en disent les procureurs improvisés du tribunal révolutionnaire médiatique, ces propos ne sont ni un délit, ni un crime, simplement une faute morale[3].
Le président Macron, venu faire son SAV sur une des chaînes publiques, a eu le tort de répondre à une question sur ce sujet. Lui qui se croit si doué pour la parole a été pris au piège de l’amplificateur médiatique. Ce qu’il a dit est tout à fait vrai et inattaquable : il existe une présomption d’innocence qui ne saurait être retirée à Depardieu. Il faut donc laisser la justice faire sereinement son travail d’investigation. Aussitôt, il fut accusé de soutenir l’acteur et de mépriser la souffrance des victimes[4].
Quelques jours plus tard, une lettre ouverte signée par 50 personnalités du milieu du spectacle[5] dit exactement la même chose, et seulement cela. Par ricochet, le malheureux Pierre Richard, signataire de ce manifeste, jeune homme de 89 ans, est exclu de l’ONG de lutte contre les violences faites aux enfants, dont il était l’ambassadeur, car il a « soutenu un violeur ».
Nous assistons à un emballement de types woke, c’est-à-dire de négation de tout ce qui est la civilisation blanche occidentale, en l’occurrence ici, la justice et l’Etat de Droit. Il est à craindre que cette chasse aux fausses sorcières ne continue dans les semaines à venir, puisqu’une pétition signée cette fois par des centaines d’artistes (souvent sortis de nulle part et rabattus de toute l’Europe) soutient que les cinquante premiers sont des complices du violeur.
Cela me pose un réel problème de « civilisation ». En effet, ou bien tous ces chiens de garde haineux ne savent pas le sens des mots et sont donc incultes ou ignares, ou les deux à la fois ; ou bien ils ne lisent qu’avec leurs propres lunettes, dans un univers parallèle, celui qui dézingue les crèches, les statues des personnages historiques, qui interdit les conférences critiques, etc… Dans les deux cas, c’est grave.
Depardieu est un citoyen français (pour combien de temps encore, car on pourrait l’en déchoir !) qui a droit de faire appel à une justice indépendante et le devoir d’en accepter le verdict. Pour l’heure, nous n’avons ni l’un ni l’autre. Il faut donc essayer de revenir à la raison. Laissons la machine judiciaire faire son travail. Respectons la procédure et la présomption d’innocence et renvoyons les loups à leurs tanières en les méprisant, eux et leurs pratiques. Si Depardieu est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il sera alors temps de considérer la situation et de prendre des mesures éventuelles, au niveau moral national, et chacun pourra asseoir sa position sur des faits avérés.
J’aimerais rappeler que, dans un contexte assez semblable de furia médiatique et de trahisons honteuses de ses amis, un homme a vu son honneur bafoué et sa vie saccagé, il en est mort : il s’appelait Dominique Baudis. Memento Mori.
Jean-Michel Dauriac – 31 décembre 2023
[1] Il ne faudrait pas confondre le microcosme artistique de Paris avec la France réelle ; dans le cas qui nous intéresse, je suis certain que la photographie de l’opinion serait très différente.
[2] Cette phrase devrait faire bondir de fureur les gens de bon sens, car nous n’avons pas à mener une guerre qui ne nous concerne pas et qui va coûter une fortune aux contribuables français, n’en déplaise à l’acteur-manipulateur Zélenski.
[3] Comportement affreux qui est souvent l’apanage des puissants et de leurs féaux, y compris parmi ceux qui crient bien fort aujourd’hui « Au loup ! ».
[4] L’idéologie victimaire est devenue hégémonique : tout le monde doit pouvoir être victimisé, sauf le mâle blanc de moins de cinquante ans. C’est un des aspects du wokisme, qui rassemble pêle-mêle vraies victimes et victimes imaginaires qui relèvent de la psychiatrie.
[5] Publiée dans les pages Débats du Figaro.
Leave a Comment