Gilbert Cesbron – Oeuvres romanesques complètes – Editions Rencontre, Genève – 1re édition 1947.
Je commence ici un cycle d’articles critiques sur l’oeuvre romanesque de Gilbert Cesborn, à partir de l’ensemble publié par les Editions Rencontre dans les années 1970. Ce corpus s’enrichira au fur et à mesure de mes lectures et pourrait, à terme, devenir un petit essai sur cet auteur.
* * * * * * *
On pourrait qualifier ce roman de « roman de la noblesse provinciale et de la guerre ». Car ces deux éléments sont très étroitement tissés pour dessiner la toile de l’intrigue. D’un côté une famille de vieille noblesse provinciale, les Fontquernie, de l’autre le moment historique de la « Drôle de guerre » de 1940 et l’attaque-éclair des Allemands.
Mais il serait faux de croire que nous sommes face à un roman à thèse. Il s’agit bel et bien d’un destin romanesque, celui d’Antoine de Fontquernie, le petit dernier d’une fratrie de trois. Hubert est l’aîné, Gérard le puîné et Antoine le cadet. Ils sont très différents ; les deux aînés sont sportifs, virils et parfaitement inscrits dans la tradition aristocratique que comte, leur père leur a inculquée. Antoine est peu porté sur les sports et la virilité seigneuriale. Il entretient avec sa mère, Catherine, une relation fusionnelle dont nous ne comprendrons la nature que lors du dénouement. Il l’appelle « Mammy », et parfois « ma chérie », ce que son père réprouve fermement. Ainsi est posée la distribution de ce drame. Le décor est essentiellement en deux tableaux : Le château de Fontquernie et « Sciences Po Paris ». Antoine se partage entre ces deux lieux, où il est assez différent. A Paris, il est le marginal doué qui sortira major du concours final, l’aristocrate à la fois un peu cynique et l’étudiant provocateur. Il est admiré de ses camarades, dont certains sont des amis proches. Il y a aussi des jeunes filles qui gravitent autour des différents clans inévitables. Mais pour Antoine, il n’y en a qu’une : Isabelle. L’histoire de la naissance compliquée de leur amour parcourt tout le roman. Mais Antoine rend cet amour difficile, car il refuse de se livrer et cache ses sentiments, sauf à de rares moments. Toute une partie du roman donne à voir la vie de ces étudiants de milieux privilégiés que sont les pensionnaires de l’Ecole des Sciences Politiques de paris, en 1940.
Car c’est bien cette date qui est le noeud gordien du roman. Depuis septembre 1939, la France est officiellement en guerre contre l’Allemagne du IIIe Reich, mais rien en se passe. C’est que les historiens ont baptisé la « Drôle de guerre », durant laquelle les soldats mobilisés sur les fronts de l’Est (la fameuse et coûteuse ligne Maginot) jouent aux cartes et au football pour tuer le temps faute d’ennemis. Les trois fils Fontquernie sont mobilisables, mais n’ont pas encore été appelés. La menace plane sur la maison, dès les premières lignes du livre. Les deux aînés se plaignent d’être appelés dans des postes loin du front, car ils brûlent du désir de se battre, au moins pour maintenir la gloire et la tradition de leur nom. Antoine ne sait pas ce qu’il adviendra de lui.
Quand Antoine vit à Paris, il est, malgré lui, obligé de rentrer dans le jeu de la vie étudiante. Ce sont les réunions dans les bistros autour de l’école, chez certains des élèves. C’est un étalage de valeurs bourgeoises, plus ou moins tapageuses. A travers ces fils et filles de …, Cesbron brosse un portrait assez impitoyable de cette classe bourgeoise parisienne. Les rejetons ne sont que les continuateurs de leurs géniteurs, les sarments du cep. Cesbron donne ainsi à voir un échantillonnage du public : il y a le fils de l’homme d‘affaire juif, soucieux plus que d’autres d’affirmer son amour de la France, les enfants des grands bourgeois parisiens, le fils d’une modeste femme du peuple dont il a presque honte… Mais l’auteur a suffisamment de talent pour que cela ne soit pas un catalogue rébarbatif ou une démonstration politique. Ces portraits viennent naturellement au cours de l’action. Avec une maitrise certaine, l’auteur entretient l’ambiguïté sur les sentiments profonds d’Antoine sur la formation qu’il suit et où il réussit très bien. Fait-il Sciences Po par envie personnelle ou par tradition familiale ? Nous ne le saurons jamais. De même est-il clair dès le début qu’il est amoureux d’Isabelle, mais tout au long du livre il laisse planer un voile trouble sur leur relation. Finalement, cette indécision n’est-elle pas un des traits de caractères dominants d’Antoine, pour en pas dire le principal ? A chaque lecteur de le ressentir à sa façon. C’est là la force irremplaçable de la lecture : le même livre peut être interprété très différemment selon les lecteurs, et même selon les moments où nous le lisons.
Quand Antoine est à Fontquernie, il est partagé, pour en pas dire déchiré entre son amour pour sa mère et le côté viril incarné par le père et le frère aîné, Hubert. Il semble ne pas aimer ce grand frère, trop différent de lui. Mais il ne peut s’empêcher de le prendre comme référence, dès qu’il a un choix à faire. Evidemment, le fait qu’Hubert ait embrassé Isabelle et tenté de la séduire lors de son séjour au château n’arrangera pas les choses. Pourtant Isabelle saura prendre ses distances envers Hubert et réaffirmer à Antoine son amour indéfectible. Malgré cela, rien n’est simple, jusqu’au bout.
Le roman bascule lorsque la guerre revient rebattre les cartes. Antoine est appelé et incorporé à une unit qui va au combat dans le nord de la France, alors que les deux aînés sont relativement « planqués ». Nous ne saurons absolument rien de ce qui se passe sur le champ de bataille. Ce n’est pas un roman de guerre, mais sur la guerre. Pendant ce temps, à Fontquernie, un événement qui eut pu être ordinaire, la mort d’un voisin, ami de la famille, vient provoquer un séisme. Au travers de péripéties à découvrir par le lecteur, le Comte apprend que ce voisin, Théroignes, a été l’amant de sa femme et l’a toujours aimée ; il comprend ainsi qu’Antoine est le fils de cette liaison.
Le drame se noue donc sur ses deux axes : Antoine à la guerre et la découverte de l’infidélité de la comtesse. Pour la guerre, le dénouement est extrêmement abrupt : un courrier apprend à la famille qu’Antoine est mort au combat. On imagine sans difficulté le chagrin de la mère. Mais en même temps, le Comte doit gérer ce qu’il a appris. C’est ici que le terme « tradition Fontquernie » va prendre tout son sens. D’une part, la mort d’Antoine s’inscrit, malheureusement dans une longue suite de vies données à la patrie par la famille, d’autre part, le Comte va affronter cette double peine avec honneur, selon la même tradition, sans faire de scandale, en considérant Antoine comme son fils jusque dans sa mort.
Cet aperçu rapide permet de saisir la complexité des sentiments en jeu dans le livre. De facto, ce n’est pas un livre joyeux. C’est vraiment un drame familial. S’y superpose cet honneur aristocratique qui peut à la fois compliquer et surmonter les situations tragiques. Gilbert Cesbron écrit cette histoire dans un style souple, extrêmement facile à lire, emportant le lecteur de chapitre en chapitre. Dès ce premier roman, il a trouvé ce style qui le rendra très populaire durant des décennies dans le lectorat français. Il sait aussi se mettre en position de narrateur objectif, prenant du recul.
Jusqu’où peut aller le devoir ? A-t-on le droit d’imposer à ses enfants des principes d’un autre temps ? Ces questions sous-tendent tout le roman. La grande force de l’auteur est de ne jamais pontifier ni donner des leçons. Ce sont ses personnages qui nous font vivre les dilemmes dont il est question. Le personnage du Comte, par exemple, n’est pas le principal dans la trame narrative, mais il est celui qui donne le la des comportements, en positif comme en négatif. Ses fils se définissent par rapport à son exemple. Antoine n’est pas du tout à l’aise dans ce rôle d’héritier de la tradition Fontquernie, mais il ne peut s’affranchir de la marque du père, alors que les deux aînés se sont fondus, au moins apparemment, dans cette tradition. Le paradoxe est que celui qui accomplira un vrai destin Fontquernie est le bâtard, celui qui n’a pas une seule goutte de sang bleu dans les veines. L’ a-t-il choisi ? Nous n’en saurons rien. Le père, au nom de cet héritage aristocratique, gardera pour lui la douleur de son infortune, submergée par celle de la perte de cet enfant qu’il veut dorénavant garder comme fils aux yeux de tous. Y-aura-t-il une explication entre le Comte et sa femme ? C’est au lecteur d’imaginer la suite. La logique du récit penche dans le sens d’une réponse négative.
Que penser de ces traditions aristocratiques ? Dans une république comme la France, elles sont un vestige d’une époque que la Révolution a définitivement changée. Mais pour les aristocrates, elles sont leur dernier signe de distinction pour s’élever au-dessus des roturiers. Mourir à la guerre semble être pour eux un devoir de caste, avec un garde d’officier. Mais même cela est obsolète : dans le Second conflit mondial, l’héroïsme a été le fait de gens du peuple, de paysans, d’ouvriers, de mères de famille… Lire ce roman aujourd’hui est encore plus étranger à nos mœurs qu’au moment de sa publication. Cependant, la déliquescence morale actuelle devrait nous inciter à considérer au moins avec estime de tels sentiments. Tenir sa patrie comme méritant que l’on donne sa vie pour elle signifie que l’on s’inscrit dans un collectif, ce que Renan appelait une nation. C’est comme rester debout face à la peste, tel Rieux dans le roman de Camus. Pour quoi sommes-nous prêts à mourir aujourd’hui ? Pour notre Rollex, notre Tesla ou notre droit à consommer?
Gilbert Cesbron ne moralise pas, il ne juge jamais ses personnages. Il nous laisse cette responsabilité ; il se contente de les faire vivre devant nous. En refermant ce beau roman, les questions continuent de nous travailler : voici la preuve d’une bonne littérature.
Jean-Michel Dauriac – Avril 2024


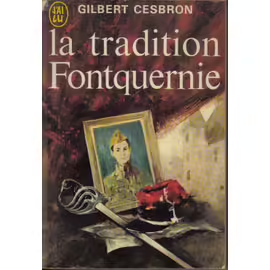
Comments