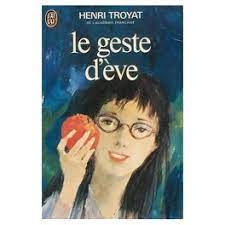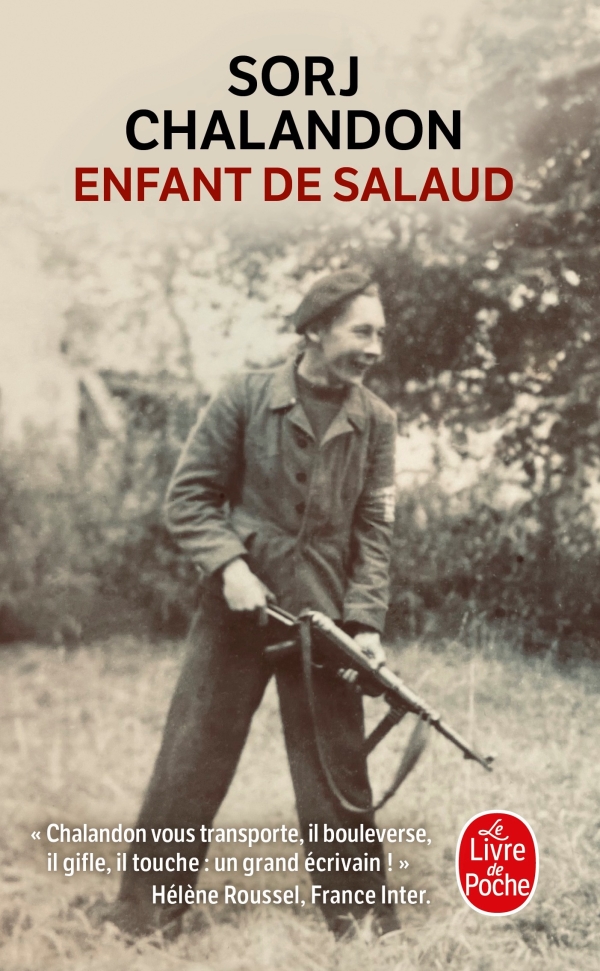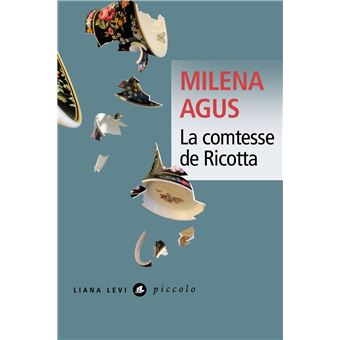J’ai lu – 1974 (1re édition, Flammarion, 1964)
Tout petit volume de 127 pages, ce livre est un recueil de nouvelles. Tout le monde sait que Troyat est né russe, avant de devenir un grand écrivain français et un immortel de l’Académie française. Les Russes sont des maîtres de la nouvelle, cet art si difficile. Beaucoup considèrent que Anton Tchekhov en est le prince. Mais il ne faut pas oublier tous les autres écrivains de talent qui ont excellé dans cet exercice. Citons seulement quelques-uns d’entre eux : Ivan Bounine, Léon Tolstoï, Alexandre Soljenitsyne ou Nicolas Gogol. Troyat ne dépare pas cette liste.
Henri Troyat
Bien sûr, Henri Troyat est surtout connu pour ces cycles romanesques de grande envergure (Les héritiers de l’avenir ou Les semailles et les moissons, par exemple) ou ses biographies très détaillées (son Tolstoï est excellent !). Il est assez aisé d’imaginer que la nouvelle est une récréation, une pause entre deux romans. Mais ce n’est pas un aspect mineur de son œuvre : il en maîtrise totalement l’art.
Il n’y a pas, à proprement parler, de thème commun à ces courts textes. Cependant, il faut noter que sur les neuf nouvelles, cinq s’achèvent par la mort du protagoniste . Il y a donc une dominante tragique. Et pourtant ce n’est pas ce que l’on retient de ces récits. C’est plutôt l’absurde et le ridicule qui l’emportent, incarnés par des héros médiocres qui meurent médiocrement. Tous ces récits sont contemporains, datés de la décennie 1960. Les personnages sont des « Français moyens », comme on le disait alors, à une ou deux exceptions sociales près.
Dans ces récits, le fantastique peut faire irruption à tout moment, ce qui ne peut que surprendre les lecteurs français cartésiens, pour lesquels H. Troyat n’est pas un auteur de littérature fantastique, mais un auteur « sérieux ». C’est, encore une fois, oublier son atavisme russe. Les Russes ont un rapport au surnaturel (nom religieux du fantastique) très différent du nôtre. Ils l’acceptent comme un fait inexplicable, mais pas impossible, alors que pour nous inexplicable veut dire impossible. Lisez, si vous en avez l’occasion, les contes populaires de Léon Tolstoï, vous y trouverez la démonstration de ce que je dis ici. Chez Troyat, le fantastique surprend d’autant plus qu’il n’est pas du tout annoncé par un climat, des indices ou des analogies. Il arrive brutalement, souvent pour mettre un terme à l’histoire – c’est le cas de trois nouvelles, Les mains, Bouboule et Faux marbre. Il provoque d’ailleurs plutôt le rire ou le sourire que la peur ou la perplexité. Comment pleurer ou être effrayé lorsqu’une vieille fille manucure trouve enfin son bonheur et épouse l’homme qui la rendra heureuse et que, dans une pirouette finale, l’auteur nous fait découvrir ses pieds à sabots, comme dans Les mains,
Plusieurs récits mettent en scène la petitesse des vies humaines et leur course absurde à la sérénité introuvable à ras-de- terre. C’est le cas de Le carnet vert, forme de folie dérivée de la cupidité, ou de Vue imprenable, sur la misanthropie et l’esprit obsessionnel. Quant à la nouvelle qui donne son titre au recueil et qui est présentée en dernière position, elle illustre bien la force du rêve et de l’autosuggestion, que le réel détruit imparablement.
Voici donc l’exemple parfait de la lecture récréative qui convient pour se détendre, pour voyager intelligent ou simplement s’éloigner du quotidien. Troyat a cet art sûr qui nous captive dès les premières lignes et ne nous lâche qu’au point final, avec regret. Lisez ces nouvelles, le livre se trouve pour trois fois rien sur la plus grande bouquinerie du monde, Internet, ou, par hasard, en fouillant dans une armoire à livres, comme moi.
Jean-Michel Dauriac – Les Bordes – Août 2023.
Leave a Comment