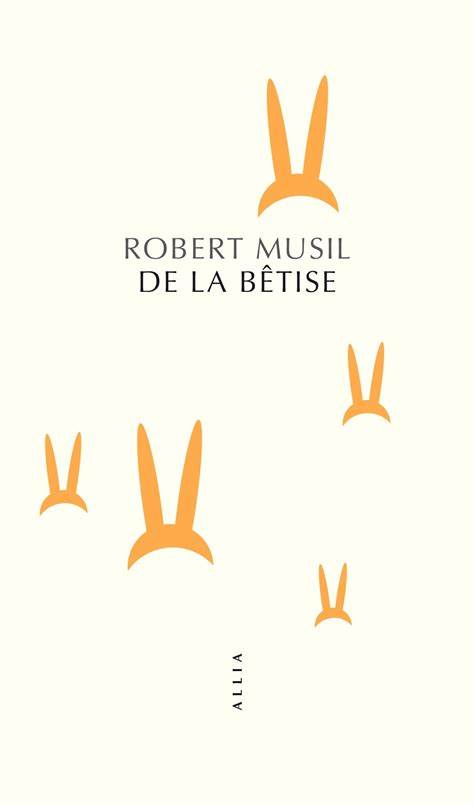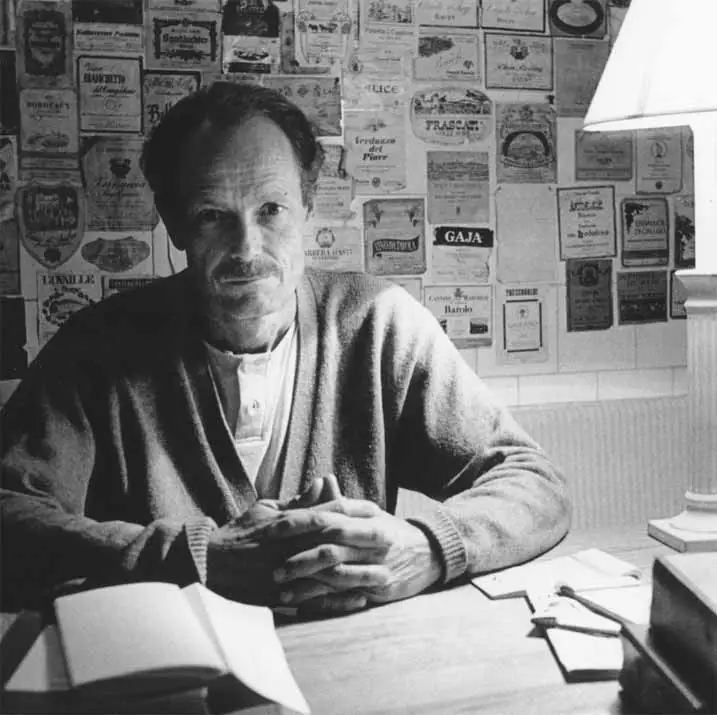Livre de poche – 1963
Comme beaucoup de gens de ma génération (les « baby boomers » !), j’ai vu le film qui porte ce titre plusieurs fois à la télévision. C’est un bon film de guerre avec une belle distribution (Grégory peck, David Niven, Anthony Quinn et Irène Papas enter autres) et une solide histoire, film de 1961, réalisé par un bon artisan d‘Hollywood, Jacques-Lee Thompson. Et j’ai cru que ce film relatait un épisode authentique de la Seconde Guerre Mondiale, comme Le jour le plus long, Un pont trop loin ou Tora, Tora, Tora… Ce conflit a en effet été le réservoir de très nombreux films des années 1950 à 1980, par le nombre de ses champs de bataille et ses nombreux épisodes dramatiques et héroïques. Jusqu’à ce que, il y a quelques jours, dans la boîte à livre du village d’Aigurande, jetant là un coup d’oeil, je ne trouve un ancien livre de poche – dont la couverture est reproduite ci-dessus – portant ce titre. J’avoue que j’ignorais son existence. Mais je connaissais celui de son auteur, Alistair Mac Lean, que j’avais vu à de nombreux génériques de films. Je renvoie mon lecteur à l’article wikipédia qui lui est consacré. D’où il ressort qu’il s’agit d’un auteur assez productif de romans souvent fondés sur son expérience de soldat durant le conflit mondial. Sauf dans le cas de L’ouragan vient de Navarone, qui est une suite au film considéré ici, tous les romans ont précédé les films, qui en sont des adaptations, souvent faites par l’écrivain lui-même. J’ai été intrigué par ce livre et je l’ai dévoré en deux jours, avec un très grand plaisir, celui d’une lecture d’ardeur quasi juvénile, de celles qui sont motivées par le plaisir d’avancer dans une histoire.
Dans l’article de wikipédia traitant du film, on peut lire ceci concernant l’accueil critique du film :
« C’est de l’image que naissent ici notre émotion, notre angoisse, notre soulagement, et finalement notre plaisir. Le texte n’a qu’une importance secondaire et, à l’extrême rigueur, pourrait être supprimé. Les caractères des personnages sont dessinés en traits simples et clairs : en aucun cas ils ne viennent masquer ou brouiller la ligne générale de l’action. […]
Le film étant américain on pouvait craindre un certain nombre d’épisodes sentimentaux et moralisateurs. Ils sont réduits au strict minimum. Sans rime ni raison David Niven prend bien la peine de nous expliquer pourquoi il n’aime pas la guerre. Personne ne l’écoute, et le speech est de courte durée. […] »
Sous la signature suivante : — Jean de Baroncelli, 18 septembre 1961, Le Monde
Le critique présente donc ce film comme ayant un contenu dialogué indigent et inaudible, un pur film d’action aux personnages rudimentaires. Ce qu’il faut mettre en contraste avec ce que dit le même Wikipédia dans l’article sur l’auteur :
« Si on le compare à d’autres écrivains dans le même genre, par exemple Ian Fleming, il a au moins ceci de particulier : peu de sexe et d’amourettes car selon lui cela ralentit l’action. Mais il ne ressemble pas non plus aux écrivains des récents techno-thrillers, tels Tom Clancy ou Michael DiMercurio. En fait, ce sont ses héros qui sont le point focal de son attention, dans leur lutte contre des événements imprévus qui les poussent au-delà des limites de leur endurance physique ou mentale. Le héros est d’ordinaire plutôt calme, voire flegmatique, dévoué à sa mission et souvent doté d’une compétence particulière ou secrète. Souvent aussi, l’un des proches de ce héros se révèle être un traître. »
Il s’agit donc pratiquement du contraire de ce qui est dit sur le film. Et, sans entrer en polémique sur la valeur des adaptations littéraires par Hollywood en particulier, et par le cinéma en général, il s’agit presque d’un défaut ontologique de l’image animée : le spectateur s’ennuie à subir de longues tirades verbeuses, et il faut du génie pour réussir à allier virtuosité cinématographique et dialogues de valeur. Les canons de Navarone offrent bien cette opposition entre un film efficace visuellement et scénaristiquement et un livre de bien meilleure qualité.
Le parti-pris de l’auteur (qu’il semble avoir fait pour plusieurs de ses livres) est de choisir un groupe humain limité et de focaliser toute l’attention sur ces quelques personnages. Il faut dire que cela correspond bien au sujet choisi : une action de commando pour détruire deux gigantesques canons installés dans une position inaccessible, une sorte de mission-suicide pour sauver la vie de la population entière d’une île qui doit être bombardée par ces canons monstrueux. Le lecteur qui n’aurait jamais eu connaissance du film se douterait quand même que la mission ne peut pas échouer, sinon cela signifierait la mort de tous les héros du livre. On connaît donc, d’une certaine manière, le dénouement dès le début du livre. Et c’est tout le talent d’Alistair Mac Lean de nous passionner totalement malgré ce manque de suspens.
On peut mesurer l’influence du modèle cinématographique sur la construction dramatique de ce récit. En effet, le nombre réduit de personnages correspond aux choix habituels des films de guerre (citons seulement Les douze salopards ou La grande évasion), car il offre la répartition des premiers et seconds rôles. Le commando des Alliés envoyé pour cette mission de l’impossible comprend cinq soldats, aux origines et histoires variées, que nous suivons tout au long de l’histoire. S’y ajoutent deux personnages grecs trouvés sur l’île de Navarone. Ce sont donc sept personnages qui monopolisent notre attention, auxquels il faut ajouter les seconds rôles des officiers allemands. Et dans cette petite dizaine d’hommes – il n’y a aucune femme dans le livre, à la différence du film – se trouvent des types humains rencontrés dans les tragédies classiques : le héros absolu, le râleur héroïque, le couard métamorphosé en véritable héros, les hommes de devoir et, bien sûr, le traître.
L’auteur a du métier et sait comment distiller les détails et tirades touchant chacun des personnages, sans que cela ne soit bavard ou prétentieux. Il nous épargne les longues considérations psychologiques tout en brossant par touches successives les portraits des protagonistes, à la fois par ce qu’ils disent, pensent et font. Citons simplement deux exemples : le chef du commando, le capitaine Mallory est un alpiniste de renommée mondiale et un chef de commando expérimenté. Il offre peu de prise au doute, mais juste assez quand même pour ne pas être un Schwartzenegger. Il casse la cuirasse à plusieurs reprises, dans des circonstances graves. Et notamment à propos du Lieutenant Stevens, un autre alpiniste de valeur, mais issu de la high society britannique et qui est, au début de l’aventure, littéralement paralysé par la peur, et surtout la peur d’avoir peur ! Il est celui qui mourra, car il en faut au moins un pour éviter l’invraisemblance trop manifeste. Mais, il mourra en héros, en sacrifiant sa vie (déjà perdue, car il était blessé à mort) pour sauver ses camarades dans leur fuite. Ces deux personnages, nous pourrions les identifier chez Corneille ou Racine, ils sont très présents aussi au cinéma, ce sont des archétypes. Mais ils fonctionnent parfaitement dans cette histoire. Pour en finir avec les personnages, citons un court extrait, où Andrea, un grec du commando est décrit par l’auteur :
« Andrea ne tuait ni par vengeance, ni par haine, ni par nationalisme, ni en vertu d’aucun des autres « ismes » dont les ambitieux, les imbéciles et les gredins se servent pour attirer sur le champ de bataille et justifier le massacre de millions d’hommes trop jeunes et trop ignorants pour comprendre l’affreuse inutilité de la guerre. Andrea tuait simplement afin que des hommes meilleurs puissent vivre. » p. 81.
Et, quand même, encore cette citation, sur le courage et la peur :
« Il n’y a pas d’hommes courageux et d’hommes poltrons dans le monde, mon fils. Tous les hommes ont du courage et nous avons tous peur. Celui que le monde déclare courageux connaît lui aussi la peur ; seulement, il est courageux cinq minutes de plus que les autres. Parfois, dix minutes ou vingt, ou le temps qu’il faut à un homme malade, blessé ou effrayé pour escalader une falaise. » p. 153
Ces mots sont encore dans la bouche d’Andrea, l’archétype du héros absolu. On peut discuter ces phrases, mais on ne peu les ignorer ou les rejeter en bloc.
Il serait donc injuste de considérer ce livre d’aventure comme une simple distraction ; il pousse à penser, notamment sur le bien et le mal, sur la peur et le courage, sur la violence et son usage, sur le prix d’une vie, etc.
Mais ces idées sont délicatement distillées au long d’un récit marqué par un suspense haletant dont la pression ne se relâche jamais. C’est pour cela que je l’ai lu aussi vite ; je n’avais pas envie de le lâcher, alors même que je connaissais la fin. Certains ne retiendront que cela de leur lecture, et c’est leur droit absolu : ils auront passé quelques bonnes heures de lecture. D’autres iront plus loin et garderont le souvenir d’un livre qui captive et fait réfléchir en même temps, et je crois qu’ils auront raison. Dans tous les cas, je recommande cette lecture.
Pour clore ce petit compte-rendu, il faut dire que le livre n’est plus édité actuellement, il fait partie de la grande masse des ouvrages que l’on a déclaré obsolètes. Mais il se trouve partout sur le net, en occasion, à des prix très bas. On peut même le trouver gratuitement dans certaines boîtes à livres !
Et si vous allez en vacances en Grèce et « faîtes les îles », comme des millions de touristes chaque année, rappelez-vous que l’île de Navarone n’existe pas !
PS : Avant de clore cette critique, j’ai voulu revoir le film, en ayant lu le livre. Quelle déception ! En effet, ce que j’ai vu est conforme à l’avis de Baroncelli cité plus haut : l’adaptation est une vraie trahison, qui a laissé de côté toute dimension humaine et psychologique. De plus, il y a d’importantes modifications de personnages : le remplacement des deux maquisards grecs de l’île par deux femmes, ce qui laisse la place à des allusions sentimentales totalement absentes du livres, qui est une histoire d’hommes. Quant à l’aventure elle-même, elle a subi des transformations qui lui ôtent une grande part de la vraisemblance du récit écrit. Mon conseil est donc : après avoir lu le livre, visionnez le film (lien ici : https://m.ok.ru/dk;jsessionid=96916fba2a89b81da5f0206fd3de43e6995e137217a3109d.b6bdc890?st.cmd=movieLayer&st.discType=MOVIE&st.mvId=1918193830649&st.dla=on&st.plog=-1%3B-1%3B0%3B&st.frwd=off&st.discId=1918193830649&st.page=1&st.unrd=off&_prevCmd=movieLayer&tkn=364&__dp=y ) et vous pourrez vérifier ce que je dis ; vous n’en apprécierez que plus le roman.
Jean-Michel Dauriac – Mai 2025.
Leave a Comment