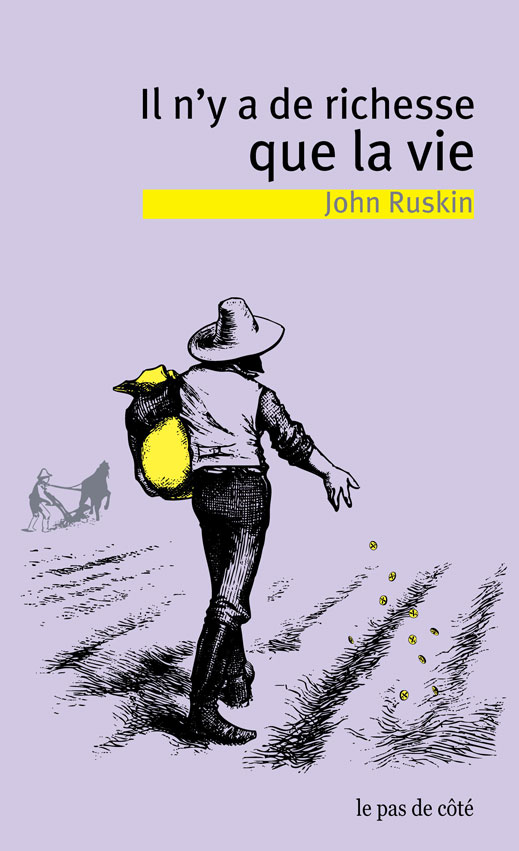Le christianisme du Christ est rempli de la notion de fraternité. En cela il est bien sûr d’abord un judaïsme. Tous les Juifs descendent des mêmes Patriarches. Le “peuple élu” de l’Exode est un peuple-famille. Quand Jésus, dans son enseignement dit: “Si ton frère….”, son auditoire entend un rabbin, un prophète. C’est une formule banale à force d’être vraie. L’histoire ultérieure du peuple juif a montré que les frères sont allés ensemble jusqu’au bout de la nuit et du brouillard au XXème siècle. L’évidence du lien familial-religieux poussé à l’extrême.
Mais quand Paul de Tarse remercie “les frères” de Macédoine de s’être imposé une collecte pour les “saints de Jérusalem”, le registre a changé. Le christianisme de Paul n’est plus un judaïsme. Il donne aux Juifs leur place (voir le magnifique début de l’Epitre aux Romains), mais il diffuse son message parmi les non-juifs et bien vite les chrétiens se séparent de la synagogue. Qu’en est-il alors de la notion de fraternité? De toute évidence, si l’on avait voulu établir un découpage cohérent et culturel de la Bible chrétienne, il eût fallu rassembler la bible juive et les Evangiles. Car l’histoire de l’Eglise chrétienne commence seulement au début du livre des Actes des apôtres. On comprend bien sûr pourquoi cela ne fut pas fait, compte tenu des rapports des juifs et des chrétiens jusqu’à nos jours. Il nous faut donc recevoir les paroles de l’Errant de Palestine s’adressant à ses frères de sang et les rendre efficientes aujourd’hui, au XXIème siècle, par exemple dans un pays comme la France. Que pouvons-nous dire sur ce délicat sujet de la fraternité considérée d’un point de vue chrétien et non seulement républicain?
* * * * * *
En premier lieu, considérer que Jésus nous a donné lui-même la clé en répondant au pharisien Nicodème, venu le consulter nuitamment sur la nature du salut de l’homme.
1 ¶ Or il y avait, parmi les Pharisiens, un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs.
2 Il vint, de nuit, trouver Jésus et lui dit: « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n’est pas avec lui. »
3 Jésus lui répondit: « En vérité, en vérité, je te le dis: à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le Royaume de Dieu. »
4 Nicodème lui dit: « Comment un homme pourrait-il naître s’il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? »
5 Jésus lui répondit: « En vérité, en vérité, je te le dis: nul, s’il ne naît d’eau et d’Esprit, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.
6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit.
7 Ne t’étonne pas si je t’ai dit: Il vous faut naître d’en haut.
8 Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit. »
9 Nicodème lui dit: « Comment cela peut-il se faire? »
10 Jésus lui répondit: « Tu es maître en Israël et tu n’as pas la connaissance de ces choses!
11 En vérité, en vérité, je te le dis: nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et, pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage.
12 Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel?
13 Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme.
14 Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l’homme soit élevé
15 afin que quiconque croit ait, en lui, la vie éternelle.
16 Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.
17 Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
18 Qui croit en lui n’est pas jugé; qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
19 Et le jugement, le voici: la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l’obscurité à la lumière parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.
20 En effet, quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de crainte que ses oeuvres ne soient démasquées.
21 Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses oeuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. »
Le chapitre 3 de l’Evangile de Jean nous rapporte cet échange, d’où j’extrais ce passage très connu: “…si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.” Nicodème sera le frère de Jésus dans le Royaume de Dieu s’il naît de nouveau. Il est donc clair que Jésus ne parle donc pas d’une fraternité charnelle pour le Royaume de Dieu. Le salut offert par Dieu selon sa grâce crée une nouvelle fraternité. La question reste entière, bien sûr, de savoir ce qu’est ce Royaume de Dieu. le format de ce modeste texte ne me permet nullement de m’étendre sur ce sujet. Je signale simplement les deux grandes “hypothèses” herméneutiques, qui font écrire et prêcher depuis près de 2000 ans.: soit le “Royaume de Dieu” est au-delà du temps présent, dans un ailleurs, c’est l’interprétation eschatologique, il est la “fin dernière” de l’humanité; soit “Le royaume de Dieu est en nous” comme l’écrivait Léon Tolstoï, et il procède alors d’une incarnation et d’une construction dans le présent à laquelle l’homme est associé. Mais il reste bien sûr une position mixte qui associe l’eschatologie et le temps présent comme deux dimensions complémentaires et successives. Pour notre sujet de la fraternité, cette discussion importe, mais elle n’est pas essentielle. Le fait est que le “Royaume de Dieu” est une réalité autre que la vie biologique ordinaire et qu’elle relève de l’Esprit.
“Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l’Esprit est esprit.” Jean 3:6. Le Royaume présenté à Nicodème est distinct de l’Israël du judaïsme qu’il pratique. Le critère n’est plus le sang, la famille, la filiation naturelle, mais l’esprit commun insufflé par Dieu – “Ruah” en hébreu, le”souffle divin,créateur”-.
De la même manière analogique évidente, l’Eglise de Jésus-christ (sous ses diverse formes que nous devons accepter n’être qu’une) est distincte de nos sociétés, nations, tribus, clans ou familles. Le sang n’y joue aucun rôle, si ce n’est celui du Crucifié, symbolisé et magnifié dans la Cène (avec ses diverses interprétations).
* * * * * *
En second lieu, s’il existe deux réalités différentes, le “Royaume de Dieu” et le Cosmos, pour reprendre la notion grecque, l’une physique et l’autre spirituelle, cela induit-il une dualité de la fraternité? Nous parlons ici dans l’optique chrétienne, évidemment. Pour situer l’enjeu de la question, proposons la situation suivante. un homme (ou une femme) chrétien a deux personnes qui comptent plus que tout dans sa vie: son frère (ou sa soeur) et un chrétien de sa communauté, donc un frère selon le Nouveau Testament. Dans une situation critique de sa vie, il est face à un choix cornélien qui l’oblige à choisir entre l’un de ses deux frères. Quel sera alors le choix le plus fraternel, s’il y en a un?
A ce dilemme, la morale familiale bourgeoise occidentale répond sans ambiguité que le choix est celui du sang: la fratrie d’abord. A l’inverse, les sectes les plus strictes font le choix de l’orthodoxie spirituelle: la fraternité d’abord. L’Evangile peut-il nous aider à y voir plus clair?
Jésus a été soumis à ce même choix et les Evangiles nous le rapportent en Marc 3: 31-35. Sa famille vient près de Jésus et le fait appeler alors qu’il prêche ou parle à l’intérieur d’un lieu peu précisé. Et que leur fait-il répondre?
“Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère.”
La variante de Matthieu 12: 46-50 est plus “visuelle”: Jésus montre la foule de ses disciples à celui qui vient l’appeler et dit: “Voici ma mère et mes frères…”
Ici, Jésus ramène la notion de “peuple élu” au sens de “descendant de” à un strict aspect spirituel (et non religieux). Il donne donc la priorité à la fraternité spirituelle. A suivre cet enseignement et quelques autres aussi radicaux de Jésus, la seule fraternité vraie vient de la marche avec Dieu. Est mon frère ou ma soeur celui qui vit ou tente de vivre selon l’Evangile. La fraternité évangélique efface la fratrie. Et pourtant, ce n’est pas si simple. Car la fratrie fait retour par la famille. Notamment par le rappel affirmé de la lettre de la loi dans le Sermon sur la montagne.
“En vérité, en vérité, je vous le dis, jusqu’à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la lettre de la loi ne passera jusqu’à ce que tout soit arrivé “ Matthieu 5:18. Or, si la loi reste dans sa lettre (dont Jésus dit ailleurs qu’elle tue quand elle est seule prise en compte), c’est pour qu’elle soit rendue vivante par l’Esprit, selon sa phrase “Car la lettre tue mais c’est l’Esprit qui vivifie”. L’Evangile passerait-il son temps à se contredire et à tourner en rond?
Le frère, la soeur, le père ou la mère, comme les enfants, sont importants pour le chrétien. Il est maints enseignements disséminés au fil des Epitres également. mais, contrairement à une sorte de mythe tenace, la famille n’a rien de sacrée et n’est pas une institution de Jésus ou de Paul. leurs propos ne font que prendre en compte son existence et son poids social. Mais les deux la “dynamitent” à plusieurs reprises, en montrant qu’en cas de choix en faveur de la famille, c’est le salut qui est délaissé, car il n’y an plus alors marche selon la “volonté de Dieu”.
La famille n’est pas plus sacrée que ne l’est l’église locale. Elle sont des composantes sociales pour lesquelles Jésus, puis Paul, Jean ou Pierre donnent des conseils ou des règles. Cela ne sacralise en rien l’une ou l’autre. La fraternité biologique et son cadre, la famille, sont une donnée de notre existence d’humain que nous devons gérer à partir de notre condition (conversion) de chrétien. Mais nous percevons bien maintenant l’ambiguïté qui peut se révéler à propos de la fraternité chrétienne et de son rapport ou substitution à la fraternité idéologique. La tentation peut être double.
Elle peut prendre le visage de la rupture sectaire qui lit de manière intégriste les paroles de l’Evangile. Tout se resserre alors sur les produits de la “nouvelle naissance (les “born-again” des Etats-Unis), sur la fraternité spirituelle, en oubliant totalement le discours sur le “prochain”, qui imprègne pourtant les Evangiles. Cette attitude sectaire n’est pas le propre des groupes dangereux clairement identifiés (et souvent para-chrétiens), mais on la retrouve aussi comme une trame de fond dans des communautés catholiques intégristes, chez les évangéliques les plus primitifs (j’entends par là sans aucune base théologique) ou même dans certaines réthoriques pastorales. Outre le danger psychique qu’elle peut faire peser sur les membres de telles communautés, cette attitude ne remplit pas de joie et de paix l’âme du chrétien en question. Or c’est la paix qui est un des signes de la marche chrétienne. Le frère ou la soeur sectaire est en état de guerre permanente contre le mal, il ne peut se relâcher tant il se sent cerné, fragile et menacé. Il est comme un malade en réaction violente à un vaccin. Ce qui devrait lui assurer l’immunité le rend malade à cause d’un mauvais dosage et d’une mauvaise réaction de son corps spirituel. La fraternité exclusive qui en découle est trop intense et trop empreinte de zones d’ombre pour être joyeuse. Elle ressemble trop à une surveillance réciproque qui se drape dans l’amour fraternel. Elle exige au quotidien et pour tous une hauteur d’amour que seul le cheminement personnel spirituel peut donner, avec des évolutions très différenciées selon les individus. Tout cela est, au corps défendant des intéressés, surjoué sous la pression environnante et encadrante, entrainant culpabilisation et échecs partiels ou définitifs, allant jusqu’à l’abandon de toute démarche chrétienne. La fraternité évangélique est épanouissante dans son exigence; elle procure la paix intérieure au-delà des doutes intrinsèques; elle ne saurait être exclusive puisqu’elle est constituée à l’échelle de, l’humanité passée, présente et future.
Le symétrique de cette tentation est tout aussi symptomatique d’une approche incomplète. je l’appellerai le syndrome universaliste. Il est porté par l’air du temps depuis plus de deux siècles. Les Révolutions depuis 1789 l’ont dynamisé. Le discours vaguement humaniste et philantrophique de la République, repris et adapté par le capitalisme marchand, hédoniste et consumériste l’a colonisé. Tout homme est le “frère évangélique” du chrétien: le syndicaliste en grève, le militant mapuche, l’écologiste actif, le Dayak maltraité, que sais-je encore. On appelle fréquemment à la rescousse le poverello d’Assise et la fulgurance de ses intuitions d’amour. Mais le frère est toujours l’opprimé, le pauvre, le dépossédé; en aucun cas le patron attentif, le propriétaire terrien respectueux ou le contremaître humain n’auront accès à cette fraternité-là. Les chrétiens embarqués (“embedded” comme disent les Américains) dans cette démarche sont très nombreux dans l’Eglise Catholique et ses diverse oeuvres, ainsi que dans les divers diaconats protestants ou missions évangéliques. Le misérable est sanctifié par sa misère, il est LE frère. Le nanti, le potentat est diabolisé par ses biens, souvent par son attitude ou ses pouvoirs. Il est étrange que ces chrétiens ne se rendent pas compte qu’ils reproduisent la même erreur que les sectaires de la première catégorie, mais à l’envers. Lecture littérale et limitée des textes évangéliques ou de l’Epitre de Jacques qui constitue le bréviaire unique de ces croyants. Du coup, une partie de l’humanité est exclue de leur fraternité évangélique. Certains allant même jusqu’à prendre les armes aux côtés des plus pauvres (un remake des Jacqueries ou de la Guerre des Paysans). Quant au frère de foi, le converti, celui qui chemine avec lui, il n’existe que comme camarade de lutte. La dimension spirituelle de la fraternité chrétienne avec toutes ses composantes charismatiques, liturgiques, ecclésiales… est réduite à la portion congrue voire évacuée totalement , comme dans certaines associations caritatives ou ONG qui n’ont plus de chrétiennes que leurs noms (et souvent une partie de leur financement). La fraternité universaliste est une version cadavériquement chrétienne de l’universalisme prolétarien marxiste. C’est la dernière victoire d’un communisme mort dont les ultimes cellules sont plus vivaces chez certains chrétiens que nulle part ailleurs. Bien entendu, mon propos porte sur le sens de cette fraternité pour un chrétien et pas sur ses actions ou son utilité. Il ne s’agit nullement ici de disqualifier la lutte du pauvre, du sans-terre, de l’opprimé et de nier l’oppression, l’exploitation et la répression. Ce n’est tout simplement pas le sujet.
Très significativement et de manière symétrique, ces deux approches de la fraternité, à travers les hommes et femmes qui les vivent, s’opposent et se combattent. Mais en même temps elles s’estiment comme positions fondamentalistes. Elles se retrouvent toutes deux contre la fraternité qui cherche son chemin entre socius, le prochain et le frère.
* * * * * *
Car l’ambiguïté de la fraternité chrétienne, telle que le titre de ma réflexion l’envisage n’est pas à prendre ici au sens d’un doute quelconque, mais plutôt sous celui d’une tension dans la vocation. Aucun doute ne plane, en effet, sur la réalité de cette fraternité. La foi chrétienne fabrique de la fraternité. Bien plus que toute autre institution. Ce qui demeure problématique à vivre, parfois (et parfois seulement!), relève plutôt des bonnes limites ou approches de cette fraternité. A la lecture des deux positions évoquées plus haut, il est aisé de comprendre que ces deux-là ne me conviennent pas. Pas par convenance personnelle; elles seraient assez faciles à vivre l’une et l’autre pour l’âme obéissante. Mais par fidélité à la Parole. Ce n’est pas ce que je trouve en lisant la Bible; ce n’est pas ce que l’Esprit atteste en moi. Je trouve dans la Bible une anthropologie au quotidien assez claire pour guider mes pas. Je la résume de manière extrêmement simple maintenant.
L’humanité entière est concernée par le plan divin. Ceci nous est dit à la fois par Jésus-Christ et les apôtres. Citons simplement deux petits textes.
“Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.” Marc 16:15
Ce sont bien les mots Cosmos et Ktisis qui sont utilisés ici. Cosmos: Univers, monde stellaire; ktisis: création.
Le projet “Bonne Nouvelle” (evangelion en grec) est à portée universelle, ce que Paul traduira plus tard par son universel “Il n’y a plus ni Juif, ni Grec….” . Re même Paul, dans une de ses épitres peut également écrire:
“Cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.”
Il y là parfaite unité du christianisme de Jésus (proféré devant des Juifs) et de Paul ( adressé à des non-juifs). Faut-il alors conclure de ce projet universel une fraternité universelle? Nous n’en trouvons nullement la formulation claire. Alors que nous avons de très nombreux textes où les mots “frère” ou “soeur” sont utilisés dans le cadre de la foi partagée (judaïsme ou christianisme). Il y donc un espace entre la “fraternité” et le monde.
Paul Ricoeur a étudié une partie de cet espace dans un article devenu célèbre, « le socius et le prochain », où il établit une distinction subtile mais réelle entre les deux catégories. Il distingue un « prochain » dont il dit : « le prochain, c’est la manière personnelle dont je rencontre autrui par-delà toute médiation sociale », et un « socius » ainsi défini : « … c’est celui que j’atteins à travers sa fonction sociale ». Son textes pose de façon subtile le fait qu’il n’y a pas à choisir entre le “prochain” et le « socius», mais que nous devons nous attendre à être ultérieurement jugés « sur ce que nous aurons fait à des personnes, même sans le savoir … » et conclut ainsi : «… ; mais c’est finalement la charitéqui concerne la relation au « socius » et la relation au « prochain » , leur donnant une commune intention. » Il recentre donc la relation sur l’amour et non sur la proximité ou la structure . Je crois en effet que cet espace entre le frère de fois et le cosmos est défini dans l’Évangile par le terme « prochain ». Ce terme pêche sémantiquement en français. Le latin « proximus » est plus compréhensible. Tout homme de l’humanité est mon « proximus » même s’il n’est pas mon « socius ». Peu importe que je ne le côtoie pas dans la vie sociale, occasionnellement ou souvent. Il est, par le projet « Bonne Nouvelle », inclus dans cette sphère du « proximus ». Tout homme et toute femme, tout enfant et tout vieillard, tout individu au sexe indéterminable (je pense ici au transsexuel) ou autrement choisi (gays et lesbiennes), tout tueur d’enfants en Syrie ou ailleurs, tout assassin de militaires français en Afghanistan, tous tortionnaires est mon « proximus ». Il partage avec moi la condition humaine et la grâce offerte du salut. Est-il mon frère ? Villon pouvait écrire il y a des siècles : « Frères humains qui après nous vivez… ». Si l’humanité est une création, elle a eu un commencement, elle a un phylum commun. Nous avons donc la même origine matricielle. Nous sommes donc frères en humanité. Mais cette fraternité et toute théorique elle ne saurait se mettre sur le même plan que celle de la foi commune célébrée par le repas du Seigneur. Elle ne peut non plus rivaliser avec les liens du sang au sens familial. C’est pourquoi je préfère le mot « proximus » (prochain) pour cette vaste collection de frères théoriques. Il demeure donc tout cet espace humain entre le proximus du cosmos et le frère spirituel. Là est le coeur de cette ambiguïté de la fraternité. Là sont les parents, les voisins, les collègues de travail et au-delà, les habitants de la commune, de mon département et de mon pays. Là, vacille souvent la charité de chrétien. Mais là aussi agit souvent la culpabilisation sectaire. Dois-je feindre l’amour total pour tous ces hommes et femmes ou est-il possible d’être, à l’instar du Christ, « ému de compassion à la vue de cette foule sans berger » ? Aussi bizarre que cela puisse paraître, je crois que tout est possible. Et que je ne dois rien considérer comme impossible, tout autant que je ne dois pas me culpabiliser de ne pas parvenir à être éperdu d’amour pour un abruti ivrogne et pédophile. Faisons un petit tour d’horizon.
Commençons par la famille. Ai-je choisi d’appartenir au même groupe que tout ce qui portent le même nom que moi ? La famille s’impose à nous. La collusion de la coercition familiale et de l’enseignement religieux a rendu la relation familiale quasi sacrée en France. Mon cousin, mon oncle sont-ils plus que mon « proximus » ? C’est en tout cas ce que l’on a répété à satiété, en l’assortissant d’une hiérarchie et d’une soumission dont les sociétés méditerranéennes sont la quintessence. Poussée à l’extrême, nous y trouvons la logique de l’omerta, la fameuse loi du silence, et celle de la vendetta, vengeance du sang par le sang, qui n’est que l’application de la loi du talion, si bien illustrée par les guerres fratricides des diverses mafias, lesquels se nomment d’ailleurs « familles ». On peut comprendre le cri rimbaldien : « Familles, je vous hais ! ». Voici un cercle où il faut conquérir sa liberté en brisant les fausses lois. La tyrannie des liens du sang a été un objet de pression des millénaires durant, surtout pour les filles. Rien dans l’Évangile ne justifie cela. Si le respect dû aux parents et grands-parents est rappeleé dans toutes les traditions (y compris dans la Bible), le principe de soumission à tout adulte pour un enfant est un abus de pouvoir. Quant au poids des silences que le lien familial a entraînés, il est éloquent dans les histoires personnelles de nombreux individus. En clair, la fraternité chrétienne n’a pas à subir le parasitage culturel des us et coutumes familiale et il faut clairement dire que ce sont deux systèmes distincts. Le seul principe du christianisme et l’amour : il s’applique aussi (et surtout, devrais-je dire) dans le champ familial. Mais il ne faut pas charger la famille d’un sens spirituel qu’elle n’a pas. Une famille Samoane n’est pas la même qu’une famille africaine ou limousine. Pourtant des chrétiens se trouvent au îles Samoa, en Afrique et dans le Limousin. Les familles doivent-elles se ressembler au nom d’un modèle chrétien? La réponse est non : il n’y a pas de modèle chrétien de la famille. Il existe simplement des familles de chrétien. La fraternité du Christ s’ajoutant aux liens du sang et de l’amour familial devrait donner des familles pétries de l’Évangile. Cela arrive, mais il n’y a aucune automaticité. Ne confondons donc pas les registres et rendons à la famille ce qui lui appartient et à la foi ce qui lui revient.
Michel de Montaigne écrit dans ses « Essais » : « le père et le fils peuvent être de complexion entièrement éloignée, et les frères aussi. C’est mon fils, c’est mon parent ; mais c’est un homme farouche un méchant ou un sot. » Cette citation nous permet d’aborder le point épineux de la fraternité des fratries. Il y a loin de la coupe aux lèvres en la matière. Le discours social fait des relations entre les frères et soeurs d’obligatoires réussites. Le vivre ensemble et l’éducation font que cela est souvent vrai. Ce que Montaigne souligne ne peut être ignoré : deux membres d’une fratrie peuvent n’avoir rien en commun ou en tout cas bien moins qu’avec leurs amis. Faut-il alors s’indigner ou appliquer le principe de réalité ? Ne cherchons pas en tout cas à justifier une éthique de la fratrie sur la Bible, car celle-ci contient tous les types de comportements, des plus conformes au modèle jusqu’au plus scandaleux et mortifères. Je crois qu’il convient de traiter la famille dans son ensemble et ne point hiérarchiser à l’intérieur de celle-ci. La question est celle des liens du sang dans l’analyse de la fraternité et rien d’autre.
Quid maintenant de nos voisins, concitoyens et autres proximi sociaux, ceux que Ricoeur appelle les socius ?
Il est très facile de créer des réflexes claniques ou nationalistes en flattant une appartenance identitaire, lié au sol ou à la religion, et excluant tout ce qui lui est extérieur. C’est le vieux réflexe chauvin, presque aussi vieux que la horde préhistorique. En choisissant de flatter les instincts les plus bas et en désignant un ou plusieurs ennemis communs (le fameux bouc émissaire de René Girard), on fédère désormais les hommes et les femmes qui oublient leur différence pour se livrer à la haine primaire, au racisme au nationalisme. Cela en fait-il des frères ? Non, mais des loups sûrement ! Haïr ensemble ne crée nullement de l’amour et de la fraternité, à l’inverse de la souffrance partagée.
Si l’on écarte le nationalisme et ses variantes, il demeure l’énigmatique « fraternité » de notre devise républicaine. Il y a quelques années, Régis Debray s’est essayé à un livre sur le sujet, sans grand succès et sans grand intérêt, sa rhétorique tournant complètement dans le vide, tant il s’avérait incapable de proposer la moindre démarche créant de la fraternité. Que peut bien signifier cette fraternité de frontispice ? Disons-le tout net, de la trilogie républicaine, c’est celui qui se porte le plus mal. La fraternité n’a pas survécu à la Révolution Française. Et encore convient-il de ne pas l’idéaliser. S’il il y eut bien un grand « moment fraternité » le 14 juillet 1790, le moins que l’on puisse dire est que 1793 en est la négation. Tout le reste est littérature. N’appelons pas « fraternité » le réflexe de peur et de haine né des guerres de 1914 et 1940. La Résistance créait une éphémère fraternité d’armes qu’Aragon célèbre dans son poème « La rose et le réséda » : « Celui qui croyait au ciel et celui qui n’y croyait pas » se battent coude à coude contre la barbarie nazie. Tout cela vole en éclats lors des combats de 1944 et les épurations-règlement de comptes qui les suivent. L’Europe, née du programme du CNR et de la volonté des démocrates-chrétiens, est technocratique et non fraternelle. Cessons donc de faire perdurer ce mythe : la République ne crée nulle fraternité. Au mieux elle crée de la citoyenneté -c’est le cas de l’école de Jules Ferry à partir de 1881-82 et on en connaît l’apothéose avec le patriotisme guerrier du mois d’août 1914 – au pire, elle crée une nationalité. Nous en sommes là en ce début de deuxième décennie du XXIe siècle. Toutes nos querelles électorales (assez misérable à l’analyse) ne portent que sur l’étranger, donc en creux dessinent un seul critère d’appartenance, la nationalité, une fraternité de papier certifié par les préfectures. Mon voisin est un Français ou un étranger, mais pas un frère de la République. Et je puis bien soutenir le contraire, je ne fais que me mentir à moi-même.
Aux termes de cette rapide réflexion sur la fraternité chrétienne, il faut rassembler les éléments à conserver. La fraternité chrétienne n’est pas institutionnelle, comme le disent les grandes églises historiques. Être Luthérien ou Catholique Romain ne transforme pas en frères des autres croyants. Ces églises fabriquent des coreligionnaires, chez lesquels une certaine amitié, sympathie ou empathie, peut se manifester. Ce qui fait le frère, c’est la paternité commune. Nous avons proposé le texte de Jean 3 comme processus de naissance seconde, qui ouvre à cette nouvelle généalogie. Nous nous situons ici volontairement dans un christianisme de conversion, sous l’ombre vécue de Martin Luther, d’Augustin, de Paul Claudel ou Jacques Ellul. Nous savons qu’il existe une approche multitudiniste qui est fondé sur le phénomène institutionnel. L’histoire invalide une telle fraternité aux lumières de la Bible. Si nous voulons la conserver, il nous faut alors inventer une théorie concentrique et parler de fraternité du second cercle.
Mais au-delà de ces fraternités religieuses (chrétiennes au sens strict), que penser des autres fraternités invoquées ? La fraternité familiale est une fratrie, un fait à la fois culturel et biologique. Plus souvent imposée que choisie, elle a tout d’un abus. Quant à la fraternité républicaine, nous savons qu’elle n’est plus depuis longtemps qu’un mot figé dans la pierre de nos mairies. La République Française n’est pas fraternelle, car ce n’est plus du tout son projet. Si elle parvenait à maintenir un peu de solidarité entre ses citoyens, ce serait déjà une belle réussite.
Enfin en ce qui concerne les humains, hôtes de la Terre, toute fraternité est purement théorique. Au mieux il s’agit d’une solidarité de l’espèce.
Nous avons donc un emboîtement de lien qui peut se résumer ainsi :
Frère (chrétien) — proximus ou socius (prochain immédiat) — proximus (prochain théorique) — spéciation.
L’enseignement chrétien nous adjoint d’éprouver de l’attention, de l’affection, de l’amour même pour nos prochains divers (proximus-socius ou proximus). Ce commandement unique et le plus surhumain de tous, c’est pour cela que Jésus résume en lui la Loi et les Prophètes. Nous devons sans cesse le porter à incandescence en nous, tout en sachant nos limites humaines.
Pour la fraternité chrétienne stricto sensu, nous n’avons pas le choix. Elle est une manifestation de notre filiation commune. Alors il reste ce que disait Augustin : « aime, et fais ce qui te plaît. »
Jean-Michel Dauriac – juillet 2012.
Bibliographie sélective
1. Dictionnaire Critique de Théologie – direction Jean-Yves Lacoste – PUF collection Quadrige – 2002 (première édition 1998)
2. Histoire et vérité – Paul Ricoeur – Le Seuil, collection points-essais – 2001 (première édition 1955)
3. Le moment fraternité – Régis Debray – Gallimard NRF – 2009
4. La cité de Dieu – Cinq Auguste – Le Seuil, collection points-sagesse – trois volumes –1994 (existe aussi dans la collection La Pléiade, en un seul volume)
5. Le Royaume des Cieux est en vous – Léon Tolstoï – Le passager clandestin – 2010 (première édition en 1893)
6. Tous les hommes en frères – Gandhi – Gallimard, collection Folio – 1990 1990
7. Les essais – Montaigne – E te ditions Arléa – 2005
Première épitre à Timothée 2: 3-4