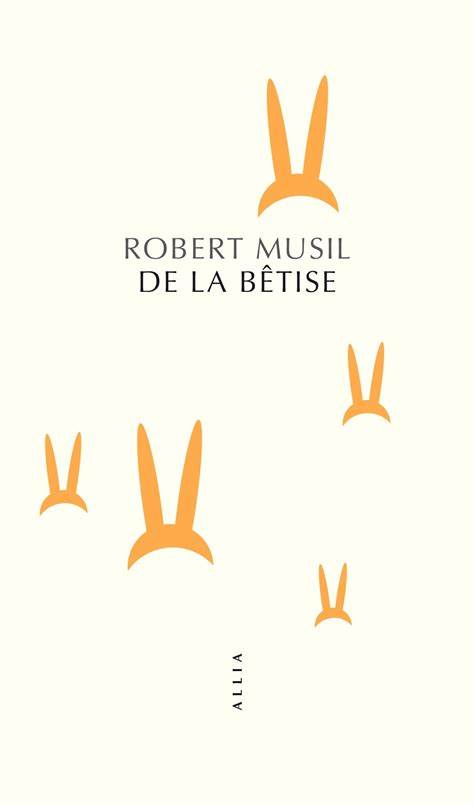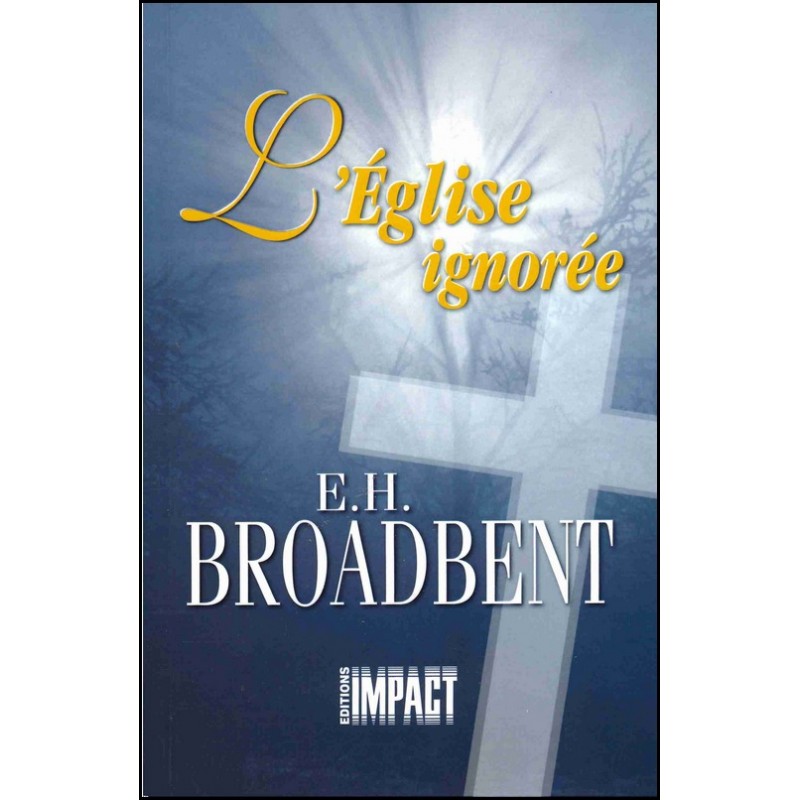Lexio/débats – Le Cerf poche – 2023 (2021 pour la première édition)
Chantal Delsol est bien connue des lecteurs du Figaro, car elle y tient une chronique régulière. Elle est, par ailleurs, l’auteur d’un œuvre assez considérable, divisée en deux périodes. Durant sa vie active, elle fut professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris et écrivit nombre de livres qui étaient plutôt des manuels. Donc des ouvrages destinés surtout aux étudiants ou aux professeurs. Mais, depuis sa retraite, elle a réorienté son travail vers une réflexion de caractère plus philosophique et religieux, dans laquelle elle peut également réutiliser sa connaissance sociopolitique. Elle se définit elle-même comme une chrétienne catholique conservatrice – en lisez pas inconsciemment « traditionnaliste », comme le font beaucoup de gens, tant le biais idéologique est fort – et assume cette grille de lecture au fil de ses ouvrages. Ses livres, comme ses propos lors de sa participation à des émissions diverses, sont intelligents et nous questionnent, tout en restant lisible par le grand public.
Ce petit livre développe une thèse qu’elle soutient depuis longtemps : celle de la fin de l’âge chrétien. Ici, elle emploie le terme « chrétienté », qui a une charge historique évidente, en Europe. Pour elle, la chrétienté désigne une période qui court du IVe siècle eu XXe siècle, et dont nous vivons la fin. Elle commence par évoquer le contexte du XXe siècle qui est, de son point de vue, celui où se livre le combat pour la survie de la chrétienté et où la défaite s’avère inévitable, plus on approche du début du troisième millénaire. Les moyens envisagés pour assurer le maintien du christianisme ont été variés et pas toujours très positifs. Ainsi signale-t-elle l’appui que de nombreux catholiques ont apporté aux régimes autoritaires, voire au nazisme ou au fascisme, en croyant ainsi rétablir l’ordre ancien. Ces choix n’ont fait que diviser le camp catholique et, d’une certaine manière, précipiter la chute.
La fin de la chrétienté est due à une inversion normative irrattrapable. Depuis une quarantaine d’années, pour s’en tenir à la seule Europe occidentale, on a assisté à des changements de mentalité collective qui atteste une prise de distance, ou même une ignorance totale des normes chrétiennes. Les populations ont rapidement cessé de croire à ce qui fait la foi chrétienne et, en même temps, ont perdu l’adhésion à ses principes moraux et sociétaux. On peut, en France dire que, symboliquement, la France du Général de Gaulle est le dernier temps chrétien. La présidence de Valéry Giscard d’Estaing s’est voulue radicalement moderne, très inspirée par l’épisode Kennedy aux Etats-Unis. L’ébranlement de mai 1968 a porté ses fruits des années plus tard, avec l’élection de François Mitterrand. Là commence le règne du sociétal-libéralisme et la mise en musique de l’inversion de norme. En quatre décennies, la messe est dite : la France a cessé d’être une nation chrétienne, suivie ou suivant les autres nations européennes catholiques, Espagne, Italie… Même la pieuse Pologne a fini par céder. L’inversion normative a bousé le droit, avec l’IVG, le PACS puis le mariage pour tous, la PMA et, très bientôt, la loi sur le suicide assisté. Chacune de ces avancées sociétales saluées par les progressistes est une pelle de terre de plus sur le cercueil de la chrétienté.
Mais il serait incomplet de réduire cette fin à une simple inversion de norme sociétale. Cette inversion normative s’appuie sur ce que Chantal Delsol appelle une « inversion ontologique ». C’est toute la conception de l’homme, du monde et de la pensée qui est remise en jeu. Ainsi faut-il interpréter le retour des formes multiples du paganisme, le panthéisme et le culte de Gaïa, à travers la religion écologiste. Tout se passe comme si l’Europe avait tourné la page du monothéisme chrétien. L’irruption du relativisme intellectuel et culturel nivelle toutes les opinions et pousse les gens à l’autocensure, particulièrement les catholiques, mis à mal par les divers scandales sexuels ou financiers. L’effacement rapide de la chrétienté a laissé le champ libre à toutes les traditions extérieures et à la remise en cause de la notion même de vérité. Chantal Delsol écrit d’ailleurs ceci à ce sujet :
« …il se peut bien que l’idée même de vérité ait été carrément dévoyée par la Chrétienté. Que la vérité ait été posée comme une proposition théorique, comme un dogme, si distant dès lors de la réalité qu’elle trahit et se perd elle-même. » (P. 131).
L’usage abusif fait par l’Eglise catholique romaine de la Vérité, avec une majuscule, se serait donc au fil du temps retourné contre elle. La nouvelle norme veut que chacun soit sa propre vérité à lui-même. Ce qui pose inévitablement un problème pratique que nous vivons à plein : comment faire société quand on n’a plus de croyances communes ? D’une vérité détenue par l’Eglise, qui la traduisait en règles morales et juridiques, nous sommes passés à l’exigence d’une morale d’Etat, incarnée par « le droit à… ». Dans son dernier chapitre, elle accuse l’Eglise et les chrétiens d’avoir honte de ce qu’ils sont et de vouloir ressembler à leurs vainqueurs, quitte à travestir ses positions.
« Réduits à la situation de témoins muets, les chrétiens sont aujourd’hui voués à devenir les soldats d’une guerre perdue. » (P.163).
C’est donc le silence assourdissant des croyants qui est une faute et l’aveu de la défaite des idées. Mais l’auteur ne semble pas, in fine, le regretter vraiment. Lisons les derniers mots de son livre :
« Renoncer à la Chrétienté n’est pas un sacrifice douloureux. L’expérience de nos pères nous apporte une certitude : notre affaire n’est pas de produire des sociétés où « l’Evangile gouverne les Etats », mais plutôt, pour reprendre le mot de Saint-Exupéry, de « marcher tout doucement vers une fontaine ».) ( 180.)
Ce qui me conduit à formuler quelques remarques critiques sur ce livre.
La première est de confondre Chrétienté et christianisme. La Chrétienté est ce que l’on a appelé le césaropapisme, soit la confusion du spirituel (l’Eglise) et du temporel (l’Etat). C’est effectivement une situation séculaire en Europe. Quant au christianisme, pour s’en tenir à une définition claire et simple, c’est « la religion de ceux qui croient au Christ ». C’est donc une affaire spirituelle exclusivement. Or, le Christ a prêché une vie de foi ; il a par contre mis en garde contre le césaropapisme de manière très claire par sa fameuse formule « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il n’y donc pas lieu de regretter la Chrétienté, et c’est ainsi que je comprends la dernière phrase de C. Delsol.
Ce qui me conduit à une deuxième remarque : la confusion entre Chrétienté et catholicisme, donc, sans le dire expressément à une équivalence entre catholicisme et christianisme. Or, ceci est tout sauf vrai. C’est ce que dit l’histoire officielle de l’Eglise, reprise sans recul critique par les historiens. Mais la vérité en la matière est que la foi chrétienne a toujours été plurielle, malgré les énormes efforts déployés par l’Eglise catholique pour éradiquer toutes les autres manières de croire. Ce fut un échec total en tous les temps : jamais ils n’ont pu supprimer les groupes indépendants se réclamant de la lecture évangélique. On a certes détruit l’essentiel de leurs traces, mais en vain et il existe des récits détaillés de la véritable histoire de la foi chrétienne qui rendent justice à tous ces croyants persécutés, mais persévérants. La Chrétienté dont parle Chantal Delsol est en fait le règne de l’Eglise catholique, associé aux pouvoirs politiques.
Et nous arrivons à la troisième erreur qui est, elle, chronologique, donc historique. La Chrétienté n’est pas en train de mourir en ce début de XXIe siècle. Elle est morte, en tant que régime totalitaire césaropapiste, au XVIe siècle, avec la Réforme protestante et les guerres de religion. Le XVIIIe siècle lui a porté coup fatal, avec ce que l’on nomme les Lumières. Les luttes du XIXe siècle et XXe siècle sont les luttes autour d’un cadavre, celui de feue la chrétienté catholique. L’âge d’or de la Chrétienté fut le Moyen Âge, entre l’an mil et le XIVe siècle. Ce qui disparaît aujourd’hui, ce sont les dernières traces de l’héritage judéo-chrétien de l’Europe. Et là, tous les chrétiens sont concernés, pas seulement les catholiques.
Une autre erreur est de dire que les protestants et les juifs ne sont pas universalistes. Si cela peut se démontrer assez facilement pour les Juifs, il faut bien comprendre que c’est au prix du non-respect de l’esprit de la Torah. Quand Dieu la donne à Moïse, il lui précise bien que c’est pour tous. Mais les Hébreux n’ont pas mis cela en pratique et ont gardé Leur Dieu et leur religion. Par contre affirmer cela pour les protestants est une grossière erreur que j’attribue à l’ignorance de détail de cette variante du christianisme. Appuyer cela sur l’individualisme protestant est une faute de raisonnement. L’individu que le protestantisme a en effet défendu et promu n’est pas une monade, il est tout homme du monde, et il suffit de se pencher sur les missions protestantes et leur histoire pour s’en rendre compte. De même qu’il n’y a pas de christianisme plus universaliste que celui des Evangéliques. Mais cet universalisme ne vise pas l’alliance avec les politiques, mais l’annonce du salut à toute créature. Et ce qui se passe aux Etats-Unis, avec les Evangéliques engagés à fond pour Trump est une véritable imposture et la honte de la foi protestante.
Mais, pour conclure, je voudrais dire que, malgré ces erreurs, ce livre est très intéressant et mérite d’être lu. D’abord parce qu’il ne jargonne pas et s’adresse à tous. Et ensuite parce que ce qu’il présente est tout à fait juste, aux réserves près que j’ai émises. Il donne de bonnes clés pour saisir ce qui se passe aujourd’hui en Europe et pour motiver les chrétiens à relever la tête et à parler, au nom de leur foi.
Jean-Michel Dauriac – Avril 2025.
Leave a Comment