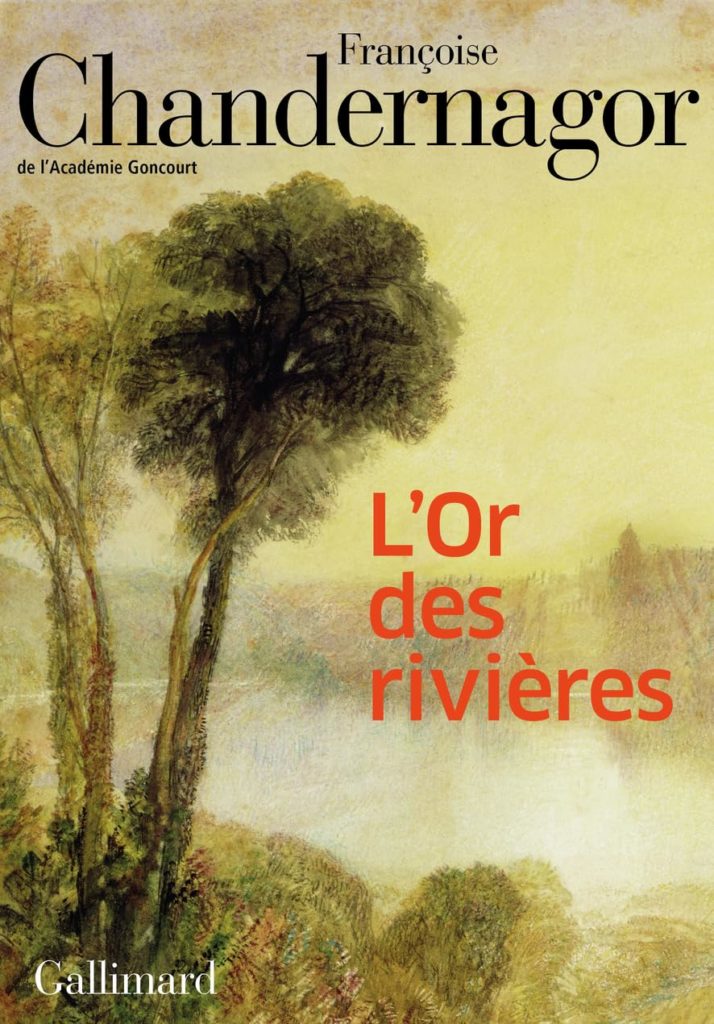Françoise Chandernagor – Paris, Gallimard, 2024, 330 pages, 21€.
Un des secrets les mieux gardés de France….
C’est un des slogans qui fut utilisé par le Comité Départemental du Tourisme de Creuse, pour promouvoir son territoire. J’avoue que la formule est belle (ce qui est rare pour des communicants) et terriblement vraie. Elle est, sous une forme tacite, au cœur de ce très beau livre, personnel et testamentaire.
En Creuse, Françoise Chandernagor demeure dans une commune voisine de la mienne, mais je n’ai jamais eu le plaisir de la rencontrer, bien que j’eus aimé collaborer avec elle pour mes actions culturelles creusoises. Le pays (au sens fort et local de ce beau mot) est donc aussi le mien, depuis que j’ai fait le choix, il y a bientôt vingt ans de m’installer dans le département le plus pauvre et le plus vieux de France, choix que, non seulement je n’ai regretté, mais que jeme félicite régulièrement d’avoir fait. Si vous lisez ce livre, j’espère que vous comprendrez pourquoi.
F. Chandernagor est une romancière connue et reconnue, à la tête d’une œuvre romanesque importante, plébiscitée par les lecteurs, depuis son premier succès (si je ne me trompe pas) avec L’allée du roi, en 1981. Voici donc plus de quarante ans qu’elle enchante ses lecteurs avec de belles histoires, fort bien documentées et bien écrites. Mais ce livre-là n’est pas un roman, mais bien plutôt un livre de souvenirs et l’ébauche de mémoires. C’est le livre d’une femme de tête qui voit s’approcher les quatre-vingts ans et le temps de faire le point, sous l’angle creusois. C’est, sans aucun pathos, le temps de prévoir où sera la dernière demeure. Pour elle, c’est déjà fait : la double tombe qui l’accueillera avec son mari est faite, il ne manque plus que la date du clap de fin. Elle sera donc inhumée – j’aime ce mot que nos tombeaux ont dénaturé, retourner à l’humus – dans sa propriété de Creuse. Je croyais que cela était interdit par la loi de la République, qui se mêle de tout et surtout de ce qui ne la regarde pas, mais en vérifiant, il s’avère que c’est tout à fait possible, à condition de respecter des distances et règles, et assorti d’une autorisation préfectorale. L’auteure fait de ce choix une affirmation forte de son attachement à la Creuse.
Pourquoi la Creuse ? Je dirais par les hasards d’une origine paternelle mystérieuse, dont elle nous livre le secret au fil des pages, mais que son nom éclaire aisément. Chandernagor, ça ne sonne guère creusois ou français. Elle nous en raconte l’histoire. Plus près de nous, c’est dans la branche maternelle que se trouve la racine creusoise. Elle en fait une rapide généalogie, en insistant sur ses grands-parents, plus particulièrement son grand-père, maçon dans l’âme et constructeur de la « maison biscornue » de Palaiseau où elle est née et a vécu son enfance et sa jeunesse. C’est pour elle l’occasion de raconter la saga des maçons creusois et leur rôle dans l’édification des grandes villes du XIXe siècle (Lyon, Toulouse, Limoges, mais surtout Paris), de citer Martin Nadaud, le puissant symbole de cette épopée, maçon devenu député de la Creuse, comme son propre père le sera dans sa jeunesse. Car Chandernagor est un nom qui fut d’abord connu par André, le papa, autodidacte plutôt rigide, dont elle ne dit pas que du bien, notamment qu’il fut un père absent ne s’occupant pas de ses enfants. Si je l’ai bien lue, il est maintenant centenaire (né en 1921). De cette ascendance familiale marchoise est née la pratique des migrations saisonnières desquelles elle nous livre des récits écrits dans un style picaresque très drôle. Comme sont également très drôles, mais aussi touchants, les portraits multiples de Creusois connus depuis son enfance. Elle a pris soin de changer les noms de lieu et de personnes, mais il est certain que, comme chez Colette, les protagonistes ou leurs descendants pourront sans doute les identifier. Elle a suffisamment vécu pour pouvoir brosser une évolution qui prend l’allure d’une épopée de l’isolement et de la simplicité authentique.
Comme souvent dans les bons livres de souvenirs, les maisons ont une grande place. Il faut avoir atteint un certain âge pour mesurer complètement l’importance de la maison. Ce livre est l’histoire de trois maisons. La première est la « maison biscornue » de Palaiseau. Son grand-père, sans grands moyens, comme tous les maçons creusois, avait acquis un terrain étroit, pentu, en angle, sur lequel il s’évertua, au fil du temps à monter des étages les uns sur les autres, au fur et à mesure que la famille s’agrandissait. Telle qu’elle la décrit, elle me fait songer à une de ces maisons des dessins animés du Japonais Hayao Miyazaki. Cette maison fut celle de l’enfance, celle d’où l’on partait pour aller en Creuse le moment venu, celle où le grand-père fabriquait tout en béton, celle où on ajoutait des pièces quand un mariage avait lieu ou un enfant naissait. Françoise C. dit qu’elle pensait qu’elle s’écroulerait, mais elle semble avoir bien tenu le coup.
La deuxième maison est celle des arrière-grands-parents, la maison creusoise typique, dénuée de tout confort, mais où la vie bruissait, notamment celle des enfants de la famille. Cette maison était dans un village où la famille était intégrée et connue. C’est là que l’auteure nous livre ses savoureux portraits de femmes et d’hommes du cru, souvent ironiques, mais jamais méchants si ce n’est avec les brutes. Ce sont des paysans vivant dans un pays isolé, loin des agitations des grandes villes, à une époque où c’est la radio qui est le médium majeur. Les Creusois sont pauvres, mais pas misérables, ils se « débrouillent » comme on dit dans tous les territoires modestes et oubliés. Et la petite fille vibre de toute sa sensibilité, emmagasine ses moments de vie, les partage. Ainsi de la fête de la moisson, avec la batteuse et les libations qui l’accompagnent. Ou de cette partie de pêche illicite et nocturne pour aller capturer de gros poissons dans la proximité d’un barrage. On le voit, ce sont des petites choses qui pourraient paraître insignifiantes vues de la grande ville, comme ces habitants sont considérés comme des ploucs irréductibles. Mais les moments passés dans cette maison de famille rustique et parfois dure à vivre – il faut lire la description de la douche construite par le grand-père – sont restés pour elle des heures de joie, car dénuées de tout artifice.
La troisième maison sera aussi celle de « la dernière demeure ». C’est la maison personnelle, celle de la réussite d’une femme au destin assez exceptionnel. Avec une grande pudeur, Françoise Chandernagor n’aborde jamais sa carrière professionnelle et son parcours. Elle fut pourtant la première jeune fille (à l’époque on pouvait encore dire cela sans encourir les foudres wokistes et féministes) à sortir major de la prestigieuse Ecole nationale d’Administration (ENA), la fameuse fabrique du pouvoir (1969). Visiblement, elle n’avait pas d’ambitions politiques, sans doute assez écoeurée par l’exemple de son père. Elle choisit donc de rentrer au Conseil d’Etat où elle occupera diverses fonctions juridiques, en lien avec sa formation initiale de juriste. Elle se mettra en retraite de ce poste en 1993, quand elle pourra vivre de sa plume. De cela le lecteur ne saura rien. Elle ne parle que de sa vie d’écrivain. Sa maison creusoise est le havre de calme où elle a pris l’habitude d’écrire. Elle a longtemps conservé l’alternance migratoire héritée de sa famille, puis elle a choisi de s’y installer définitivement. Elle nous en fait une description bucolique, qui laisse transparaître qu’il s’agit d’un domaine vaste qui la met à labri du voisinage. Nous avons de très belles descriptions des arbres de ce parc, de l’étang, des saisons… C’est la maison de la maturité, de l’accomplissement. Certes, une maison, surtout en campagne, n’est jamais achevée, mais elle a quand même sa propre finalité atteinte : être le port d’attache définitif.
Il faut dire un mot du titre de ce recueil de souvenirs. C’est d’ailleurs par cette histoire qu’elle ouvre son ouvrage. Ce titre est un cadeau d’un de ses camarades du Jury Goncourt, François Nourissier, qui l’avait reçu lui-même de Jean Paulhan, le célèbre éditeur de Gallimard, lequel lui avait suggéré L’or de la Loire pour un de ses livres. Nourissier n’en a rien fait, il l’a à son tour offert à Françoise Chandernagor, qui l’a modifié en L’or des rivières. Il n’y pas eu de ruée vers l’or en Creuse, à ma connaissance, mais l’expression convient bien à cette vieille province historique de la Marche, où l’eau est omniprésente, tant par les milliers d’étangs que par le chevelu des ruisseaux et des rivières. D’ailleurs, le même CDT que j’ai cité au début de cette chronique a aussi accouché d’un slogan du type « La Creuse, le pays vert et bleu », couleurs que l’on retrouve sur le logo du département. Oui, ce beau secret à préserver est riche de ses magnifiques forêts, aux multiples essences, et de ses eaux vives et stagnantes. Il faut lire ce très beau livre, bien calé dans un fauteuil profond, en face d’une baie vitrée donnant sur la campagne de Creuse (ou d’ailleurs, si on n’a pas la chance d’être en Creuse), un verre d’excellent whisky ou Cognac à portée de main, et déguster livre et alcool sans modération – vous êtes chez vous, et merde à la loi !.
Jean-Michel Dauriac – Les Bordes – juin 2024.
Une fois cet article terminé, j’ai eu envie d’adopter le point de vue marxiste et rédiger une critique politique de cet ouvrage. Ce texte est un exercice de style argumenté, il n’est pas l’expression de ma pensée, mais ce que j’aurais pu penser si je m’étais mis dans la peau d’un militant LFI ou NPA.
L’or des rivières
Une critique politique
Voici un livre comme seule une certaine oligarchie française peut en produire. J’entends par oligarchie, dans ce contexte, l’ensemble des élites culturelles parisiennes et leurs compères politiques et économiques. C’est un fait notoire que notre pays est dirigé, de facto, par un petit nombre de personnes qui gravitent dans des cercles concentriques ou tangents dont l’épicentre tourne autour des arrondissements centraux de la capitale. Françoise Chandernagor en est un exemple type : haut fonctionnaire ayant occupé diverses fonctions au sein du prestigieux Conseil d’Etat, club quasi privé réservé aux énarques ou personnages politiques de haut rang en reconversion, elle est aussi un écrivain reconnu et, de surcroît, membre de l’incontournable jury Goncourt qui fait la météo littéraire depuis des décennies. Donc pas vraiment une femme du petit peuple. Et pourtant, dans ce livre de souvenirs, elle se la joue comme une vraie petite-fille de maçon creusois. Elle a d’ailleurs gommé e allusion à sa vie professionnelle : elle est une Creusoise de cœur et de raison ! Il y a cependant un certain malaise à lire son récit. D’abord parce qu’il fait d’elle une jeune fille de plain-pied avec les villageois de Creuse. Ce qui ne peut avoir été la vérité vraie. Elle était une Parisienne qui venait passer ses vacances dans la maison de ses arrière-grands-parents et jouait à la petite paysanne le temps des congés scolaires. Son père fut longtemps député socialiste de la Creuse et elle était donc clairement identifiée à la bourgeoisie exogène. C’est sans doute un travestissement de la vérité que ce qu’elle nous raconte. Est-ce de la mauvaise foi ou croit-elle vraiment ce qu’elle a écrit ? Les souvenirs lointains nous trompent souvent et nous avons tendance à les embellir.
Mais ce qui peut le plus gêner le lecteur, surtout s’il est lui-même un vrai Creusois autochtone, c’est le misérabilisme condescendant qui préside aux portraits de villageois et aux descriptions de la vie dans son enfance. La Creuse qu’elle décrit est une lointaine colonie de Paris dans laquelle on n’arrive qu’après un périple long, dangereux et épuisant. On croirait lire George Sand décrire ses voyages entre paris et le Berry au XIXe siècle ! Quand les Parisiens sont enfin arrivés, ils vivent au contact de paysans rustres et simplets avec les enfants desquels on s’amuse bien le temps d’un été. Bien que ce ne soit nullement intentionnel, il y a de la morgue dans toutes ces descriptions humaines. Morgue instinctive du parisien envers le provincial rural profond et morgue de l’intellectuel envers les primaires du cru. Ces êtres frustes habitent des maisons au sol de terre battue, sentent mauvais, car ils ne se lavent jamais, les femmes font pipi debout directement sous leur jupon, etc. Vu de Paris, ces êtres sont assez repoussants, comme une sorte de généalogie des Gilets Jaunes, le plouc ne connaissant pas vraiment d’évolution positive.
Enfin, la dernière partie du livre, celle qui décrit la maison acquise par l’auteure, est un véritable acte d’autosatisfaction bourgeoise. Le clou étant d’avoir prévu de se faire inhumer sur sa propriété, comme les seigneurs féodaux autrefois dans leurs cimetières privés. Cette maison et son parc sont décrits en termes lyriques et bucoliques qui rappellent la grande tradition littéraire française des écrivains nantis.
Il n’est bien sûr pas question de remettre en cause l’amour de Françoise Chandernagor pour la Creuse, mais seulement de le remettre en perspective par rapport à l’auteure et à son histoire. Elle s’abrite d’ailleurs assez adroitement derrière l’origine d’anciens esclaves indiens des Chandernagor pour se mettre au niveau des maçons creusois d’hier et des habitants modestes et oubliés d’aujourd’hui. Cet amour pourrait être comparé à la passion des bourgeois bordelais pour le Bassin d’Arcachon, une passion quasi coloniale.
Finalement, la question essentielle est double : peut-on adopter un pays sans que celui-ci vous adopte, sur le long terme ? Peut-on dire aimer un pays si l’on a un regard condescendant sur ses habitants et si l’on aime surtout ses paysages ? C’est au lecteur de ce livre de répondre, par l’interprétation de sa propre lecture. Il peut y avoir deux lectures de ce livre, c’est pourquoi il y a deux critiques très différentes. L’une n’est pas nécessairement exclusive de l’autre.
Jean-Michel Dauriac – les Bordes – Juin 2024
PS : j’ai acquis, par choix longuement mûri, une ancienne petite ferme dans le nord de la Creuse, il y a plus de quinze ans. J’aime ce pays, ses paysages, ses habitants modestes, leurs plaisirs festifs bon enfant et leur capacité à accueillir les résidents venus d’ailleurs. Mais je sais que je serai toujours « le bordelais » pour les gens de mon hameau, alors qu’à Bordeaux j’étais le gars du Périgord, où ma famille est enracinée au moins depuis le XVIe siècle. Je crois que l’on peut cumuler les identités, sans tricher et s’illusionner sur l’enracinement à l’échelle d’une vie humaine. Ma vraie patrie c’est l’Aquitaine et surtout ma langue, le français, que je chéris et qui transcende les clivages régionaux. J’ai adopté la Creuse, d’une adoption pleinière, mais je sais que la Creuse ne peut m’adopter, elle peut juste m’accepter pleinement.
Leave a Comment