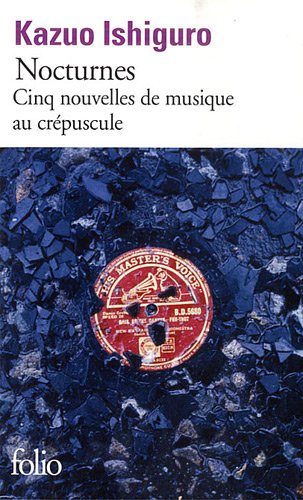2020, Feedback éditions, Paris, 14,00 €
Si j’en crois la liste des œuvres de l’auteur qui ouvre l’ouvrage, ce roman est la première de ses créations publiées. Alors disons-le de suite, sans entretenir un suspens inutile : pour un coup d’essai c’est un coup de maître ! Rarement, depuis des années, un livre français m’aura autant plu.
L’argument est on ne peut plus simple et relève plus du théâtre que du roman. B. Fauconnier imagine une rencontre secrète entre les deux ennemis jurés de la Vème République : le Général de Gaulle, ancien chef de l’Etat, et le Philosophe Jean-Paul Sartre, contempteur du précédent et gauchiste reconnu, conscience de la jeunesse intellectuelle française. L’auteur situe cette entrevue improbable dans le cadre du voyage en Irlande de Charles et Yvonne de Gaulle, au printemps 1969, peu de temps après le départ brutal du vieux lion blessé, suite à la perte du référendum sur la régionalisation, la participation et la réforme du Sénat. Le référendum a lieu le 27 avril 1969, nous sommes donc environ trois semaines plus tard. On peut imaginer sans peine l’état d’esprit du vieil homme. J.P. Sartre est plus jeune que le Général, né en 1890, de quinze ans son cadet (il est né en 1905). Il a donc 64 ans au moment de cette entrevue imaginaire, quand le général a 79 ans. Ces quinze années ne pèsent pas si lourd, car à cette époque, un homme de soixante ans est un vieil homme, et pour les jeunes générations, Sartre est un vieux gauchiste. Comment une telle idée est-elle venue à un auteur né en 1959, qui avait 9 ans en 1968 et dix ans au moment du départ du Général ?
C’est l’objet des premières pages du livre que l’auteur considère comme sa préface. Nous y apprenons qu’il a un soir osé aborder Sartre vieilli dans un bar, au seuil de la nuit, et discuter avec lui ; Il lui a fait la promesse d’écrire un roman sur lui, où il rencontrerait de Gaulle. Ce projet a bien fait rire le philosophe qui a acquiescé mais a demandé à lire le livre (ou plutôt que l’auteur le lui lise, car il avait de très mauvais yeux). Promesse faite, mais impossible à tenir, la mort ayant frappé Sartre en 1980. Fauconnier a tenu parole et inauguré son travail d’écrivain par ce livre particulier dont nous parlons aujourd’hui. L’histoire est belle, elle donne un sens très particulier à ce livre.
Pourquoi Sartre, pourquoi de Gaulle ? A la fin des années 1980, la question mérite d’être posée, tant cette décennie a marqué un tournant dans le monde politique et culturel français. Autant le choix aurait été indiscutable dans les années 1970, autant il n’apparaît plus évident quinze ans plus tard. La France a changé. C’est d’ailleurs ce que de Gaulle pressent dans ses réflexions telles que les crée l’auteur. Les puissances de l’argent ont triomphé, ce sont les années-fric, celles où les idoles sont Berlusconi et Tapie. Le fossé est abyssal avec les deux protagonistes du roman. Sortir ce livre au milieu du règne de la berlusconnerie est un acte qu’il faut lire à deux niveaux. Au premier degré, c’est un hommage aux deux plus fortes personnalités de la décennie 1960. Au second degré, c’est un affrontement entre la raison d’Etat associée à l’amour de la Patrie et la liberté philosophique et le refus du système politique traditionnel. Certes, Sartre s’est beaucoup trompé en politique et s’il n’y avait que cela pour en mesurer l’oeuvre, il serait totalement à oublier. Dans le champ politique, c’est Aron qui a gagné à long terme. Mais il faut replacer ces erreurs dans leur écrin temporel, non pour les excuser, mais au moins pour les comprendre. Il y avait encore un enjeu réel en politique dans la France gaullienne : c’est le fond de commerce des évènements de mai 1968. Il y avait encore une espérance, qui s’était déplacé d’une URSS devenue peu fréquentable à une Chine Populaire mythifiée. Il y a de quoi halluciner à lire ce qui a pu être dit, pensé et écrit dans cette époque (entre 1968 et 1975) sur Mao et ses idées, sur la mise en œuvre et sa théorisation. C’est le naufrage de l’intelligence face à l’utopie maoïste. Et Sartre n’a pas compté pour rien dans ce jeu ! En face, de Gaulle, l’homme providentiel de 1940 et de 1958 commence à lasser les Français : le discours de rigueur et de patriotisme s’érode lentement et se périme. Le sens de l’honneur, celui du sacrifice pour des idées, le culte du travail, tout cela est consumé par les slogans de 68. De Gaulle ne peut pas comprendre la génération Cohn-Bendit. Il faut dire, quand on en voit l’aboutissement aujourd’hui, on en lui donne plus tort. C’est cette opposition que Fauconnier met en scène, à travers les dialogues de cette soirée, entre deux verres de paddy irlandais. Mais il y a aussi un troisième niveau à ce récit dans le contexte de sa parution : c’est celui de rendre mesurable le fossé qui s’est creusé en 20 ans, et s’il y a eu un monde d’hier et un monde nouveau, c’est à ce moment-là qu’il s’est déchiré, et non, comme le croit l’enfant-prince de l’Elysée élu en 2017, entre lui et tout ce qui a précédé. Cela prouve d’ailleurs son manque de culture profonde, il n’a que la culture science-po à sa disposition et, très visiblement, le travail qu’il a pu effectuer pour Paul Ricoeur n’en a pas fait un penseur-disciple. Ce livre fait la preuve éclatante de l’avilissement du niveau éthique de notre pays en vingt ans de libéralisme et de consumérisme giscardo-mitterandien. Les deux figures du philosophe et de l’homme d’Etat s’éloignent dans un flou brumeux. Il ne reste plus que des citations dans des dictionnaires et des caricatures partisanes.
Qu’attendre d’une telle rencontre ? Si l’on est dans la logique hollywoodienne du story-telling médiatique actuel, on peut rêver d’une réconciliation sur les grandes valeurs. Ce serait évidemment une tromperie sur la marchandise. Ils se sont parlés, puis ils se sont quittés, et c’est tout. Leurs univers respectifs étaient trop opposés pour espérer même un début de conciliation. Chacun teste l’autre, c’est une partie d’échec verbalisée. Sur la conception politique, Sartre est raide comme un pur stalino-maoïste, vivant dans un monde abstrait et niant la réalité de l’horreur chinoise. L’avantage est ici à de Gaulle, qui sait vraiment ce qu’est la politique au plus haut niveau. Bien sûr, au plan philosophique, Sartre a l’avantage, encore que sa philosophie existentialiste soit en grande partie creuse et surtout terriblement datée, déjà en 1969. Tout cela est connu et les dialogues qu’imagine B. Fauconnier sont très judicieux, ils sonnent presque plus vrais que nature. Et pourtant, il y a un domaine où l’on sent que les deux hommes pourraient s’entendre, celui de la littérature. Là, le lecteur sent fort bien que l’auteur a une nette préférence pour l’écrivain Sartre face à l’écrivain de Gaulle. Mais le résultat est là : tous deux ont une œuvre littéraire importante et appréciable. Certes, Sartre est auréolé, auprès de beaucoup, par son refus du Prix Nobel. Avec le temps, cela s’avère une belle bêtise ! Car les jurés suédois ne s’y étaient pas trompés : Sartre est un écrivain et c’est en tant que tel qu’il passera à la postérité. Sa philosophie est illisible et, tant qu’à se torturer les méninges, autant lire l’original, Martin Heidegger, que la copie, Jean-Paul Sartre. Son action politique est maintenant dans les poubelles de l’histoire et il y a bien peu de chances qu’elle en sorte, sauf pour quelques thèses ésotériques en histoire ou science politique. Combien de temps ont-ils parlé : une bouteille de Paddy, donc sans doute au moins trois heures. La rencontre est là pour l’éternité comme témoignage à la fois d’un désir et d’une incompatibilité ; qu’elle soit imaginaire ne change rien. Nous savons bien que la bonne littérature est plus vraie que le monde réel, car elle le transcende.
Descendant de la chambre où ils ont échangé, nous voyons deux hommes âgés marcher côte à côte dans le parc. Le plus petit raccompagne le plus grand jusqu’à sa chambre d’hôtel. Ils se séparent et la vie continue. Avant de se quitter, le Général demande à son interlocuteur :
« – Que direz-vous à ma mort ? demanda le Général.
- -Je dirai que je n’avais pas d’estime pour vous.
- -C’est bien. C’est très bien.
Ils s’enfonçaient dans la nuit, ils disparaissaient dans les profondeurs du parc. Le philosophe, avec son pas rapide et sautillant, semblait danser aux côtés du Général impavide ».
La comedia e finita. Ce très grand livre appelle plusieurs lectures, qui n’en épuiseront pas le sens et la richesse.
Jean-Michel Dauriac – Septembre 2021.
Leave a Comment