Bibliothèque des idées – Albin Michel – Paris , 2001.
Imaginons quelqu’un qui ne connaisse pas la Bible – ce sera de plus en plus probable à l’avenir ! Il ne saura donc pas que ce gros livre est composé de deux parties, appelées Ancien Testament et Nouveau Testament. Il imaginera sans doute que ce sont des histoires d’héritages, prenant le mot testament en son sens actuel. Il ignorera donc que ce mot signifiait initialement, en ancien français, le témoignage, ce que l’on attestait devant un juge. Comment pourrait-il savoir que ce que l’on appelle Ancien Testament est en fait la Bible des Hébreux, un des plus anciens livres du monde pour un des plus petits peuples du monde ? Il ne saura pas plus que ces textes ont été écrits en hébreu, une langue devenue « morte », selon la terminologie d’hier, que seuls des érudits lisaient encore ? Et qu’il a donc fallu traduire ce livre dans les langues parlées où vivaient les descendants des Hébreux antiques, les Juifs. Le fait qu’un homme appelé Jésus soit venu en Palestine au Ier siècle de cette ère, au milieu des Juifs dont il était, pour annoncer une religion revisitée au nom du Dieu unique, serait également inconnu. Le succès mondial des idées de Jésus ayant donné naissance à une religion inspirée de son nom, Christ (l’envoyé), le christianisme n’évoquerait rien pour lui. Il ne saurait pas que les chrétiens ont fait leur la Bible des Hébreux, l’ont baptisée Ancien Testament (ancien témoignage du Dieu unique) et l’ont placée avant le recueil de leurs textes reconnus comme inspirés par Dieu, qu’ils ont appelé Nouveau Testament (nouveau témoignage du Dieu unique). L’Ancien Testament est donc la Bible hébraïque, traduite dans toutes les langues du monde.
Imaginons maintenant qu’un lecteur ne connaisse pas Georges Steiner (1929-2020), l’auteur du livre dont je veux vous parler. Il ne saurait donc pas que cet homme a été un des plus beaux exemples de ce que l’Europe Centrale[1] pouvait produire en matière d’intellectuels juifs. Il n’aurait aucune idée de l’érudition phénoménale que ce grand professeur et critique littéraire pouvait déployer. Il ne comprendrait donc pas que l’on ait pu lui demander une préface à la Bible Hébraïque.
George Steiner et son sourire malicieux de celui qui en sait long
Il faudrait donc de toute urgence que ce lecteur quelconque lise ce petit ouvrage, avant, peut-être d’aller plus loin explorer la galaxie Steiner et ses grands astres écrits.
Ce texte était donc initialement destiné à ouvrir une nouvelle édition de la King James Bible Version, la grande version historique de langue anglaise, parue pour la première fois en 1611, et sans cesse rééditée et améliorée depuis[2]. Mais il a, depuis sa rédaction, été intégré à un recueil de textes de l’auteur, car il possède sa propre autonomie.
Steiner consacre son premier chapitre à la linguistique et à la langue de l’original et de la traduction. Pour lui, les traducteurs de la King James Bible ont fait une véritable œuvre de création littéraire, à partir du texte hébreu à traduire. Il donne de nombreux extraits en langue anglaise, suivis de leur traduction en français, tiré de la TOB (Traduction Œcuménique de la Bible). On voit en effet aisément la qualité purement littéraire de cette traduction, avec des trouvailles originales pour traduire certains termes originaux. On peut observer exactement le même phénomène quand on prend la peine d’étudier la traduction de Louis Segond, pour les bibles protestantes de langue française. Ces traductions sont tellement fortes et réussies, elles ont connu une telle diffusion qu’elles ont marqué à jamais le culte, la langue et même les dogmes des Eglises qui les utilisent.
Il revient ensuite sur la spécificité de la langue hébraïque et présente les graves soucis qu’ont rencontrés tous les traducteurs. Notamment en conjugaison, puisque l’hébreu ne connaît que deux temps, et pas le futur.
Le troisième temps de sa démarche est une analyse séquentielle de tous les livres de la bible hébraïque, de la Genèse à Malachie, car il les prend dans l’ordre protestant, et écarte donc les apocryphes qu’ont retenus les catholiques et orthodoxes. Il accorde une importance particulière aux Prophètes, dont il dit :
« C’est des Prophètes que sont nées deux grandes hérésies du judaïsme : le christianisme et le socialisme ou communisme utopique [il écarte ainsi le marxisme]. […] Depuis les anarchistes millénaristes et les esprits libres du Moyen Âge jusqu’à Cromwell et Marx, les « protestants » seront du côté des Prophètes et de leurs impératifs messianiques. » (P. 99.)
On aura compris qu’ici le terme protestant est bien plus large que celui des religions issues de la Réforme et englobe tous les mouvements contestataires et révolutionnaires à tendance idéaliste. Pourquoi cet attrait chez eux du texte des Prophètes ?
« De Samuel à Malachie, l’ancien Israël voit surgir des esprits humains immédiatement informés, contraints par le souffle du Tout-Puissant, des moralistes visionnaires, des veilleurs de nuit, des hommes réclamant à hauts cris la justice sociale, et dont les messages dépassent totalement le judaïsme. » (P.98.)
On sait bien le poids considérable des penseurs et meneurs juifs dans les révolutions et mouvements d’idées depuis deux siècles.
Steiner passe donc en revue, à sa façon, chaque livre prophétique. Et c’est vraiment un travail d’introduction qui est ainsi mené : il fait entrer le lecteur dans l’antichambre du texte biblique, avant de le laisser explorer la demeure à sa guise.
Il termine sa préface par une mise en relief de l’importance de cette Bible hébraïque dans tous les domaines de l’art et de la pensée. Sans oublier le délicat problème du « Que faire avec cette Bible ? ». Il présente les deux grandes grilles traditionnelles aujourd’hui : la lecture littéraliste et fondamentaliste et la lecture critique, distanciée. Et là, il dit presque exactement le contraire de ce qu’il disait précédemment sur les Prophètes (cf. citations au-dessus) :
« Des hommes et des femmes – pour certains, sans doute, doués d’une vision morale et de talents littéraires rares – ont produit ces divers écrits de manière totalement naturelle et, en conséquence, pleinement comparable aux méthodes des grands penseurs, poètes, historiens et législateurs de nombreuses cultures et époques. Nous pouvons bien nous pencher sur un matériau dont la date et la provenance ne sont pas élucidées. Mais ce matériau n’en demeure pas moins mondain, au sens propre du mot. Dans son imagination comme dans sa composition, il appartient totalement à notre monde. » (P.120.)
J’ai mis en gras dans ce texte l’expression qui semble contradictoire avec les propos antérieurs. Peut-on dire que la Bible est entièrement naturelle alors qu’on a dit plus haut que la contrainte du souffle du Tout-Puissant est présente ? Je ne tranche pas le débat ; je crois que Steiner ne se contredit qu’en apparence. Il sait que l’aspect naturel est celui des divers auteurs des livres, issus de milieux différents et traduisant les révélations de Dieu avec leurs mots personnels; il sait aussi que la Bible est en effet ancrée profondément dans nos sociétés et nos vies. C’est d’ailleurs cela qui explique la longévité de son succès.
Cet opuscule mérite d’être lu attentivement[3], car il fourmille de renseignements et, même pour ceux qui connaissent la Bible et la théologie, il apporte des angles nouveaux. Petit livre par la taille, grand ouvrage par le contenu.
Jean-Michel Dauriac – Beychac – août 2025.
[1] S’il est né à Neuilly sur Seine, ses parents venaient tous deux d’Europe Centrale, sa mère de Vienne et son père de Tchécoslovaquie.
[2] C’est l’équivalent de la traduction allemande de Martin Luther, qui fait référence, ou de la version Louis Segond en langue française.
[3] Comme beaucoup de livres que je chronique, celui-ci n’est plus édité, il faut donc le chiner chez les bouquinistes.
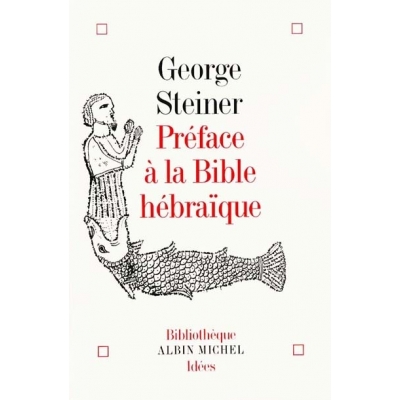

Comments