Je vais avouer ici que je n’avais jamais lu cette épopée homérique avant cette année. Comme tout le monde, j’en avais étudié des extraits, vu des adaptations cinématographiques et connu les personnages principaux. J’ai donc décidé de combler dans le soir de mon existence cette lacune qui m’empêchait de me présenter serein devant l’Eternel.
J’ai choisi une lecture feuilletonesque du gros livre. La structure s’y prête, avec son découpage en 24 chants, eux-mêmes, dans la version utilisée, découpée en sous-parties titrées. J’ai donc mis des mois à aller au bout, lisant quelques pages chaque matin, au petit déjeuner, pour ouvrir la journée.
Au fur et à mesure que j’avançais dans le texte, je devenais de plus en plus perplexe : quand donc allait commencer l’action qui justifiait la venue des nefs et des Achéens à Troie ? Et je songeais à la pièce de Giraudoux La guerre de Troie n’aura pas lieu, que j’avais étudiée au lycée et dont je ne garde aucun souvenir précis, si ce n’est la légèreté du propos. Eh bien, c’est lui qui avait raison : elle n’a jamais lieu ! Homère (ou ceux qui se cachent derrière ce nom) a réussi l’exploit d’écrire une œuvre longue et touffue qui débouche sur le néant. Ce fut la première leçon de cette lecture. On peut donc écrire un livre mondialement reçu et apprécié, sans tenir la promesse des prémices. D’aucuns diront que c’est là tout le génie de cette œuvre. Je leur laisse ce jugement, qui sent la sacristie littéraire antique.
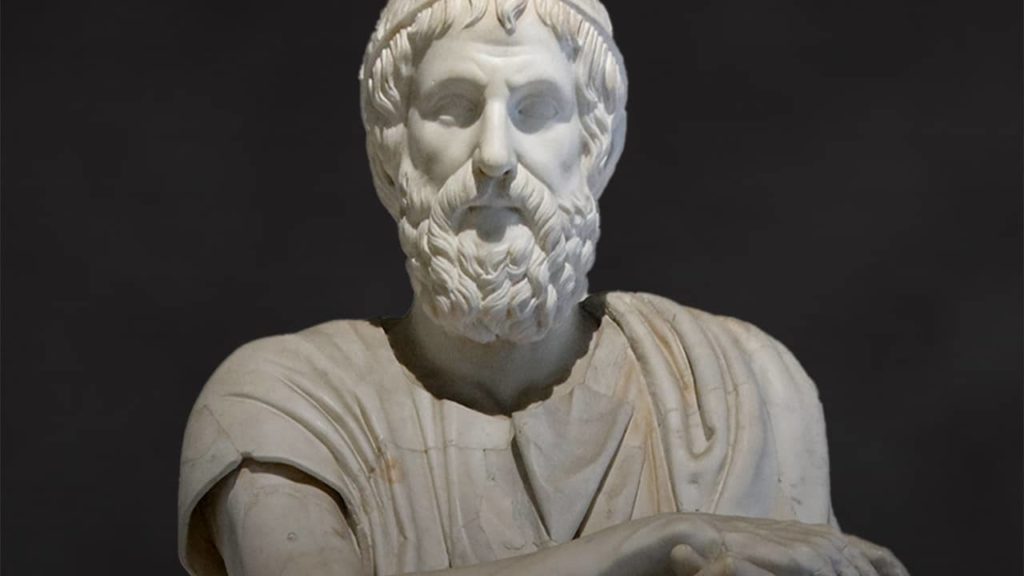
Homère selon l’idéal esthétique grec (aucun rapport avec la véracité des traits, inconnus)
Parlons alors des personnages. On peut dire qu’il ya trois sortes de personnages dans cette aventure : les Dieux et Déesses, les Héros, souvent des demi-dieux et les simples mortels. Mortel étant ici à prendre au premier degré, car l’Iliade est une vraie boucherie. Homère a, sans contestation possible, inventé le genre gore, bien avant Vendredi XIII ou Massacre à la tronçonneuse. Il faudrait faire des statistiques, avec « l’intelligence artificielle », ça va de soi, pour avoir le nombre exact de morts et les pages du volume consacrées à des combats sanguinolents, où l’hémoglobine coule à flots. Les mortels meurent donc à la pelle sur la plage et dans la plaine de Troie. Restent les Héros et les Dieux. Il y a une sorte de connivence asymétrique entre eux. Les Héros sont tous des enfants nés de Dieux ou de Déesses folâtrant avec des humains, puis vivant sous la surveillance plus ou moins serrée de leurs géniteurs. Les Dieux peuvent faire ce qu’ils veulent de ces Héros, alors que ceux-ci ne peuvent que les implorer. Il faut reconnaître à l’auteur une grande ironie et impertinence envers l’Olympe. Les Dieux sont représentés comme des enfants capricieux , jaloux, haineux et se disputant leurs jouets. On se demande mêle, à le lire, s’il y croyait vraiment ! Zeus orchestre toute cette furia, distribue les bons et les mauvais points et assiste au match. Car c’est un véritable match que décrit Homère. Les coups tordus se multiplient, les buts se succèdent dans chaque camp, l’arbitre interrompt parfois la partie pour faire entrer les soigneurs, afin de remettre sur pied les joueurs, afin qu’ils puissent reprendre la partie. Les soigneurs sont rusés et emploient des remèdes illégaux, il y a des interventions extérieures sur le terrain. Bref, c’est la grande pagaille ! Celui qui ne lirait que l’Iliade aurait des Dieux une image déplorable et ne respecterait pas la religion grecque.
Les Héros sont aussi pitoyables que les Dieux. Ne parlons que de quelques-uns, les premiers rôles seulement. Le grand roi Agamemnon est obtus, vaniteux et vaguement méchant. Il ne songe qu’à son petit honneur personnel. Homère a beau nous répéter qu’il est le plus grand des souverains et très aimé de ses sujets, ce n’est pas vraiment ce que l’on voit dans le récit. Les combattants Achéens, Patrocle et les quelques guerriers mis en avant par l’auteur sont des concepts purs, ne connaissant pas le doute ou la peur, prêts à mourir pour une cause absurde (tout cela pour récupérer une femme, Hélène, raptée par le roi de Troie, Priam, alors que le roi Agamemnon dispose d’une belle collection de femelles à sa disposition). En face, du côté des Troyens, les fils de Priam meurent comme des mouches et seul survit Hector, le champion de Troie. Hector est un soldat imbu de sa personne et convaincu de sa supériorité, bref un personnage sans aucun intérêt. Enfin, j’ai gardé pour la bonne bouche le super-héros, Achille. C’est à lui que revient la queue du Mickey du manège troyen. Achille boude durant tous les combats, laissant ses frères d’armes se faire massacrer, car Monsieur Achille a été offensé par Agamemnon. C’est la mort de son ami Patrocle et les interventions divines qui vont le décider à aller combattre et à tuer Hector. C’est sur les démarches de Priam venant récupérer la dépouille d’Hector, son fils, que se termine le récit. Tout ça pour ça !
Bien sûr, les amoureux de cette oeuvre m’opposeront la culture antique de l’honneur et des vertus. Mais Homère la décrit de telle façon qu’elle est ridiculisée. Il y met certes les formes et use de tous les termes emphatiques pour décrire les grands sentiments de ses personnages, mais plus il en use, plus ils sont artificiels et ridicules.
Il reste le style. Je dois reconnaître le talent de l’aède, notamment dans le choix des formules, par exemple pour décrire la mort au combat, quand il dit d’un homme tombant au champ d’honneur « et ses armes tintent sur lui ». La forme trahit l’origine orale de cette épopée. Les répétitions à l’identique des dialogues sont typiques des procédés mnémotechniques des poètes oraux. Il faut bien reconnaître que cela passe beaucoup moins bien à l’écrit qu’à l’oral.
Aurais-je lu ce livre en lecture suivi ? Sûrement pas, justement en raison de ses répétitions incessantes et de la monotonie de l’action. En le lisant comme un feuilleton, je crois lui avoir rendu son vrai rythme. Je reste quand même perplexe sur son classement comme chef d’œuvre incomparable de l’histoire de la littérature humaine. Lecteur habituel de la Bible, je suis familier de ces styles antiques, marqués par l’oralité. Mais j’avoue ne pas avoir été convaincu par ma lecture de l’Iliade. Bon, je vous laisse, je vais bientôt commencer la lecture de l’Odyssée de la même façon. On en reparlera.
Jean-Michel Dauriac – Décembre 2024.
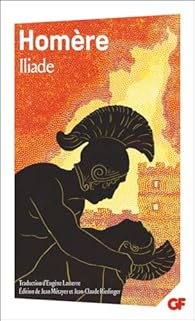
Comments