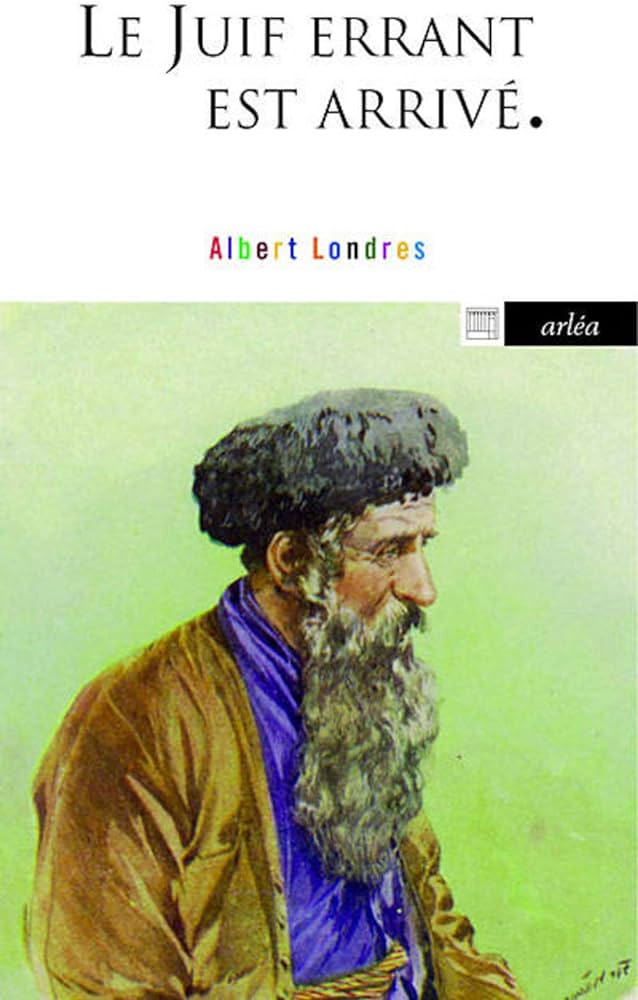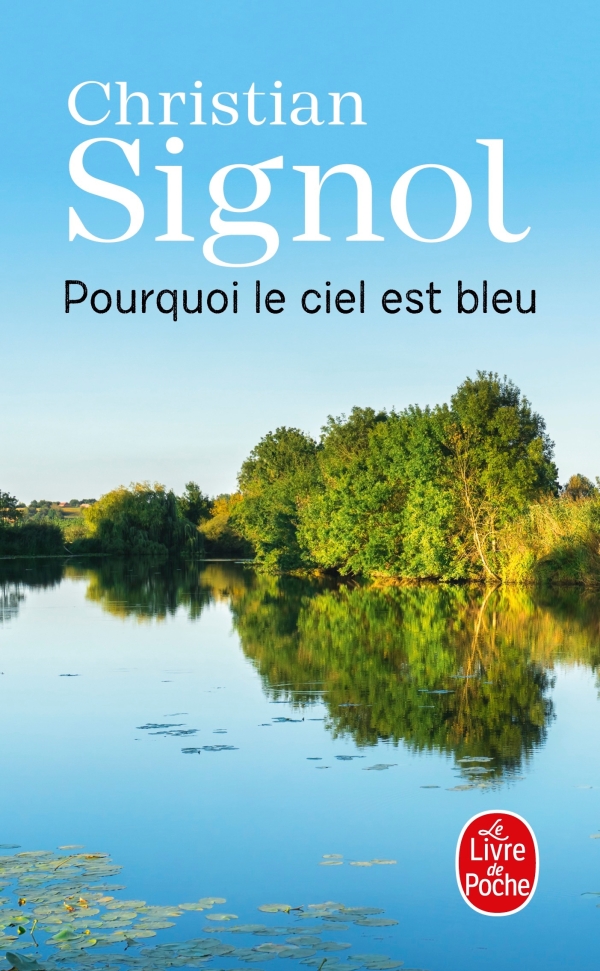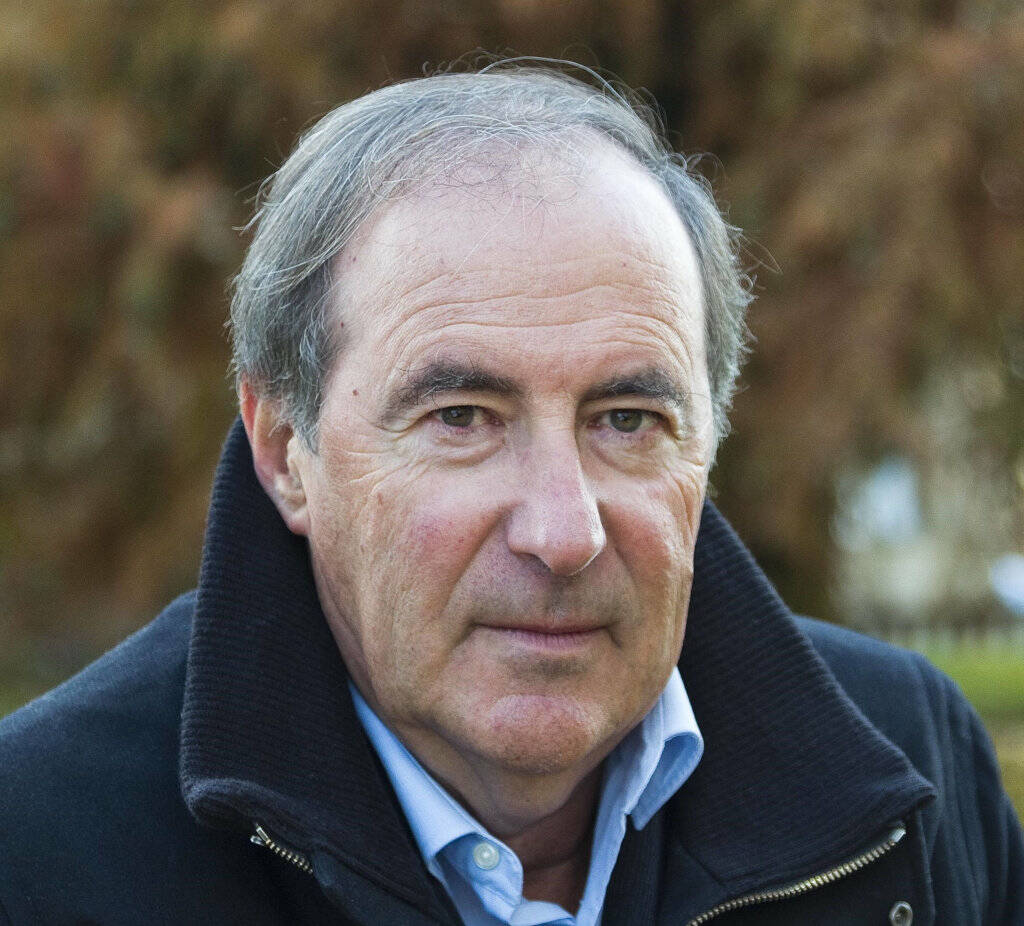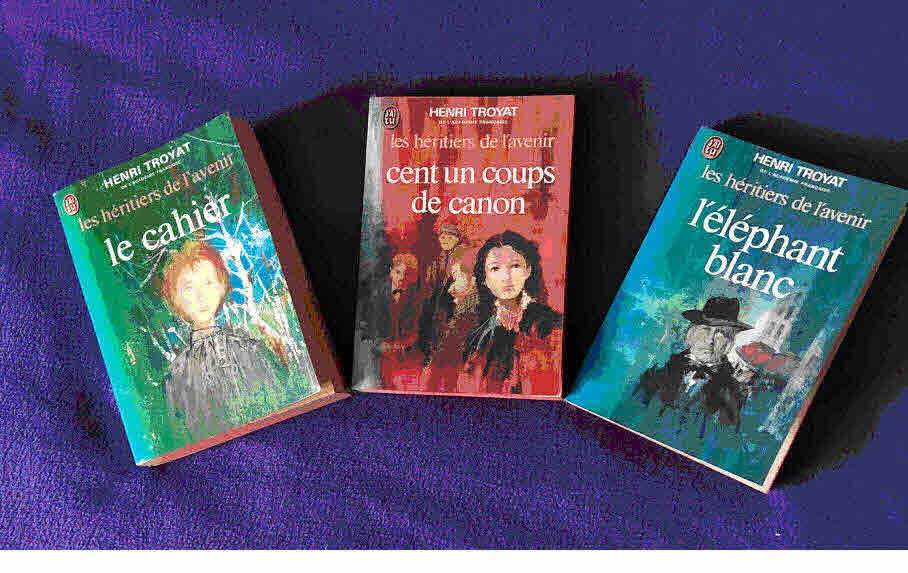Le juif errant est arrivé
Albert Londres – Paris, Arléa poche, 1992, 223 pages.
Albert Londres ; ce nom autrefois très célèbre ne doit plus aujourd’hui parler qu’aux étudiants en journalisme (et encore : il n’avait pas de blog ! ni de compte Instagram) et aux quelques étudiants en histoire cultivés – ce n’est pas un oxymore. Pourtant, il fut en son temps une voix qui faisait trembler les pouvoirs. Il fut l’honneur d’un certain journalisme d’investigation du XXe siècle, dont on peine à croire qu’il ait pu exister, tant le métier est devenu servile et peu créatif. On a d’ailleurs donné son nom au plus prestigieux prix qui récompense les grands reportages. Ce livre démontre de manière éclatante combien cela est justifié.
Pourquoi devient-on journaliste ? Aujourd’hui, la réponse est parfois très prosaïque : parce qu’on a fait des études de journalisme, comme on fait celles de juriste ou de technicien en informatique. La formation détermine le métier, PracourSup étant la pire des choses en la matière, puisque c’est un algorithme qui propose des formations aux jeunes bacheliers. Tel se rêvait dentiste et finira en IUT à préparer un diplôme de logisticien. Telle autre se voulait puéricultrice, mais sera orientée manu militari vers les services à la personne. On mesure sans peine ce que cela génère comme frustration et désintérêt pour le travail. Il fut un temps où l’on devenait journaliste (ou reporter comme on préférait souvent dire) par passion et par un grand coup de culot ; un temps où les patrons de presse n’étaient pas les domestiques des entreprises du CAC 40 ; où un journal offrait à ses lecteurs des textes originaux de ses « pisse-copies ». On n’avait pas encore mis au point le système des dépêches prérédigées des grandes agences de presse, qui sont les auteurs de la majorité des écrits publiés dans els quotidiens. Londres est de ce temps-là, celui où un directeur envoyait un journaliste qui n’avait pas froid aux yeux, avec un budget et carte blanche, à charge de fournir au journal des pages inédites et captivantes.
Il décide de faire un grand reportage sur les juifs, avouant n’y connaître rien. Il va ainsi effectuer un périple dans tous les lieux où les juifs sont nombreux et nous présenter, comme aux lecteurs de 1929, ses découvertes, ses bonnes et mauvaises surprises. Les textes furent initialement écrits pour publication dans le journal qui l’employait alors, Le Petit Parisien, où cela donna 27 livraisons, que l’on retrouve dans le livre sous la forme des 27 chapitres.
La lecture du livre convainc vite son lecteur qu’il a affaire d’abord à un écrivain, ce que confirme la biographie de l’auteur[1]. A. Londres a en effet publié trois recueils de poèmes et écrit une pièce sur Gambetta, avant de devenir reporter. Il y a un « style Albert Londres » qui mélange ironie, dialogues, réflexions de fond et déroulement des faits. C’est un style plutôt nerveux, opposant des phrases courtes, souvent exclamatives et des phrases longues, descriptives. Un style efficace et accrocheur qui fait merveille pour retenir le lecteur et lui donner envie de poursuivre.
Londres choisit d’aborder son sujet dans un ordre logique, en commençant par la proximité : le juif de l’Europe occidentale (il ne va pas aux États-Unis, qui ont pourtant une très forte communauté juive, car il considère que ce ne sont plus vraiment des juifs européens, mais des Américains d’origine juive). Les quartiers juifs de Londres et de Paris lui permettent de faire connaissance avec les commerces juifs et son onomastique, qu’il retrouvera partout au cours de ses voyages suivants. Dans le chapitre 1, il énumère les noms lus sur les enseignes de Whitechapel : « Goldman, Appelbaum, Lipovitch, Blum, Diamond, Rapoport, Sol Lévy, Mendel, Elster, Golderberg, Abram, Berliner, Landau, Isaac, Tobie, Rosen, Davidovitch, Smith, Brown, Lewinstein, Salomon, Jacob, Israël… » (Page 18) Il citera cette liste à chaque grande étape. Elle a pour fonction de montrer la permanence familiale et la concentration communautaire. Il ne consacre pas de pages spécifiques à Paris, évitant ainsi de souffler sur les braises de l’antisémitisme latent des Français. Londres s’arrangera pour faire dire aux juifs d’Europe Centrale ce qu’il faut penser des juifs occidentaux : ils ne sont plus de vrais juifs, ils sont assimilés et passent donc un peu pour des traîtres chez les juifs polonais, roumains, russes… La Seconde Guerre mondiale lui a donné raison : on a vu les juifs français, hollandais ou même allemands ne pas comprendre la montée du péril mortifère, car ils étaient Français, Hollandais ou Allemands, anciens combattants décorés de la Grande Guerre, etc. C’est pour comprendre ce décalage que Londres décide de se rendre dans les pays de ghettos et des pogromes. Ce sera la seconde partie de son livre, la plus développée.
En effet, si l’on veut comprendre et rencontrer le « juif errant » c’est bien là-bas, dans le monde slave qu’il faut aller. Les chapitres consacrés à la vie des juifs dans les pays d’Europe Centrale (on disait Mittel Europa à l’époque) sont parmi les plus réussis littérairement, mais aussi les plus durs à lire, car leur contenu est parfois insupportable. L’auteur nous amène à le suivre dans les villes et les campagnes de ces pays aux frontières mouvantes qui ne semblent unis que par un seul point commun : leur haine ou mépris du juif. Là vit le juif errant. Albert Londres le reconnaît immédiatement sur le bord d’une route des Carpates. Il est errant d’abord parce qu’il est obligé périodiquement de fuir ses lieux d’habitations face aux persécutions. De cette haine immémoriale, il a forgé sa patrie intérieure qui n’est autre que la Torah. Ce qui frappe le plus Londres, c’est la misère dans laquelle vivent ces populations. Les descriptions des ghettos, notamment ceux de Lwow et Varsovie, sont marquées d’une cruauté de destin inexorable. Ces juifs vivent sans arrêt courbés, au sens moral et au physique. Ils se savent sans cesse sous la menace d’une déferlante de haine incontrôlable, alors ils rasent les murs. Ce que donne à voir Albert Londres se passe en 1929, soit quatre ans seulement avant l’accession d’Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne. Le moins que l’on puisse dire est que le terrain est prêt pour recevoir son appel à la haine et au meurtre. Londres discute avec différentes personnalités de ces communautés ; il leur demande pourquoi ils ne s’en vont pas. Il se heurte à une sorte de fatalisme religieux qui pèsera lourd dans la Shoah. Pourtant, à la même époque, existent le mouvement sioniste et l’appel de la Palestine. Celle-ci attire, mais repousse également une grande partie de ces juifs orientaux, qui ne croient pas que leur destin soit là-bas. Il croise un jeune sioniste venu faire de la propagande et du recrutement pour la Palestine et il voit bien l’accueil assez froid qui lui est réservé. Les rabbins, en particulier, sont hostiles au sionisme qui est, pour eux, un messianisme laïc et athée. On a l’impression de deux mondes qui ne se comprennent guère.
Alors, pour savoir et comprendre, Londres se rend en Palestine. Et là, il voir, dès son arrivée, des juifs debout, des juifs qui n’acceptent plus d’être courbés face à qui que ce soit. Il parcourt le pays des villes aux exploitations agricoles modernes, il rencontre des émigrants de toutes les origines. Il est manifeste qu’il est très favorablement impressionné par ces gens, jeunes pour la plupart, et sa rédaction s’en trouve inspirée. Ces pages, bien que lucides sur les tensions et les risques de la cohabitation entre juifs et Arabes, sont aussi lumineuses que celles de ghettos étaient noires. Il est très marqué par Tel-Aviv, cette ville née en quelques années de la volonté des pionniers. Il y retrouve ses Blum et Goldeberg, mais le climat a changé. Ils sont venus mettre au monde une patrie pour la race juive. Et rien ne semble pouvoir les arrêter, pas même les attaques armées des Arabes : ils ont connu les pogromes russes ou polonais et, après ça, plus rien ne peut effrayer. Albert Londres croit à la réussite du projet sioniste et il fait partager son enthousiasme aux lecteurs. Il semble alors possible que deux peuples puissent se partager ce territoire.
Albert Londres montre donc trois sortes de juifs : les assimilés de l’Ouest européen, devenus citoyens de leurs pays de résidence, ayant adopté en grande partie les idées de ces nations et se sentant plutôt en sécurité et loin du projet sioniste, si ce n’est par des dons de soutien ; les juifs errants de la Mittel Europa, ceux qui sont assignés à résidence, habitués aux brimades, discriminations et violences, qui n’ont aucun horizon à part la religion de leurs pères ; les juifs sionistes de Palestine, enthousiastes, pleins de ressources et disposés à se battre pour leur terre et leur dignité. Le lecteur d’aujourd’hui sait que les deux premières sortes de juifs ont été vouées à l’extermination et que la troisième a fini par faire naître cette nation, mais qu’elle n’a jamais connu la paix depuis 1948. Le juif est-il condamné à l’errance perpétuelle ? Ou doit-il accepter de se tenir prêt à défendre sa vie à tout moment ? Le livre n’apporte pas la réponse, car il n’y en a pas.
Ce petit livre est d’une grande qualité littéraire, mais il a aussi une très grande valeur de témoignage : celui du temps qui précédait de peu l’arrivée des nazis et la montée des totalitarismes antisémites un peu partout en Europe. À lire absolument.
Jean-Michel Dauriac – Janvier 2024.
[1] On lira avec profit l’article Wikipédia, qui confirme les débuts et la vocation littéraire du jeune Albert. https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Londres
One Comment