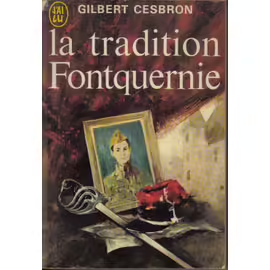e commence ici un cycle d’articles critiques sur l’oeuvre romanesque de Gilbert Cesborn, à partir de l’ensemble publié par les Editions Rencontre dans les années 1970. Ce corpus s’enrichira au fur et à mesure de mes lectures et pourrait, à terme, devenir un petit essai sur cet auteur.
Les innocents de Paris
Gilbert Cesbron – Lausanne, Editions Rencontre – Oeuvres romanesques , vol. II , 275 pages.
Ce roman est le premier écrit par Gilbert Cesbron. Il a connu un destin particulier que l’auteur nous raconte dans l’avant-propos du livre. En juin 1940, il se retrouve, avec des centaines de milliers de soldats anglais et français sur les plages de Dunkerque (revoyez le beau film d’Henri Verneuil, Week-end à Zuydcoote, lui-même tiré d’un roman de Robert Merle), cernés par l’avancée irrésistible des troupes allemandes. Le jeune soldat Cesbron porte avec lui une serviette en cuir dans laquelle se trouve son premier roman, encore inachevé. Au moment de partir en barque rejoindre un navire qui stationnait au large, un homme les supplie de les prendre avec eux. C’est un gendarme en fuite devant l’ennemi. La barque est déjà bien chargée. Pour ajouter un passager, il faut que ceux qui y sont déjà se débarrassent de tout leur barda. C’est ce qui est fait : la serviette et le roman sont jetés à l’eau de la Manche. Arrivé en Angleterre, il dut donc réécrire son livre, ce qu’il trouva très pénible, et on le comprend. Le roman fut achevé à la fin de l’année 1942. Cesbron le fit parvenir à un ami qui le fit passer à un autre ami qui résidait en Suisse. Celui-ci, après l’avoir lu, le proposa à la Guilde du livre pour le concours de son Grand Prix qu’il remporta. Le livre fut édité en Suisse à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires et se vendit. Ce n’est qu’après la fin de la guerre que Cesbron put faire éditer son roman chez Robert Laffont, en 1947. Étrange destin qu’un livre qui aurait pu et dû ne pas exister, compte tenu du contexte. Ce prix lança Gilbert Cesbron dans le monde littéraire, où il poursuivit une carrière d’écrivain très riche.
Avec ce premier roman, l’auteur dit lui-même qu’il inaugure un cycle de l’enfance et de ses souvenirs personnels, composé de cinq romans :
- Les Innocents de Paris7 (1944)
- On croit rêver (1945)
- La Tradition Fontquernie (1947)
- Notre prison est un royaume (1948)
- La Souveraine (1949)
Source : Wikipédia
Les innocents de Paris, c’est Le Club des Cinq des « fortifs », à une époque où cette série était inconnue en France, puisqu’elle ne fut diffusée qu’à partir de 1956 dans notre pays. Mais l’univers n’est pas du tout le même. Ici, pas de vacances en bord de mer l’été, dans une villa cossue. C’est le Paris des années 1930 (il n’y guère de repères chronologiques utilisables), le monde du travail et surtout celui des petites gens. Autour de Paris, depuis la défaite de 1870, ont été édifiés des ouvrages de protection de la capitale, nommés les fortifications, vite abrégées en « fortifs », qui se sont révélées inutiles en 1914 et le seront encore en 1940. Après quoi elles seront détruites pour la plupart, pour gagner des espaces constructibles tout près de la ville de Paris intra-muros. Seuls quelques forts ont été conservés comme vestiges d’une autre époque (dont le Fort de Vincennes, vaste lieu d’archivage).
Sur ce cliché, on voit bien l’espace militaire du glacis de sécurité, à découvert, et les constructions hasardeuses qui sont venues s’accoler aux ouvrages militaires. Cet espace échappait alors aux règles d’urbanisme et, en grande partie, à la loi commune française. Elle fut surnommée « la zone[1] », par ses habitants et les romanciers réalistes des années 1920-1930. On en retrouve expression transportée en Amérique dans le grand film de Frank Borzage, Ceux de la zone, sorti en 1933.

Ce cliché rend bien compte de cet habitat spontané où résidaient des travailleurs pauvres, des chômeurs et des « irréguliers », selon les mots de l’époque.
Tout à fait délibérément, Cesbron a choisi d’ignorer l’angle de la pègre et du vice. A aucun moment il n’y fera la moindre allusion. Les gens qu’il décrit sont des pauvres ou des rejetés de la grande ville, qui peuvent y travailler mais qu’elle vomit le soir, pour les cacher dans ses zones sombres. Le roman de Cesbron sera, au contraire, un livre joyeux, comme l’enfance, avec ses moments de liesse et ses grandes peurs que cet âge amplifie à l’échelle de la catastrophe. L’auteur a presque trente ans lorsqu’il écrit ce premier livre, mais il a incontestablement gardé « l’esprit d’enfance », qui est le bien le plus précieux d’un écrivain, et que bien peu ont su conserver.
Les héros constituent une bande d’enfants, que la morale d’aujourd’hui dirait « livrés à eux-mêmes », ce qui n’a aucun sens dans le contexte de l’époque. Ces enfants ne sont pas abandonnés par leurs parents, ils sont laissés la bride sur le cou. Ce n’est pas du tout la même chose. Leurs parents mènent leurs vies d’adultes, besogneuses et sans rêves, et les enfants consument de toutes leurs forces leur enfance. Rappelons aux lecteurs les plus jeunes qu’il fut un temps où les gosses jouaient dans la rue avec les enfants du quartier et même ceux d’ailleurs, qu’ils rentraient souvent seulement aux heures des repas, lors des jeudis libres (avant l’institution du mercredi) et durant les vacances. Il n’y avait pas plus d’affaires sordides malgré cela, mais bien moins au contraire. Pourquoi donc ?
Ces enfants avaient découvert, dans un pâté de maisons précaires des fortifs une habitation abandonnée qu’ils avaient pris l’habitude d’occuper lors de leurs moments libres et qui était devenue, de fait, leur quartier général, sous le regard bienveillant des occupants des maisons voisines. Par la grâce de l’auteur, nous découvrons ce refuge en même temps que nous faisons la connaissance du groupe, qui comprend des grands et des petits. Les grands se surnomment Lancelot, Milord et Cypriano, il y a un âge médian, c’est Martin, le seul qui porte son prénom, et les deux petits, Le Gosse et Vévu. Ce dernier zozote énormément et a été ainsi surnommé à cause de sa façon de prononcer « Jésus », qui devient « Vévu ». Nous ne connaîtrons jamais l’identité véritable de ces enfants, preuve manifeste que Cesbron ne se situe pas sur le plan d’un réalisme civil, mais dans le monde de l’enfance où, nous l’avons tous vécu, les surnoms sont les seuls que nous utilisons et mémorisons, à tel point que, lorsque nous retrouvons, de longues années plus tard, des camarades d’enfance, ce sont ces surnoms qui nous viennent en premier aux lèvres. Dans le groupe existe une hiérarchie de fait, les deux petits et Martin sont des soldats, les trois autres sont des officiers, pour prendre une image militaire. L’enfance se construit par mimétisme sur la société des adultes. L’enfance chinoise n’est pas la même que l’enfance européenne ou amérindienne. La pureté originelle de l’enfant est très rapidement corrompue par le monde environnant, c’est inévitable. Sans doute est-ce cela le péché originel réel. Il existe une hiérarchie de fait dans le groupe de six et celle-ci va jouer un rôle majeur dans le récit. Les petits soldats exécutent des missions simples et doivent obéir, les grands pensent et dirigent. Cesbron s’y entend fort bien pour nous faire vivre, par Vévu interposé, cette situation de soumission-admiration. Vévu est tout entier captivé par Lancelot, qui lui apparaît comme le stratège infaillible du groupe, bien au-dessus de Milord et Cypriano. C’est cette admiration sans bornes qui le conduira à faire l’éloge de son camarade à un jeune homme qu’il va côtoyer durant sa nuit de prison, car Vévu va se retrouver arrêté par la police et gardé en cellule toute une nuit, à la suite d’une des opérations brillantes planifiées par les grands. Or, cet éloge finira par conduire Lancelot à sa perte, entraîné par ce jeune homme à commettre un vol qui tournera mal et dont il sera considéré comme le seul responsable. Là, l’histoire enfantine virera au drame dans le monde des adultes et une page se tournera pour l’équipe. L’auteur n’a pas cherché à nous narrer un conte ou à nous donner une nostalgie euphorisante : le réel cruel rattrape les enfants et le monde insouciant de leur âge se déchire brusquement et violemment. Mais, laissons-là, pour l’heure ce passage au drame.
Durant la plus grande partie du livre, l’auteur nous fait vivre les jeux et les projets des enfants. Il n’a pas son pareil pour trouver mots et phrases qui font mouche et nous emportent avec eux avec ces gamins des fortifs. Il n’est pas question de dévoiler le contenu complet du livre. Je choisirai seulement deux exemples remarquables. Le premier occupe le chapitre 2 du roman, au sujet duquel il faut citer une anecdote donnée par Paul Guth dans sa présentation générale de l’oeuvre de Cesbron (Volume I, La tradition Fontquernie, p. 19). Quand parurent en France Les innocents de Paris, Colette, alors très grand écrivain de la France enfin en paix, convoqua le jeune auteur pour lui dire qu’elle aurait voulu avoir écrit « ce chapitre du tunnel ». Ce chapitre, long d’environ vingt-cinq pages, aurait pu être une nouvelle, tant il a d’unité et de consistance. L’argument est simple : Milord, un des grands décide d’aller, seul, explorer un tunnel désaffecté qui se trouve près des fortifs et dont on lui a parlé avec un certain sens du secret. Qui ? Un des habitants du quartier des fortifs, que les gamins ont surnommé le Père Désormais, qui semble ne plus avoir toute sa tête. Il a laissé entendre qu’il y avait des choses surprenantes dans ce tunnel interdit aujourd’hui. Il n’en a pas fallu plus pour décider Milord à se lancer dans cette excitante exploration. Il laisse un message aux copains dans leur maison et s’en va seul affronter la noirceur du tunnel. Au bout de sa marche, pas toujours rassuré, il va découvrir un vieux wagon officiel datant de l’exposition universelle de 1900, qui a été remisé là, puis oublié. Ce wagon était destiné à accueillir les souverains européens. Il est donc luxueux dans son principe. Milord découvre ainsi de la vaisselle, des insignes de la République et d’autres restes de l’époque. Il est fasciné par sa trouvaille et se demande comment il va pouvoir tirer profit de cette découverte pour accroître son prestige dans le la petite confrérie. Mais hélas ! il entend du bruit et voit bientôt arriver le reste de la troupe, partie à sa recherche. Le secret est éventé, il doit le partager. Tous s’émerveillent devant cette pièce de musée. Puis, il faut rebrousser chemin et revenir à l’air libre, où la nuit est déjà tombée. Ce chapitre est en effet une petite merveille d’écriture qui se suffit à elle-même. Cesbron fait la démonstration de son talent et de son bel esprit d’enfance ; on comprend que Colette en ait été admirative, elle qui avait su si bien décrire les émois de sa jeunesse.
Pour le second exemple, j’avoue hésiter entre deux chapitres également passionnants : la nuit en prison de Vévu ou l’opération au Parc Monceau. Chacun de ces chapitres est une pure réussite. Je laisse mon lecteur découvrir le séjour en prison de Vévu – qui ne sera pas inscrit à son casier judiciaire, soyez rassurés d’avance !- qui est directement lié au chapitre III, vous verrez comment. Titré « Terreur au Parc Montceau », il ne faut pas en imaginer un film d’horreur. La petite bande, sous l’impulsion des chefs, les plus âgés, a décidé de se fixer des défis divers à accomplir durant la semaine de vacances. Ce sont le plus souvent des défis enfantins, souvent adaptés à l’âge des héros. Ainsi Le Gosse a pour mission de vérifier si c’est bien vrai que, sous le pont Alexandre, on entend ce que els gens disent sur l’autre rive. On le voit, en soi, ce défi en présente aucun danger, mais il peut être difficile a réaliser pour un jeune enfant, car il implique de se rendre jusqu’au pont Alexandre (III), plutôt éloigné de leurs bases. Vévu doit suivre jusqu’au bout un enterrement dans la banlieue de Paris (et ce pour la quatrième fois). Quant à Milord, il doit obtenir du Père Désormais une longue à ajouter à leur Trésor. Mais Lancelot estime que tous ces défis sont des bricoles. Lui leur propose un défi qui durera toute la semaine. C’est le récit de ce grand défi qui constitue la matière du chapitre III. Le cadre est très précis, c’est le Parc Monceau. Un Parc que Gilbert Cesbron connaît fort bien, puisqu’il est né, en 1913, dans la plaine de Montceau, tout près de ce grand espace vert urbain qui doit tout à Napoléon III. Ce sont donc ses souvenirs personnels qui vont lui servir à construire son récit. Un des personnages, après l’exposé du projet (dont nous ne savons rien au début), dit :
« Tu sais que tous les enfants des Riches vont jouer au Parc Montceau. » (P. 78.)
La majuscule au mot « riche » n’est pas une erreur ou une coquetterie de l’auteur. Elle est la racine du plan. Les Riches constituent, pour ces gamins issus de milieux prolétariens, une entité sociale dont ils sont exclus, à la fois socialement et spatialement. Le Parc Montceau et les fortifs sont deux univers disjoints, où vivent des personnes qui s’ignorent mutuellement, même si chacun sait que l’autre existe et qu’il n’a pas une bonne image de lui[2]. Le plan subversif de Lancelot consiste à semer la panique chez les bourgeois et les nourrices de leurs enfants. Cesbron va donc s’en donner à cœur joie, en inventant des perturbations diverses dont les six banlieusards seront les auteurs. Ainsi le jeudi, ils ont réussi à bouleverser toutes les étiquettes de la marchande de beignets du Parc, ce qui a entraîné des injustices vite flairées par les nourrice et un début de manifestation qui a contraint ladite vendeuse à plier boutique, non sans avoir été dévalisé des friandises les moins chères selon les nouveaux tarifs. Le lendemain, c’était la séance de Guignol qui avait été affichée gratuite, ce qui a évidemment entraîné des problèmes sérieux entre le public venu nombreux et les gérants. Ainsi tout au long de la semaine, des dérèglements nouveaux perturbèrent la vie de ce lieu plutôt calme. Tout cela culmine, le mercredi par une bataille rangée entre la bande des six et les enfants de riches qui se sont structurés, eux aussi, en bande. Cela se termina par l’arrivée d’une troupe d’agents de police, avertis par les populations fréquentant habituellement le Parc. Un des gardiens du Parc, qui a tout compris du manège, au fil des jours et repéré les responsables, avertit les garçons de l’arrivée de la police, mais le petit Vévu se fait distancer et finit par être attrapé par la police. Voici comment Vévu se retrouva au commissariat du quartier et finit par y passer la nuit. Ce chapitre est remarquablement construit et écrit ; l’auteur sait ménager le suspens et nous mettre du côté des fauteurs de troubles, comme ce brave gardien, le brigadier Petitbara, qui a sans doute retrouvé ses réflexes de classe le temps de quelques jours. Cesbron nous montre des enfants malins et organisés, mais il sait aussi ne pas leur faire réaliser de vrais forfaits. Ce qu’ils font ressemble à ce qui pouvait se faire autrefois lors des journées de Carnaval. Évidemment l’arrestation de Vévu est une catastrophe, d’autant plus que les autres n’y ont pas assisté. Ce séjour en prison va être le point de bascule du roman, car Vévu va y rencontrer un jeune homme qui est un vrai voyou. L’enfant, voulant briller va lui raconter les secrets de la bande et ainsi les mettre en danger futur.
Je ne dévoilerai pas plus du contenu de ce roman. Il faut le lire dans son intégralité et se laisser porter par cet esprit d’enfance qui l’anime. Mais on aurait tort de croire que c’est, comme je l’ai dit plus haut, une sorte de Club des Six des Fortifs. Il s’agit, derrière les récits aventureux des protagonistes, d’une véritable réflexion sur ce qu’on pourrait appeler la société des enfants , ses rapports avec celle des adultes, sa capacité à s’émerveiller, sa naïveté, donc sa faiblesse face aux gens mal disposés. Tout cela est esquissé, même la fin dramatique où Lancelot se trouve dans une situation grave à cause de ce jeune voyou qui l’a séduit et abandonné lorsque le danger était là.
Ce premier livre annonce cependant l’évolution ultérieure de l’auteur, qui deviendra un écrivain aux préoccupations sociales avérées. Nous venons d’évoquer la vision binaire des enfants, eux et les Riches. Tout au long de son œuvre abondante, Gilbert Cesbron sera attentif aux « petits », aux faibles, aux gens cabossés par la vie. Dans ce premier livre, il y a un chapitre très surprenant, le cinquième, dont le titre peut surprendre dans un tel ouvrage, « Paris en sang ». Il ne s’agit nullement d’une aventure des gamins, mais du récit de la Commune de Paris par un de ses anciens acteurs, devenu un vieillard malade. Or, il se trouve que ce vieillard est le père d’un des habitants du quartier des fortifs que l’auteur appelle « le photographe » ; un homme qui se promène toujours avec un parapluie et un appareil photographique. C’est en butant contre lui et en chutant que Vévu a été capturé par les forces de l’ordre. Car le photographe hante le Parc Monceau régulièrement. Les garçons le tiennent donc pour responsable de l’arrestation de Vévu et veulent se venger de lui, en le cambriolant. C’est Martin qui est désigné pour l’opération. Mais ils ignorent que cet homme loge avec son père. Celui-ci surprend Martin dans son exploration et le retient de force. Il va le forcer à écouter ses souvenirs de combattant communard. Quelque part, dans une interview, Cesbron, à propos de ce livre et de l’inclusion de cet épisode, explique qu’il voulait absolument mettre un passage sur la commune et qu’il a trouvé un stratagème pour cela. Le lecteur se rend bien compte que ce récit ne fait pas vraiment partie de la trame du roman, qu’il est une sorte d’appendice. Passons sur le contenu du récit, très vraisemblable, car l’auteur s’est bien renseigné. Ce qui est intéressant est le fait qu’il ait choisi de faire ce récit du point de vue d’un communard et non d’un versaillais. Certes, il ne cache pas les tueries qui ont été faites par les insurgés pour se défendre, mais on sent que son cœur est plutôt de leur côté, car ils sont le peuple de Paris (comme lui qui est un vrai parisien) assiégé et combattu par les bourgeois (les Riches du Parc Montceau). Ce vieillard, cinquante ans après les faits, vit encore dans son cauchemar, il a besoin d’en parler et, ici, singulièrement à un représentant de la jeune génération qui ignore tout de l’épisode. Les gamins renonceront à se venger du photographe, mais seront tout fiers de connaître son secret.
Ce livre est donc la naissance d’un auteur. On comprend très bien qu’il ait gagné le prix de la Guilde du Livre suisse, car il a une réelle fraîcheur et originalité de ton qui donnera le style Cesbron. Il est toujours émouvant de lire la première œuvre d’un auteur qui a connu le succès, comme ce fut le cas de Cesbron, un des plus gros vendeurs de livres des années 1950 à 1970. Il achève son ouvrage par cette mention très surprenante :
« ADIEU DONC, ENFANTS DE MON CŒUR 6 Octobre 1942. »
Comme Bernanos ou Camus, il ne fera jamais le deuil de son enfance et en cultivera l’esprit de livre en livre.
Jean-Michel Dauriac – Mai 2024 – Les Bordes/Beychac
[1] Pour plus de précisions, voir l’article de Wikipédia, qui est une bonne synthèse : https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Zone_(Paris)
[2] Cela me fait irrémédiablement penser à l’agglomération bordelaise où les habitants des deux rives de la Garonne nourrissent les mêmes sentiments et la même ignorance humaine. La rive droite est celle des travailleurs et prolétaires, hier les « classes dangereuses », qui ont toujours voté à gauche et donc sont « socialo-marxistes » comme le disait jacques Chirac avec un petit sourire manipulateur. La rive gauche est celle du centre de Bordeaux et des beaux quartiers de banlieue, population bourgeoise, fortunes du négoce et, jadis, du commerce des esclaves, avec le vote de droite qui convient. De nombreux élèves des lycées de la rive gauche n’ont jamais mis les pieds sur la rive droite, alors que les jeunes de rive droite viennent le samedi après-midi goûter à la vraie ville et à ses mirages (ceci est toujours d’actualité).
Leave a Comment