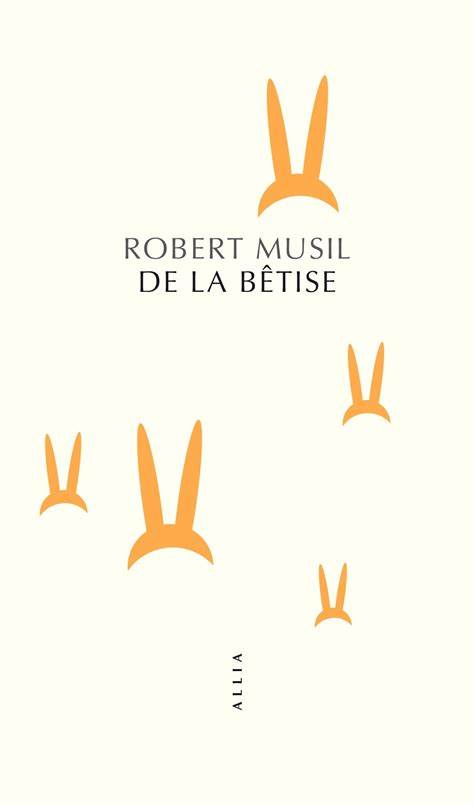Hildegarde de Bingen – Conscience inspirée du XIIe siècle
Régine Pernoud – Livre de poche
Hildegarde de Bingen serait restée parfaitement inconnue du grand public si la mode du bio et de l’alternatif ne s’était pas développée. En effet, ce sont ses écrits « médicaux » qui ont été portés à la connaissance du public et utilisés par des artisans du bricolage ésotérico-naturaliste. Or, ce serait une grave erreur de réduire cette femme à cette catégorie d’écrits et d’en faire une sorte de coach de bien-vivre médiéval. C’est pourtant ce qui lui est arrivé. Essayons de lui rendre justice, à partir du livre de Régine Pernoud, historienne médiéviste reconnue.

Régine Pernoud (1909-1998), au soir de sa vie
Le XIIe siècle est celui d’une première Renaissance européenne, éclipsée par celle des XV et XVIe siècle. Des personnages de premier plan pour l’histoire spirituelle et culturelle de notre continent vivent à cette époque. Je donne ci-dessous une liste incomplète de quelques noms importants :
- Pierre Abélard (1079-1142) – Philosophe, théologien et logicien, il est connu pour ses débats intellectuels avec Bernard de Clairvaux et pour sa relation avec Héloïse. Il est l’un des plus grands penseurs du Moyen Âge, ayant influencé la philosophie scolastique.
- Bernard de Clairvaux (1090-1153) – Moine cistercien, mystique et réformateur, il est un acteur clé dans le renouveau monastique au XIIe siècle. Il est aussi un ardent défenseur de la deuxième croisade et joue un rôle important dans la propagation de l’ordre cistercien.
- Hildegarde de Bingen (1098-1179) – Mystique, abbesse et érudite allemande, Hildegarde a influencé la pensée religieuse et scientifique du Moyen Âge. Ses œuvres théologiques et ses compositions musicales ont traversé les frontières et inspiré la France médiévale.
- Héloïse (1100-1164) – Philosophe et abbesse, elle est surtout connue pour sa correspondance avec Pierre Abélard. Elle dirige l’abbaye du Paraclet et est une figure emblématique des intellectuelles du Moyen Âge, ayant laissé des écrits influents.
- Jean de Salisbury (1115-1180) – Philosophe et évêque de Chartres, il est un écrivain influent du Moyen Âge et un ardent défenseur de la philosophie scolastique. Il est l’auteur de Policraticus, une des premières œuvres de philosophie politique.
- Thomas Becket (1119-1170) – Archevêque de Canterbury, il est une figure religieuse marquante du Moyen Âge, bien qu’il soit anglais, ses relations avec la France sont importantes. Il s’oppose à Henri II d’Angleterre, ce qui entraîne son martyre et sa canonisation.
Source : https://www.histourismo.fr/grands-personnages/les-grands-personnages-du-moyen-age-en-france/
Nous notons que tous sont des religieux, car la vie culturelle se résume à l’œuvre des religieux, sauf en poésie. Hildegarde de Bingen est donc comptée parmi ces grands personnages, la seule femme de la liste (on pourrait lui adjoindre Aliénor d’Aquitaine). Elle est ici signalée pour ses œuvres théologiques et ses compositions musicales, elles aussi devenues fort à la mode.
Le sous-titre du livre de R. Pernoud est important : conscience inspirée du XIIe siècle. Cela laisse entendre que cette femme fut un grand témoin du siècle, que sa voix portait et qu’elle est reconnue pour être une des grandes « inspirées » du Moyen Âge. Le livre va développer ces trois aspects et tiendra donc toutes les promesses de son sous-titre.
Initialement pourtant, rien ne prédestinait cette fille de la petite noblesse du Palatinat à devenir ce qu’elle fut.

Le Palatinat est la région qui correspondrait actuellement à la Sarre et une partie de la Rhénanie. Trèves, Cologne et Aix-La -Chapelle seront les limites extrêmes des voyages d’Hildegarde. A la différence de Bernard de Clairvaux, elle ne parcourra pas l’Europe et quittera rarement le monastère qu’elle dirige, dans la petite ville de Bingen Am Rhein. Hildegarde est confiée à un monastère à 9 ans par sa famille, elle vivra en religieuse jusqu’à sa mort. Il est très clair qu’elle n’a pas choisi son destin, mais qu’elle a subi un sort très commun pour les filles de la noblesse au Moyen Âge. C’était le monastère ou le mariage forcé dès la sortie de l’enfance. Le choix de ses parents fut peut-être le meilleur pour leur fille, car les unions étaient souvent malheureuses et les femmes forcées et cloitrées au château. Cloitrée pour cloitrée, elle fut plus libre au monastère.
L’ouvrage ne vise pas à être une biographie exhaustive de la moniale du XIIe siècle. Tout d’abord, parce que nous ne sommes pas renseignés sur tous les détails de cette vie, qu’il y a de nombreuses lacunes. Nous connaissons surtout sa vie religieuse, par les récits de ses contemporains et les lettres qui nous sont parvenues. Sa vie personnelle semble d’ailleurs s’être confondue avec sa vie de moniale, ce qui se comprend aisément quand on sait que depuis l’âge de neuf ans elle a vécu en monastère. De même, nous ne savons rien de sérieux sur son apparence physique, mais il semble qu’elle ait été assez petite et de santé problématique – ce dont nous sommes certains par ses écrits -, ce qui l’a conduite à s’intéresser à la manière de se soigner et lui fera développer toute sa connaissance de naturopathe avant l’heure. Elle a passé une bonne partie de sa vie alitée, entourée du soin de ses sœurs. Elle a donc, durant sa vie de moniale et de mère supérieure de ses monastères, mené une double existence dont les deux faces sont intimement imbriquées. Elle fut religieuse chrétienne, engagée totalement dans la voie du Christ et, en même temps, une grande créatrice dans plusieurs domaines.
Sa vie religieuse est éminente et a largement contribué à sa renommée dans la chrétienté médiévale. Ses seules sorties furent d’ailleurs pour se rendre à des conclaves ou des assemblées religieuses où elle intervenait à la demande des religieux, abbés ou évêques. Elle était en effet connue pour sa grande sagesse : les hommes et les femmes de son temps, y compris les plus puissants, la consultèrent pour avoir son conseil en des moments délicats. De plus, elle avait reçu des visions prophétiques qu’elle avait transcrites et dont elle a publié les textes. Ce sont ces textes qui ont inscrit Hildegarde dans le grand ordre des mystiques … R. Pernoud donne de larges extraits commentés de ces visions, souvent eschatologiques -c’est-à-dire en lien avec les temps de la fin de ce monde, selon la tradition judéo-chrétienne -, et bien situées dans la ligne des grands prophètes des derniers temps de la Bible juive (Ezéchiel et Daniel, surtout). Ces visions ont été reconnues authentiquement chrétiennes par les papes de son époque et lui ont donné une grande autorité spirituelle. Bernard de Clairvaux lui-même lui a écrit en reconnaissant la valeur de ses charismes. De plus, Hildegarde fut une abbesse particulièrement attentive à ses sœurs et très aimée d’elles. Elle a donc eu, au sens le plus large une sainte vie, ce qui n’est pas nécessairement une vie de sainte[1].
En parallèle, avec cette très riche vie de foi, elle a su développer une vie de culture personnelle très originale et profonde. La (re)découverte de ses compositions musicales, il y a une trentaine d’années, en a fait une compositrice d’avant-garde, dans une civilisation qui invisibilisait facilement les femmes. En réalité, ses compositions ne sont pas vraiment novatrices, mais s’inscrivent dans la tradition du chant liturgique, avec une grande fraîcheur. On en trouve maintenant pas mal d’enregistrements ( à titre d’exemple, la page de la FNAC correspondant à son nom : https://www.fnac.com/ia142803/Hildegard-Von-Bingen ) de ses compositions.
C’est sans doute dans le domaine de la santé qu’elle a connu le succès populaire el plus net. Là aussi, la mode des médecines douces et alternatives lui a rendu un grand service : ses écrits sur la santé, les plantes et leurs propriétés sont maintenant considérés comme les premiers écrits médicaux du Moyen Âge. Ils ont donc envahi les rayons de naturopathie et de développement personnel, la mettant en quelque sorte en position de coach de vie bonne et bio. Il faut raison garder : elle n’a pas inventé la phytothérapie ! elle a consigné des recettes de l’époque et a su observer et innover dans cette tradition.
Enfin, elle fut aussi poétesse : Pernoud achève son livre par trois poèmes de notre auteur. Sa poésie est entièrement chrétienne, baignant dans le climat de renaissance spirituelle du XIIe siècle dont elle fut une actrice majeure.
Le petit livre de Régine Pernoud est une excellente introduction à l’univers de l’abbesse allemande. Il permet d’aborder toutes les facettes de cette vie à la fois minuscule et gigantesque. Libre ensuite à chacun d’en rester là ou d’aller approfondir par des lectures directes de la sainte catholique. Je conseille donc vivement ce livre aux lecteurs curieux de mieux connaître la réalité intellectuelle et sensible du Moyen Âge, au-delà des clichés sur les châteaux forts, tournois et autres croisades.
Jean-Michel Dauriac – juin 2025 – Les Bordes.
[1] La théologie biblique ne connaît pas les saints au sens catholique des termes, avec un processus de béatification et de canonisation, des miracles et un culte qui en découle. Le « saint » du Nouveau Testament (au sens paulinien et pétrinien du terme) est un « mis à part » pour Dieu, ce qui est la condition commune du converti-baptisé qui marche selon la foi du Christ. Il n’est évidemment pas inutile de reconnaître les vies les plus édifiantes et justes et de les donner en exemple, mais en aucun cas un culte ne doit leur être rendu et ils ne jouent aucun rôle d’intermédiaire dans la prière : on prie seulement le Père, au nom du Fils dans une saine lecture des Ecritures. Tout le reste est tradition humaine surajoutée.
Leave a Comment