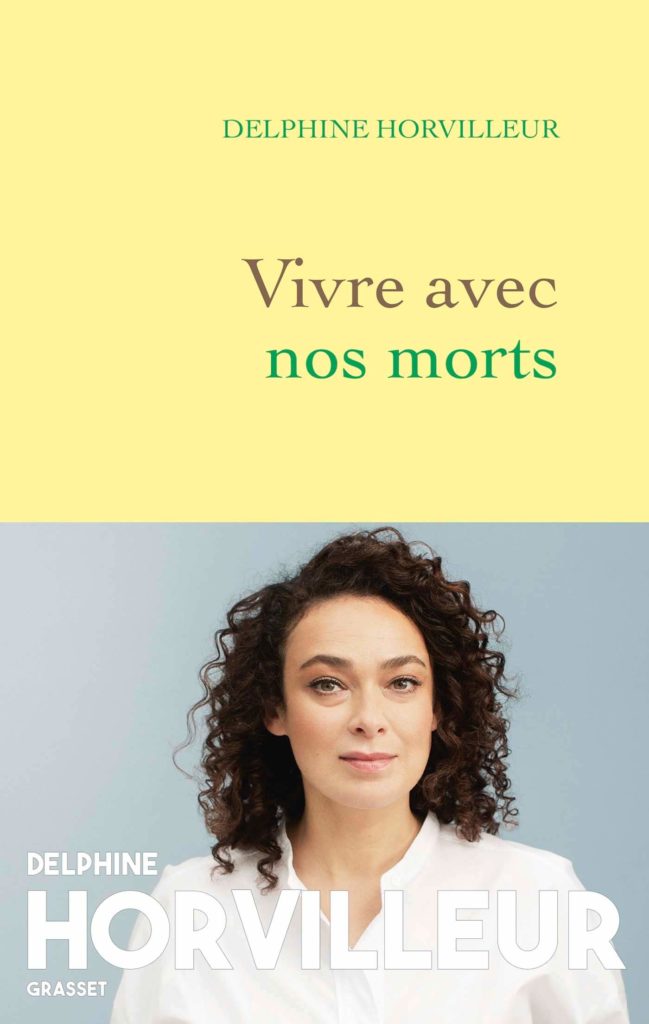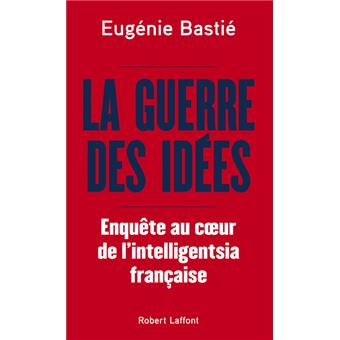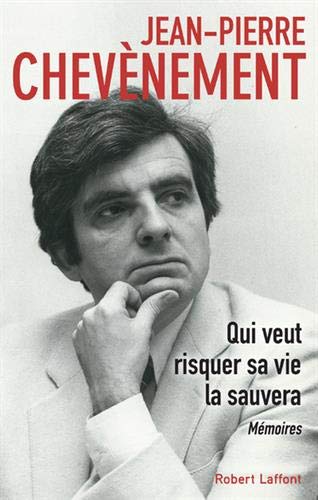Paris, Grasset et Fasquelle, 2021.
Sortir, au temps du Covid, un livre titré Vivre avec nos morts peut sembler relever de la provocation. D’autant plus que le titre lui-même est un oxymore. Or, quiconque a perdu un être cher sait bien que nous vivons entouré de nos morts. Ils sont plus ou moins discrets, plus ou moins nombreux, mais ils hantent notre vie, sporadiquement pour certains, continûment pour d’autres. En réalité, ce livre tombe plutôt à point nommé, dans un temps où la mort s’est faite bien plus visible et a quitté le paravent des EPAHD pour envahir nos écrans de télévision et nos journaux. Disons de suite que le livre ne traite pas du tout des morts du Covid, mais s’inscrit dans une démarche bien plus large, qui est celle de la manière d’accompagner les familles lors d’un décès. C’est donc, au sens théologique, un ouvrage de pastorale. Mais il n’est évidemment pas réservé aux ministres du culte et il faut en recommander la lecture à tous.
La plupart des chapitres portent des noms des prénoms de personnes décédées que l’auteur a connu et/ou accompagnées. Le choix très large permet de parler aussi bien des hommes que des femmes, des enfants comme des vieillards, des malades comme des bien-portants. Chaque chapitre met très adroitement la lumière sur un thème², à partir des circonstances du décès. On traitera ainsi successivement de la laïcité,, de la mort des enfants, de la Shoah… Il s’agit donc d’un livre de citoyenneté également, qui peut servir de base pour un dialogue de société.
Mais le lecteur trouvera aussi dans ce texte un art consommé du portrait, qui rappelle que l’auteur est un écrivain. La lecture est donc largement facilitée par la fluidité du style.
Un troisième trait distingue pourtant radicalement ce livre d’un essai ordinaire. C’est avant tout une très belle introduction au judaïsme, par la petite porte des funérailles. Le lecteur qui ignore totalement ce que peut être le judaïsme sera sans doute un peu dépaysé, mais s’il fait l’effort de mémoriser ce qu’il rencontre, il sortira de ce livre avec une certaine idée de la religion juive. Delphine Horvilleur a l’intelligence de distiller à très petites doses les informations religieuses et théologiques, ce qui rend son texte lisible par tous les publics. Et pourtant, le judaïsme est partout ! Ici, une citation du Talmud, là une coutume évoquée, ailleurs une cérémonie décrite. Il s’agit d’une imprégnation homéopathique, pas d’un cours.
On voudrait citer de nombreux passages, tant le livre est riche et réussi. Mais il faut se limiter, pour laisser le futur lecteur faire ses découvertes. Je ne citerai donc que quelques phrases prises au long de la lecture.
Voici une intéressante définition de la laïcité, tiré du chapitre intitulé « Elsa » :
« La laïcité française n’oppose pas la foi à l’incroyance. Elle ne sépare pas ceux qui croient que Dieu veille, et ceux qui croient aussi ferme qu’il est mort ou inventé. Elle n’a rien à voir avec cela. Elle n’est fondée ni sur la conviction que le ciel est vide ni sur celle qu’il est habité, mais sur la défense d’une terre jamais pleine, la conscience qu’il y reste toujours une place pour une croyance qui n’est pas la nôtre. La laïcité dit que l’espace de nos vies n’est jamais saturé de convictions, et elle garantit toujours une place laissée vide de certitudes. Elle empêche une foi ou une appartenance de saturer tout l’espace. En cela, à sa manière, la laïcité est une transcendance. Elle affirme qu’il existe toujours en elle un territoire plus grand que ma croyance, qui peut accueillir celle d’un autre venu y respirer. » (p. 28-29).
Le livre tourne autour du thème de la mort. Le judaïsme, matrice des grands monothéisme, aborde évidemment ce sujet. Mais nous sommes souvent ignorants, nous les chrétiens ou les musulmans, des croyances juives. Voici un autre extrait sur la vie post-mortem.
« La Thora ne parle pas de vie après la mort. Les personnages, un à un, meurent, et pour certains à un âge très avancé. De Noé à Mathusalem en passant par tous les patriarches et leurs familles, au jour de leur mort, il est simplement dit d’eux qu’ils « rejoignent les leurs » (Genèse 35 :29 ou Genèse 49 :33) ou « dorment avec leurs pères » (1 Rois 2 :10). Leur disparition les inscrit simplement dans la lignée de ceux qui les ont précédés, et ils quittent le monde dorénavant habité par ceux auxquels ils ont donné naissance. » (p.115)
L’homme s’inscrit, pour le judaïsme, dans la suite des générations qui peuplent la terre. D’où la manière d’ensevelir els défunts :
« Dans le judaïsme, le défunt n’est pas enterré dans une tenue de ville ou dans ses « vêtements du dimanche ». Avant d’être inhumé, il est préparé, lavé puis paré d’une tunique blanche spécifique dans laquelle il sera enterré. Cet habit reproduit symboliquement une autre tenue, à laquelle la Bible fait référence. Il s’agit du vêtement que portait le Grand Prêtre lorsqu’il officiait au Temple de Jérusalem il y a plus de deux mille ans.
La Thora décrit précisément comment le Grand Prêtre se purifiait, procédait à des ablutions et enfilait ses vêtements, tandis qu’il s’apprêtait sur l’autel à faire face au Créateur. Au Temple, le Cohen était l’homme qui pouvait approcher au plus près le divin, le seul qui avait le droit de pénétrer le Saint des Saints, c’est-à-dire le droit de se tenir devant le Dieu invisible. Dans la tradition juive, chaque homme au jour de son inhumation endosse le même rôle sacerdotal. Il est lavé et paré des mêmes attributs, tandis qu’il s’apprêt lui aussi à rencontrer le divin. Son corps est enveloppé dans un linceul qui reproduit tous les éléments de la tenue sacerdotale. Chaque homme qu’on enterre est un Grand Prêtre, au jour de son départ. Il se prépare au même face-à-face. » (p. 49-50)
Le lecteur pourra ainsi mesurer la distance que le christianisme a pris au fil du temps avec la simplicité symbolique des débuts : nos sarcophages et lourds cercueils de bois ou de métal sont bien destinés à nous protéger d’une corruption cependant inévitable et inscrite dans le cycle de la vie. Les Juifs sont, jusque dans la mort le peuple de l’Alliance. Que font, au moment du décès, les chrétiens de la Nouvelle Alliance ? Question abyssale qui dépasse évidemment le cadre de cette recension.
Enfin, évoquons, encore par une citation, le lieu de repos des morts.
« Où vont les morts ? Le seul lieu auquel la Thora fait explicitement référence est un endroit nommé Shéol où descendraient les disparus (voir Genèse 37 :35, « Je descends au Shéol endeuillé ».) S’agit-il d’un territoire ou d’un monde souterrain ? Le texte n’en dit rien. Mais l’étymologie du terme est éloquente. ²²² vient d’une racine qui signifie littéralement « la question ». On pourrait donc l’énoncer ainsi : après notre mort, chacun de nous tombe dans la question, et laisse les autres sans réponse ; Débrouillez-vous avec cela. » (P. 116)
On est bien loin des certitudes ou pseudo-certitudes que les chrétiens ou les musulmans ont construit autour de la notion de Paradis. La question (shéol) reste ouverte et nous sommes condamnés à n’avoir que cette non-réponse si l’on est juif ou si l’on prend au sérieux le Premier Testament.
Mais le lecteur aurait tort de croire que ce livre est un ouvrage rébarbatif de théologie. Les quelques extraits que je viens de citer sont presque les seuls de cette nature. Le reste est beaucoup plus narratif. Il faut renvoyer le lecteur au chapitre « Marceline et Simone : au jour du Jugement », qui est un des plus drôle et des plus réussis de ce livre. Delphine Horvilleur y parle des « filles de Ravensbrück », comme se nommaient elles-mêmes Simone Veil et Marceline Loridan-Ivens, deux survivantes de la Shoah. On ne peut imaginer deux personnalités plus différentes, et pourtant elles furent amies à la vie à la mort. Comme ce chapitre, chaque thème recèle des perles que je vous laisse découvrir.
J’avais chroniqué, il y a quelques années, le premier livre d’ D. Horvilleur, En tenue d’Eve. Il faisait déjà preuve des qualités qui se sont épanouies depuis et que ce dernier ouvrage met clairement en lumière. Vivre, c’est accepter que la mort nous attende. Tout déni est porteur de dysfonctionnements, tant personnels que sociétaux. Si cette « pandémie » de Covid19 avait seulement servi à remettre la mort dans la vie et nos morts dans notre vie, alors elle aurait été utile. Bonne lecture et bonne réflexion.
Jean-Michel Dauriac
2 Comments