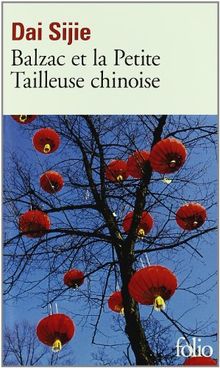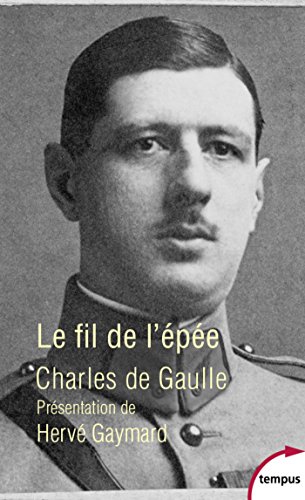Folio Histoire, Gallimard, 2021 (1990 1ère édition)
Il y a fort longtemps que j’ai entendu parler de ce livre et que je connais son auteur, historien de qualité que j’ai fréquenté durant mes études, notamment pour son ouvrage sur le Moyen Age. Mais il y a aussi fort longtemps que je différais le moment de le lire. Il y avait toujours plus important à lire qu’un livre sur la défaite de mai-juin 1940 ! C’est en fait la période de crise sanitaire actuelle qui m’a poussé à enfin passer à l’acte. Non parce que je disposais de plus de temps, mais parce que j’ai lu sous quelques plumes averties le titre cité en allusion à ce qui nous arrivait et que j’ai voulu savoir quel lien il pouvait y avoir entre ces deux moments si différents de l’histoire française : une défaite militaire devant l’armée allemande et une défaite sanitaire devant un virus baptisé Covid19. Disons de suite qu’il n’y a aucun lien direct entre ce que décrit ce livre et ce que nous vivons depuis février 2020. Mais on ne peut en effet éviter le lien analogique de cette analyse.
Marc Bloch est capitaine de réserve au moment de la « drôle de guerre » de 1939-40. Il a alors cinquante quatre ans, il n’est plus mobilisable, c’est lui qui demande à être incorporé, car il n’envisage pas de rester inactif alors que la France est en guerre. Il est ancien combattant de la Première Guerre Mondiale, qu’il a terminée avec le grade capitaine. Mais il est surtout, à cette époque, un des plus grands historiens de France, co-fondateur de ce que l’on a appelé l’école des Annales, du nom de la revue qui l’a suscitée et faite connaître. Il a à son actif la publication de grands livres et une carrière d’universitaire respecté. Comme son nom l’indique, il est d’origine juive, mais complètement assimilé et pas du tout religieux. C’est un authentique patriote, pour lequel l’amour de la France est premier. Ce livre en apporte une preuve irréfutable. Devenu résistant après la débâcle et l’armistice, honteux pour lui, il sera arrêté et torturé, emprisonné de longs mois et finalement fusillé en 1944, avec d’autres résistants. Il a alors 58 ans.
Ce livre est d’abord un témoignage de soldat. Le capitaine Bloch n’a pas supporté la défaite de juin 1940 ; Il cherche à dire ce qui s’est passé sous ses yeux, puis à comprendre pourquoi cela s’est passé. Le livre comporte trois parties inégales : la première est un autoportrait en soldat et ancien combattant, qui vise à justifier et expliciter ce qui va suivre ; la deuxième est ce qu’il appelle la « déposition d’un vaincu » ; la troisième est l’analyse des circonstances et le portrait des hommes de cet effondrement militaire. On comprend à la lecture de ces pages que ces écrits ne sont pas, initialement, entrepris pour donner lieu à un livre et être publié. Il s’agit d’abord pour l’auteur d’un double exercice. Bien que ce ne soit jamais vraiment dit, il est clair que ce travail d’écriture a une fonction thérapeutique, c’est une sorte d’auto-psychanalyse, comme le prouve bien le titre de la troisième partie : « Examen de conscience d’un Français ». Mais au-delà de cette nécessité morale et personnelle, il s’agit de laisser pour les générations futures un récit clair et une réflexion méthodique sur cette « étrange » défaite-éclair. Je pense que l’on peut tout à fait comparer ces pages aux journaux des soldats de 14-18, dont seuls quelques-uns ont été publiés, mais dont la totalité forme un témoignage direct incomparable pour les chercheurs. Ce choix explique aussi la grande sincérité des propos, qui ne traduisent aucune autocensure apparente. Le ton est vif et les critiques très acérées. Bloch frappe au cœur et n’épargne aucun des rouages de la vaste pyramide des causalités de cette défaite. N’étant pas officier d’active il a une liberté de parole qu’un militaire de carrière ne saurait avoir.
La question que (se) pose Marc Bloch est simple : Pourquoi cette défaite inexorable et extrêmement rapide en mai-juin 1940 ? Un bon élève de Première ou de Terminale devrait pouvoir poser cette question, pour peu qu’on lui en donne le temps et les moyens. Sans nul doute des millions de Français se la sont posées in petto. Le titre de l’ouvrage apporte déjà un premier élément de réponse : pourquoi qualifier d’« étrange » cette défaite-éclair ? Je ne vais pas ici faire un cours d’histoire qui, autrefois revenait aux professeurs de lycée et, maintenant, est devenu strictement universitaire, tant les horaires et les programmes sont passés à la moulinette. Il suffit de rappeler que la France se débat depuis le début des années 1930 dans une crise politique larvée, inscrite elle-même dans le contexte de montée des fascismes partout sur le continent européen. Elle n’échappe que de peu à la tentation totalitaire. Mais la victoire à la Pyrrhus du Front Populaire de 1936 ne fait qu’accentuer la fracture interne au pays. Pendant ce temps les Etats totalitaire s’arment et préparent l’affrontement qu’ils jugent nécessaire et inévitable. La Guerre d’Espagne aurait pu être un électrochoc pour la France, elle ne fut qu’une reculade incompréhensible de Léon Blum, dont l’histoire a fait le bilan tragique. La tension monte et les dirigeants français et anglais reviennent de Munich en ayant « sauvé la paix » ; nous sommes en septembre 1938 ! Moins d’un an plus tard, Hitler donne l’ordre d’attaquer la Pologne, défaite en quelques semaines. Les Français en profitent-ils pour se préparer ardemment à l’assaut ? Que nenni ! Les soldats français jouent au football devant la Ligne Maginot. Lorsque l’armée allemande a fini son travail de conquête à l’Est (Pologne, Finlande), elle s’attaque à l’Ouest ; donc à la Belgique et à la France (et indirectement au Royaume Uni). En quelques semaines l’armée belge est désarmée et les troupes françaises débandées, avec un grand nombre de prisonniers de guerre et de morts. Cette fois-ci, il n’y aura pas le sursaut de la bataille de la Marne au bout, mais l’humiliante demande et signature d’armistice, mise en scène comme il se doit par Hitler, dans le wagon de la clairière de Rethondes, là-même où l’Allemagne avait capitulé en novembre 1918. Marc Bloch vit tout cela, en tant que citoyen français, en tant qu’ancien combattant et en tant qu’officier de réserve engagé. Il a besoin de coucher sur le papier ses réflexions, tant il est abasourdi par ce qu’il voit lui-même et récolte comme témoignages directs. C’est la première partie de son analyse, « La déposition d’un vaincu ». Je n’ai pas l’intention de vous livrer un résumé séquentiel de ses propos : il faut les lire in extenso. Il entreprend de faire la synthèse de cet enchaînement de reculs et d‘abandons, à la fois sur le terrain et dans les têtes des militaires. C’est la combinaison des deux niveaux qui donne sa force à ce témoignage. Il va considérer tour à tour les divers acteurs et dégager leurs responsabilité dans cet effondrement militaire. Nul n’est épargné, du simple soldat aux plus hautes autorités du pays. C’est ici que la maîtrise historique et technique de Bloch fait merveille. Ses différentes critiques s’articulent en douceur, selon un plan bien net mais jamais sensible ni visible. La lecture est terrible mais très aisée. Je vous propose un petit choix de citations, parfois commentées, qui dégageront la structure du texte.
« Que le père Joffre était donc plus sage ! « Je ne sais pas, disait-il, si c’est moi qui ait gagné la bataille de la Marne. Mais il y a une chose que je sais bien : si elle avait été perdue, elle l’aurait été par moi. » Sans doute entendait-il surtout rappeler, par là, qu’un chef est responsable de tout ce qui se fait sous ses ordres. Peu importe qu’il n’ait pas eu lui-même l’initiative de chaque décision, qu’il n’ait pas connu chaque action. Parce qu’il est le chef et a accepté de l’être, il lui appartient de prendre à son compte, dans le mal comme dans le bien, les résultats. » (p.55)
Le lecteur comprend bien qu’en ouvrant ce bilan par ces propos, Marc Bloch va mettre directement en cause l’Etat Major français et les ministres concernés. Dans les pages qui suivent, nous trouverons de nombreuses réflexions sur ce qu’est ou devrait être un chef. Je ne puis m’empêcher de rapprocher ces pages de celles d’un petit livre publié en 1932 par un capitaine de l’armée française, Le fil de l’épée, où Charles de Gaulle disserte devant des militaires sur ce qu’est l’autorité d’un chef[1]. Bloch a une conception tout à fait proche de celle de De Gaulle : il aime l’ordre.
« Je n’apprécie guère, je l’avoue, le négligé dans les choses ; il passe aisément à l’intelligence. « (p. 89)
« Un médecin de l’armée, qui fut mon compagnon au 4ème bureau de l’état-major, aimait à me persifler gentiment en m’accusant, moi vieux professeur, « d’avoir plus que personne l’esprit militaire » : ce qui, d’ailleurs, signifiait tout bonnement, j’imagine, que j’ai toujours eu le goût de l’ordre dans le commandement. » (p. 33)
Ce rappel pour montrer que Bloch n’est absolument pas un antimilitariste camouflé. Il est un homme épris d’ordre, de discipline et aime l’autorité et le respect. Mais, justement à cause de ce trait de caractère, il ne peut excuser ce qu’il a vu : des officiers fuyant en abandonnant leurs hommes, d’autres admettant trop vite la défaite ou certains optant pour un détachement cynique. C’est que la France était en jeu ! Là encore, nous trouvons un autre point commun fort entre De Gaulle et Bloch : l’amour de la patrie porté au point le plus haut, celui qui peut imposer le sacrifice de sa vie.[2] Ce que Bloch remet en cause c’est une forme d’esprit installé chez les militaires et qui les a empêchés de réagir. C’est ce que De Gaulle appelait la Doctrine dans son essai.
« Beaucoup d’erreurs diverses, dont les effets s’accumulèrent, ont mené nos armées au désastre. Une grande carence, cependant, les domine toutes. Nos chefs ou ceux qui agissaient en leur nom n’ont pas su penser cette guerre. En d’autres termes, le triomphe des Allemands fut, essentiellement, une victoire intellectuelle et c’est peut-être là ce qu’il y a eu de plus grave. » (p. 66).
Pour parodier un titre d’essai, la défaite de 1940 fut une « défaite de la pensée[3] ». De Gaulle, dans son essai, mettait en cause les doctrines enseignées à l’Ecole de Guerre, à propos de la Première Guerre Mondiale. Il en fut de même pour la Seconde. Quelle fut l’erreur de pensée ?
« Les Allemands ont fait une guerre d’aujourd’hui, sous le signe de la vitesse. Nous n’avons pas seulement tenté de faire, pour notre part, une guerre de veille ou de l’avant-veille. » (p. 67).
Ce que Bloch dénonce ici c’est le contraste entre la Blitzkrieg (guerre-éclair) des Allemands et notre guerre de position, avec notre Ligne Maginot. De même qu’en 1914 nous avions été surpris par l’opération de contournement des Allemands par le Nord-Ouest, nous l’avons été de la même manière vingt ans plus tard. Donc nous n’avions rien appris durant ce laps de temps !
« Notre propre marche était trop lente, notre esprit également, trop dépourvu de promptitude, pour nous permettre d’accepter que l’adversaire pût aller si vite. » (p.75).
No officiers ont oublié l’héritage stratégique de Napoléon Bonaparte, ce sont les néo-Prussiens qui l’ont cultivé ! C’est bien une défaite de la pensée nationale. Nous avions foi dans les plans et les doctrines, celles qui disent comment l’ennemi doit agir et réagir.
« Ils croyaient [les Allemands] à l’action et à l’imprévu. Nous avions donné notre foi à l’immobilité et au déjà fait. » (p.79).
La foi erronée des officiers supérieurs s’est bien évidemment transmise aux échelons inférieurs et a paralysé les troupes, incapables de réagir dans les temps à l’avancée allemande. Ailleurs Bloc dit quelque chose comme « L’ennemi n’aurait pas dû être là. » Et pourtant il y était. Il y a donc, en premier lieu, une énorme responsabilité des chefs militaires. Mais elle n’est pas la seule. Elle se conjugue avec la manie administrative et procédurière française, qui a gagné aussi les armées. Jugez-en plutôt avec cet extrait assez ironique :
« Quel officier, ayant servi dans une région ou un groupe de subdivisions, peut se remémorer sans un triste sourire, l’invraisemblable maquis des « mesures » prévues, numéro après numéro, pour la période dite « de tension », qui devait précéder la mobilisation générale ? Tiré en pleine nuit, d’un demi-sommeil, par le télégramme qui prescrivait, par exemple, « Appliquez la mesure 81 », on se reportait au « tableau », sans cesse tenu à portée de la main,. C’était pour y apprendre que la mesure 81 faisait jouer toutes les dispositions de la mesure 49, à l’exception des décisions d’ores et déjà entrées en vigueur par application de la mesure 93, si celle-ci, d’aventure, avait devancé, dans l’ordre des temps, la place qu’eût semblé lui assigner son numéro, cela toutefois en ajoutant les deux premiers articles de la mesure 57. Je donne ces chiffres un peu au hasard. Ma mémoire ne me permet pas une exactitude littérale. Tous mes camarades reconnaîtront que, pour le fond, je simplifie plutôt. » (p.92-93).
Tout fonctionnaire français reconnaîtra là la démarche de son administration. Il suffit de lire le journal officiel pour comprendre quel est le taillis inextricable que représentent les textes dans notre pays. En temps de paix et dans le civil, c’est la paralysie et le retard, en temps de guerre, c’est la défaite assurée. Marc Bloch ne dit pas autre chose.
L’étrange défaite est donc la conjonction de l’incapacité des chefs à sortir de leurs doctrines et à penser l’imprévu et celle de l’administration des hommes et des choses, purement bureaucratique et réglementaire, quand il faudrait de l’initiative et de la liberté de jeu. Cependant, pour le capitaine Bloch, cela n’est pas suffisant pour expliquer cette déroute. Il existe des facteurs plus larges et individuels. C’est ce qu’il va analyser dans la partie « Examen de conscience d’un Français » .
« Dans une nation, jamais aucun corps professionnel n’est, à lui seul, totalement responsable de ses propres actes. Pour qu’une pareille autonomie morale soit possible, la solidarité collective a trop de puissance. » (p.159).
Il y donc une responsabilité en partie partagé par les Français autres que les militaires. La relative insouciance des terres de l’arrière du combat est aussi à mettre en jeu. C’est le syndrome des « planqués de l’arrière » de 1914-18. Il est certain que cela a joué, au moins au début du conflit présent. Ce n’est que lorsque les Allemands ont débarqué dans les rues de leurs villes que les civils ont réalisé la situation, ce qui a entrainé cette immense vague de réfugiés que l’on a surnommé « l’exode de juin 40 ». Mais auparavant, tout ou presque avait été fait pour que les civils ignorent cette guerre et ne s’y sentent pas partie prenante. Bloch dénonce les très nombreuses exemptions à la mobilisation générale, qui furent exactement à l’inverse de celle de 1914. Il a ces phrases très sévères :
« Aussi bien, devant le sacrifice, on ne saurait concevoir d’exceptions. Nul n’a le droit de croire sa vie plus utile que celle de ses voisins, parce que, chacun, dans sa sphère, petite ou grande, trouvera toujours des raisons, parfaitement légitimes, de se croire nécessaire. » (p. 166-167).
On est bien loin, au printemps 1940, de « la Patrie en danger » et de l’esprit de Valmy. Ce serait plutôt le « sauve qui peut » général. On ne peut pas ne pas penser que le pacifisme proclamé des années 1930 est grandement responsable de cela. Que faire quand les habitants d’un pays ne se sentent plus concernés par la défense du sol natal ? Bloch ne sous-estime pas l’antagonisme de classe qui vient renforcer ce détachement. Il écrit :
« La vérité est que, les deux fois, la source de l’élan populaire fut la même : « Ils ne cessent de chercher querelle à tout le monde, Ils veulent tout prendre pour eux. Plus on leur cédera, plus ils réclameront. Cela ne peut plus durer. » Ainsi me parlait, dans mon petit village de la Creuse, un de mes voisins, peu avant mon départ pour Strasbourg. Un paysan de 1914 n’eût pas dit autrement. » (p.170).
Le paysan ou l’ouvrier de 1940 ne veut pas mourir pour le grand capital et les 200 familles. Cette guerre n’est pas son affaire. Il n’a pas perçu suffisamment le caractère idéologique de la lutte. Lorsqu’il l’aura saisi, la Résistance sera en marche. Bloch met aussi en cause le rôle des leaders syndicaux de l’époque et leurs luttes seulement concrètes.
« On ne leur avait pas appris, comme c’eût été le devoir de véritables chefs, à voir plus loin, plus haut et plus large que les soucis du pain quotidien, par où peut être compromis le pain du lendemain. » (p.173).
Voici un reproche très lourd envers les chefs de syndicats, accusés de ne s’occuper que de revendications matérielles, en n’ouvrant pas les yeux des troupes sur l’horizon plus large des puissances et des idéologies. Ce fut le projet des Universités Populaires à la fin du XIXème siècle. Mais elles ont échoué à empêcher le premier conflit mondial et l’Union Sacrée. Elles ont quasiment toutes disparues entre les deux guerres. Il n’y a donc pas de lieu où les ouvriers ou les paysans pourraient s’ouvrir à des perspectives plus vastes que celle du « pain quotidien[4] ». De même l’amour de la famille ne saurait s’opposer à celui de la patrie.
« Je n’ai jamais cru qu’aimer sa patrie empêchât d’aimer ses enfants ; je n’aperçois point davantage que l’internationalisme de l’esprit ou de la classe soit irréconciliable avec le culte de la patrie. C’est un pauvre cœur que celui auquel il est interdit de renfermer plus d’une tendresse. » (p.173).
Bloch condamne donc autant l’exclusivisme d’un certain internationalisme prolétarien que le pacifisme universel des intellectuels. On notera la beauté de la dernière phrase qui montre bien le talent d’écrivain de l’auteur et son travail tacite de moraliste. Il en vient alors à parler de l’enseignement et, plus précisément de l’école primaire, dont on sait le rôle majeur qu’elle avait jouée dans la préparation des esprits patriotiques avant 1914. Il reproche au système d’instruction publique de n’avoir pas continué à entretenir ce sentiment d‘attachement à la patrie, et il a ces très belles phrases :
« Instituteurs, mes frères, qui, en grand nombre, vous êtes, au bout du compte, si bien battus ; qui, au prix d’une immense bonne volonté, aviez su créer dans notre pays aux lycées somnolents, aux universités prisonnières des pires routines, le seul enseignement peut-être dont nous puissions être fiers ; un jour viendra bientôt, je l’espère, un jour de gloire et de bonheur, où une France enfin libérée de l’ennemi et, dans sa vie spirituelle plus libre que jamais, nous rassemblera de nouveau pour les discussions d’idées. Ce jour-là, instruits par une expérience chèrement acquise, ne songerez-vous pas à changer quelque chose aux leçons que vous professiez hier ? » (p.175).
On notera le vibrant hommage aux instituteurs et à leur courage, leur lutte permanente, jadis, pour garder la flamme de la patrie allumée. Les instituteurs ont participé en masse au premier conflit mondial et l’ont payé très cher en vie humaine : avec les paysans, c’est le deuxième groupe professionnels le plus décimé par la guerre ; les paysans étaient les soldats et les instituteurs les sous-officiers ou officiers inférieurs. Ensemble ils ont fourni la chair à canon de la guerre de position. Par contre les lycées et les universités ne sont pas vraiment félicités dans cette transmission du patriotisme. Rappelons que dès l’instauration du gouvernement de Vichy et de la Révolution Nationale qui lui servait de programme, les instituteurs furent sommés de prêter serment au Maréchal et de faire chanter le chant en son honneur dans les classes. Ceux qui s’y refusèrent furent d‘abord poursuivis, puis arrêtés[5].
Les partis politiques et la presse portent également une part de responsabilité dans cette débâcle. Mais Bloch n’épargne aucune des classes sociales de son pays. Il fustige la paresse intellectuelle des officiers, d’active comme de réserve. Il raille la bourgeoisie et ses goûts étriqués. Très intéressante est la définition qu’il en propose :
« J’appelle donc bourgeois de chez nous un Français qui ne doit pas ses ressources au travail de ses mains ; dont les revenus, quelle qu’en soit l’origine, comme la très variable ampleur, lui permettent une aisance de moyens et lui procurent une sécurité, dans ce niveau, très supérieure aux hasardeuses possibilités du salaire ouvrier ; dont l’instruction, tantôt reçue dès l’enfance, si la famille est d‘établissement ancien, tantôt acquise au cours d’une ascension sociale exceptionnelle, dépasse par sa richesse, sa tonalité ou ses prétentions, la norme de culture tout à fait commune ; qui enfin se sent ou se croit appartenir à une classe vouée à tenir dans la nation un rôle directeur et par mille détails, du costume, de la langue, de la bienséance, marque plus ou moins instinctivement son attachement à cette originalité du groupe et à ce prestige collectif. » (p.194-195).
Or, cette bourgeoisie veille à sa propre reproduction et se coopte pour les emplois importants. Elle se méfie des enseignants et de l’école publique, elle a manifesté, pour le moins, une indulgence certaine envers Hitler et le nazisme, elle est farouchement anticommuniste. Elle n’a pas su ou voulu voir les signes qui annonçaient la catastrophe. Bref, elle a joué un rôle majeur dans l’esprit de défaite.
On le voit, le diagnostic du professeur et capitaine Marc Bloch n’épargne personne et ne défend aucune ligne particulière : il dresse une constat alarmant mais lucide des coresponsabilités de l’étrange défaite. A quelques réflexions rapides, on comprend aisément qu’il n’a aucune estime pour Pétain et ses séides. Il les considère comme un élément du problème et non comme la solution. Il n’a pas non plus vraiment de compassion pour la droite française, pas plus que pour els communistes. Bref, son espoir est dans la construction d’une France nouvelle, quand les nazis seront vaincus.
« Ce n’est pas aux hommes de mon âge qu’il appartiendra de reconstruire la patrie. La France de la défaite aura eu un gouvernement de vieillards. Cela est tout naturel. La France d’un nouveau printemps devra être la chose des jeunes. » (p.207).
L’histoire lui aura donné partiellement raison, car on vit dans la foulée de la Libération, émerger toute une génération de dirigeants très jeunes, issus de la Résistance, qui allaient gouverner longtemps la France ( pour mémoire le jeune général Chaban-Delmas allait être maire de Bordeaux durant 47 ans !). Malheureusement, Marc Bloch ne sera pas là pour voir ses désirs en partie exaucés. Il ouvrait son livre par ces lignes célèbres car très utilisés par les hommes politiques :
« Un jour viendra, tôt ou tard, j’en ai la ferme espérance, où la France verra de nouveau s’épanouir, sur son vieux sol béni déjà de tant de moissons, la liberté de pensée et de jugement. » (p.29).
Ce temps est venu. Il doit continuer et nous pouvons, nous devons nous revendiquer de l’héritage d’hommes comme Marc Bloch, pour défendre la liberté de pensée et de juger. Ce n’est pas une lutte achevée et dépassée. Nous voyons de nos jours resurgir, sous d’autres atours le totalitarisme intellectuel ; cette fois le vent mauvais vient de l’Ouest, de l’autre côté de l’Atlantique et se nomme Cancel Culture, mouvement Woke etc.. Comme en 1940, la paresse intellectuelle et l’esprit de défaite règnent en France, très discrètement. La récent crise sanitaire n’a fait que remettre en vue nos faiblesses humaines, techniques et morales. Bien sûr, comparaison n’est pas raison, mais il serait, pour une fois, salubre que les leçons de l’histoire nous soient éclairantes.
J’ai gardé pour la fin les deux citations les plus célèbres de Marc Bloch. La première parle du climat détestable de son époque et de sa réaction.
« Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas : en face d’un antisémite. » (p.31).
Car le juif assimilé qu’était le grand universitaire se sentait d‘abord français et l’était par toute son histoire. Mais se revendiquer juif devant un antisémite, c’est bien être ce que doit être un vrai Français : l’ami du faible et du persécuté et l’ennemi du raciste et du persécuteur. A ceux qui avaient, par faiblesse, bêtise, calcul ou indignité, plongé dans l’antisémitisme, la collaboration et la délation, on peut opposer cette déclaration devenu quasi-proverbiale :
« Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l’histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims ; ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Peu importe l’orientation présente de leurs préférences. Leur imperméabilité aux plus beaux jaillissements de l’enthousiasme collectif suffit à les condamner. » (p.198).
Monarchistes et républicains unis dans la même histoire, car c’est bien cela l’histoire de France ! Mais pour pouvoir vibrer ainsi, encore faut-il qu’on enseigne encore ces grands moments et qu’il subsiste une saga nationale qui fasse sens. Pour le refuser, notre pays connaît depuis quelques décennies une décomposition de sa cohésion nationale, car l’histoire, ignorée, ne peut plus faire rêver les Français.
Que ce livre ait paru à certains commentateurs cultivés avoir un lien avec notre époque n’est nullement absurde, car il y a diverses guerres et différentes défaites. Mais c’est toujours le même esprit qui y conduit, celui que Marc Bloch a dénoncé dans ce livre remarquable.
Jean-Michel Dauriac – Août 2021
N.B : l’édition utilisée contient en complément du texte évoqué un ensemble de documents qui mettent en valeur le travail de réflexion de Bloch dans la presse clandestine de la résistance, ainsi que quelques lettres qui permettent de bien saisir sa position sur la politique juive de Vichy. Très émouvant : le texte du testament (au sens propre) de l’auteur, ainsi que les citations militaires de l’officier Bloch.
[1] Je renvoie le lecteur à l’essai consacré à ce livre : https://blogjeanmi.danslamarge.com/?p=698
[2] Je mesure à quel point cette attitude peut paraître stupide aujourd’hui à une grande majorité de Français, surtout les plus jeunes où l’idée de « mourir pour des idées » ou « pour la France » est inconcevable. Mais ils acceptent parfois de mourir pour un portable ou une voiture ! Triste résultat d’une éducation (ou d’une absence d’éducation équilibrée) qui n’a appris ni à hiérarchiser les affections ni à garder toujours un avis critique sur les pouvoirs, quels qu’ils soient.
[3] La défaite de la pensée, Alain Finkielkraut, Gallimard, 1967.
[4] Le lecteur comprendra bien que l’un n‘exclut pas l’autre et que l’histoire du mouvement syndical montre qu’à l’origine les préoccupations matérielles étaient associées à des préoccupation philosophiques et éducatives, dont Ferdinand Pelloutier est l’ incarnation même, et les Bourses du Travail la traduction pratique.
[5] J’ai eu, dans ma famille, un exemple très proche de ce processus.
One Comment