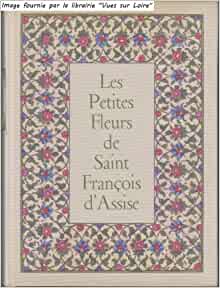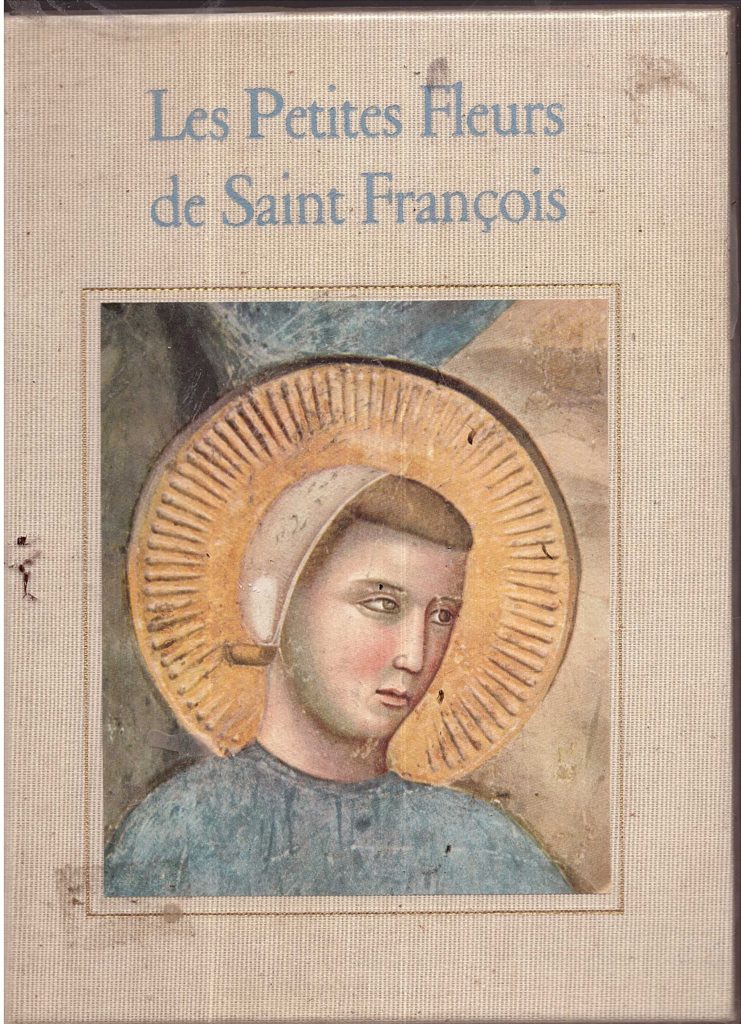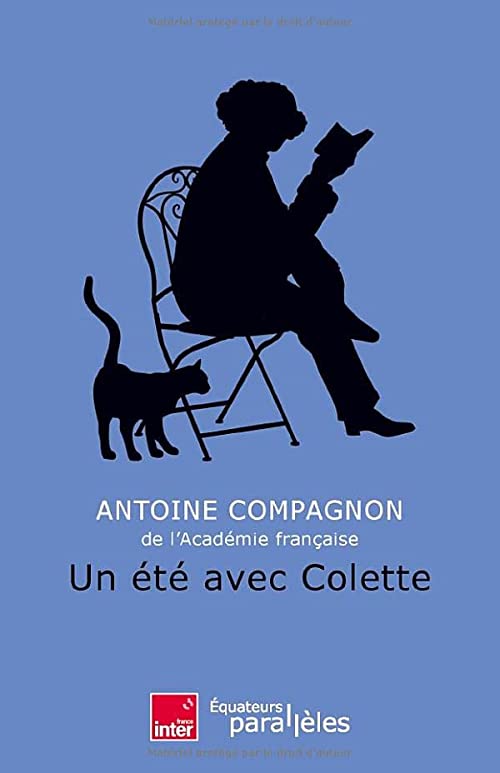Georges Bernanos – Livre de poche LGF, 2015 ; 7,90 €
Attention chef d’œuvre ! Ce roman a obtenu le Grand prix du roman de l’Académie française en 1929. Il est écrit dans la grande période romanesque de Bernanos, qui a écrit Sous le soleil de Satan en 1926, et se ferme presque définitivement en 1937. C’est donc un moment assez précis de la vie d’écrivain de l’auteur, qui rédigera ensuite quasi-exclusivement des essais et articles de combat. Il est cependant fallacieux de séparer fiction et essais, car la personnalité de Bernanos lui interdit de cesser de se battre contre toute la petitesse du monde, que ce soit dans un univers imaginaire ou dans le réel. Dans ce roman, l’auteur fictif, un jeune curé de campagne artésien, juste nommé en charge d’une paroisse rurale, tient un journal qui court sur quelques mois et au travers duquel nous apprenons à connaître ses luttes internes et ses combats quotidiens au sein des fidèles.
C’est un livre incandescent et halluciné. Incandescent, car le jeune prêtre brûle au-dedans de lui, à la fois symboliquement dans son ministère et physiquement avec des maux d’estomac très agressifs. Halluciné, car nous y retrouvons cette vision si particulière des hommes et du paysage picard, celui qui faisait tout le mystère de Sous le soleil de Satan. Cette campagne artésienne, si banale en soi, devient une sorte de nature fantastique, dont le trait effrayant est renforcé par la pluie, le vent et la nuit. Tout le texte est écrit à la première personne, comme il sied à un journal intime. Seule la conclusion prend un recul extérieur. Village, nous ne saurons pratiquement rien, si ce n’est qu’il y a un château, un Comte et une Comtesse et leur fille. Le récit est comme suspendu au-dessus d’une terre froide où s’agitent des hommes et des femmes rudes, souvent brutaux, à la limite parfois de la bestialité, ce que Bernanos accentue encore par ses descriptions psychologiques. Les enfants sont des personnages centraux, comme souvent chez lui. Mais ils ne sont pas épargnés par cette contamination morale ; ils sont déjà des adultes en réduction, dont la société a tué l’innocence. Elle refait parfois surface au cours d’un bref épisode, comme celui où la petit paysanne, d’ordinaire si dure pour le prêtre, le ramasse allongé et demi-inconscient sur le chemin de boue et prend soin de lui. Puis la parenthèse se referme et elle semble redevenir le petit monstre habituel, soumis aux coups et insultes de ses parents. Cependant, la lumière a lui et le petit curé l’a saisie.
Car, dans le monde romanesque de Bernanos, l’homme n’est pas vraiment présenté sous son meilleur jour, c’est le moins que l’on puisse dire. La noirceur est partout, la couleur qui domine, même els paysages, est le gris. Comme toujours chez cet écrivain, le monde est le théâtre de la lutte sans merci entre le Bien et le Mal. Il ne va pas, dans ce roman, jusqu’à lui donner une vie physique, comme dans son premier livre, mais l’incarnation du péché est bien présente et pesante. Ici, elle prend principalement le visage d’une jeune fille en révolte, la jeune Comtesse. Le jeune curé sent instinctivement la présence du Malin, mais il sent aussi qu’il y là une âme à délivrer de ses griffes. Il ne sera pas assez fort et ne vivra pas assez longtemps pour y parvenir. Le héros bernanosien est un vaincu. Il est vaincu parce qu’il cherche à vivre pour le Bien et que le monde qui l’entoure est sous la puissance du Mal. On ne saurait faire cadre plus évangélique. Bernanos dynamite toutes les utopies humaines de « l’homme nouveau » qui se combattaient à son époque. L’homme nouveau est le chrétien humble qui souffre pour son maître et connaît échecs et rebuffades. Ce jeune curé, issu d’un milieu modeste, est un esprit brillant et cultivé qui se retrouve plongé, seul, dans la noirceur du monde sans Dieu. Il mène le combat spirituel sans relâche, mais doit, en même temps affronter ses propres luttes personnelles. Ainsi partage-t-il avec nous ce combat pour la prière. Il veut être un homme de prière, mais elle se dérobe à lui. Et il souffre, la poursuivant sans répit, la retrouvant parfois, la perdant à nouveau… Ce faisant, il ignore qu’il ne fait que mettre ses pas dans ceux des grands mystiques qui ont connu la « nuit », comme le disait Jean de La Croix. Le jeune homme est souvent désarmé, face à un monde qu’il ne comprend pas, mais il ne renonce jamais. Il se bat avec ses armes, vaillamment, pour le salut de ces âmes frustes qui vivent au ras du sol. Il se heurte au mépris de la famille comtale, qui règne encore sur les esprits du pays et le tient pour un original qui pourrait être dangereux. La lutte des classes est bien réelle, même si elle n’emprunte pas ces termes. Nous partageons les doutes et les questions du curé, très seul dans son presbytère. On lui donne des conseils, il devrait prendre une femme pour tenir sa maison, faire laver son linge, etc. Il est à cent lieues de ça, se débattant dans la sphère de l’esprit.
Car son corps ne va pas bien. Dès le début du livre, nous apprenons qu’il ne peut manger normalement et se nourrit presque exclusivement de pain trempé dans un peu de vin. Il est très maigre et d’une pâleur effrayante. Dès le départ, un autre personnage est omniprésent sans se montrer : la mort. Elle frappe les vieux paroissiens dont il doit assurer les services funèbres. Elle l’interpelle au quotidien. Au milieu du livre, il a le pressentiment de sa proximité, quand il a ce malaise en pleine campagne. Il retarde au plus le rendez-vous avec un spécialiste lillois, et quand il s’y rend, il commet une erreur de nom et consulte un généraliste, lequel n’a aucun mal à poser le diagnostic, amis le fait confirmer par un professeur : cancer de l’estomac en phase terminale ! Eût-il consulté avant, sans nul doute cela n’aurait pas changé le cours de choses. Il est donc condamné. Il veut revenir dans sa cure, mais auparavant rend visite à un de ses camarades de séminaire, qui a abandonné la prêtrise pour s’installer dans le monde avec une compagne. Celui-ci est surpris, amis heureux de le voir. Il embellit toute la réalité de sa nouvelle vie, qui est aussi misérable que celle du petit curé. Celui-ci est pris d’un grave malaise et en peut repartir : il mourra dans cette chambre Symboliquement près de celui qui a quitté l’état clérical, veillé par son amie, ces deux êtres en « état de péché » selon l’Eglise, mais qui seront ses accompagnateurs ultimes. Bien évidemment ce choix n’est pas anecdotique. Bernanos est à la fois anticlérical et admiratif des destins individuels des religieux, toute son œuvre le prouve, tant elle recèle de magnifiques personnages de « saints » ordinaires en soutane. Mais ils ne sont pas saints parce que prêtres, mais ils sont prêtres parce que saints.
Il y a dans ce livre un second personnage de prêtre absolument remarquable : celui du curé de Torcy. Il est le porte-parole de Bernanos, et ses propos ne sont pas tendres pour l’Eglise et pour la société de son temps ! A vrai dire, il est révolutionnaire, mais sans peut-être le savoir lui-même, simplement parce qu’il est habité par l’Evangile. Cet homme sage et intelligent est le seul ami de notre jeune curé. Il a discerné la richesse de cette pauvre vie et essaie, tant bien que mal, de l’aider à trouver son chemin. Il faudrait reprendre dans le détail les propos de ce prêtre, car ils sont le cri de Bernanos à ce moment-là. Mais il ne sera pas là dans les derniers moments du jeune prêtre, car lui-même a été victime d‘une attaque cardiaque.
Il y a un point central dans ce roman, une apothéose, tant spirituelle que stylistique. C’est la longue conversation, je devrais dire le long combat entre le jeune curé et la Comtesse. Trente pages d’un dialogue extraordinaire (p. 174 à 204) où l’auteur déploie toute l’ampleur de son talent. C’est la lutte entre l’humilité, le pardon, la paix et le formalisme, la haine et l’orgueil. Un véritable duel, où les fleurets ne sont nullement mouchetés et où, chacun à son tour, les deux protagonistes essaient de porter l’estocade à l’adversaire. L’enjeu est ni plus ni moins le salut de l’âme et le pardon. Le jeune curé combat avec toute sa fougue, mais aussi son inexpérience, et bien des fois, il risque la mort. Mais il revient sans cesse à la charge : il veut que la Comtesse fasse la paix intérieure avec Dieu et se réconcilie avec sa fille qui la hait. Il finit par triompher, et la Comtesse cède, vaincue par l’amour. Il quitte le château, épuisé par cette lutte. Peu de temps après la Comtesse lui fait parvenir une lettre qui confirme sa reddition devant Dieu. Elle meurt dans la nuit suivante. On ne peut plus jamais oublier cette scène quand on l’a lue. Elle nous aimante par sa puissance et sa conception littéraire. Car c’est bien un exploit d‘écrivain que ce long dialogue sans aucune échappatoire. On y retrouve le génie littéraire qui avait dépeint la rencontre de l’Abbé Donissan et du diable personnifié, dans Sous le soleil de Satan. Nous sommes là dans le même degré d’exigence stylistique et morale. Car l’exploit est que jamais l’un des aspects ne l’emporte sur l’autre. Bernanos « tient le coup » jusqu’au bout ! Il est donné au petit curé d’avoir cette belle victoire de salut d’une âme, avant de disparaître.
Ce petit prêtre, nous n’en savons ni le nom ni le prénom, il est LE curé anonyme. IL traverse la vie de cette pauvre paroisse durant quelques mois et puis s’en va… « Bienheureux les pauvres en esprit… » pourrait le définir. Il est, comme souvent chez Bernanos, la figure du saint ordinaire. C’est bien pour cela que l’on ne pourra jamais l’oublier.
Au service de ce projet très resserré dans le temps et l’espace, Bernanos déploie un style très fluide, sans les aspérités habituellement rencontrées dans ses récits à la troisième personne. Le style, c’est l’homme ! Le curé est un être intelligent et simple, son journal sera écrit ainsi. C’est une grande réussite d’écrivain. De mon point de vue c’est, littérairement parlant, le meilleur des romans de Bernanos que j’ai lu. Il a su ici gommer les lourdeurs qui plombaient parfois les autres livres. Sans doute le choix du genre, un journal, lui a-t-il en quelque sorte imposé cette sobriété.
Il faut, toutes affaires cessantes, lire ce livre habité. Je ne prends pas beaucoup de risques en disant qu’il restera gravé en vous à jamais.
Jean-Michel Dauriac – Septembre 2022.
Leave a Comment