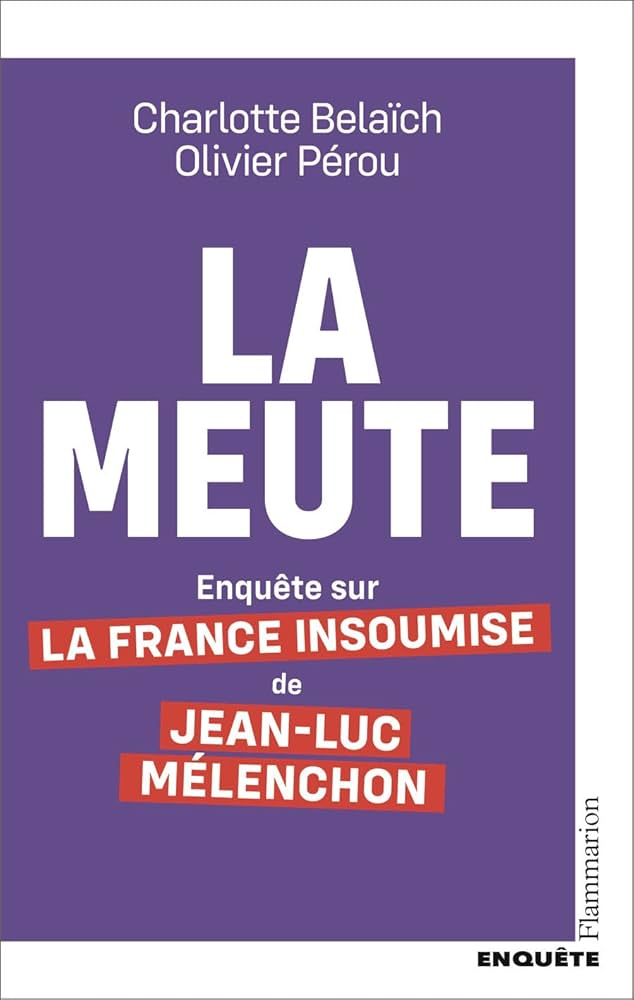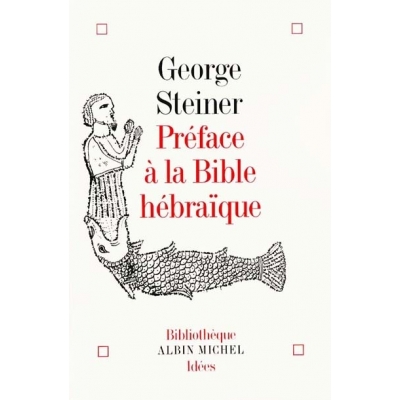Charlotte Belaïch & Olivier Pérou – Flammarion, collection Enquête, 2025.
Ce livre est la première enquête journalistique d’envergure sur ce phénomène politique unique qui se nomme La France insoumise (LFI dans la suite). En tant que tel, il mérite déjà notre intérêt. Surtout lorsqu’on sait quel sort M. Mélenchon réserve à ceux qui osent le remettre en question.
Le travail d’investigation est considérable, car il a demandé d’approcher des dizaines de militants actuels ou défroqués de ce groupement « gazeux » comme le définit son fondateur. En quoi il a parfaitement raison, car LFI n’est pas un parti politique, c’est bien plus que cela. C’est ce qui ressort clairement des nombreux témoignages cités, à charge ou à décharge dudit groupement.
Les auteurs: Olivier Pèrou & Charlotte Belaïch
Le livre est structuré par un plan chronothématique, où les thèmes l’emportent nettement sur la chronologie, qui est assez malmenée : ce n’est pas un travail d’historiens. Néanmoins, il débute par un petit essai biographique sur l’homme qui est au centre de tout cela : Jean-Luc Mélenchon. On le suit de ses premiers pas chez les trotskistes au Parti Socialiste qui fut sa maison durant plus de trente ans, et dont il fut un apparatchik de second rang. On y apprend son admiration et sa fidélité à François Mitterrand et Lionel Jospin, ainsi que ses amitiés avec certains de ses collègues, comme Julien Dray. Le jeu des courants est bien sûr présent et JLM y participe, mais sans parvenir à prendre la tête de l’un d’entre eux. C’est au moment de la campagne pour le traité constitutionnel européen, en 2005, qu’il bascule en marge du PS et finit ensuite par le quitter. On entre alors dans l’histoire du Jean-Luc Mélenchon que l’on connaît, inamovible candidat à l’élection présidentielle.
Les auteurs montrent bien, tout au long du livre, que seule cette élection et cette fonction le fascinent (le syndrome Mitterrand), et que toutes les autres fonctions ne le passionnent guère. Il fut un député de Marseille absent. Il a donc mis en œuvre une stratégie tout entière tournée vers la victoire pour l’Elysée. C’est la raison d’être de LFI.
La particularité de LFI, c’est de n’exister que par et pour Jean-Luc Mélenchon. C’est ce que démontrent toutes les différentes parties thématiques du livre. Le mouvement est conçu pour être une machine politique à son service. La pensée politique n’existe que parce qu’elle est validée par JLM. Les élus ne sont que des « pions » comme le disent les auteurs. Chacun d’eux à son niveau est utilisé par le maître. Il existe bel et bien un phénomène d’emprise psychologique très fort au sein de LFI. Moi qui ai suffisamment vécu pour avoir de la mémoire et des points de comparaisons, je ne peux que penser immédiatement aux Jeunesses Communistes du PCF de ma jeunesse ou, encore plus caricaturalement, aux trotskistes des années 1970. C’étaient des machines à débiter des « éléments de langage » avant que l’on ait inventé cette expression stupide. Immanquablement, les mêmes arguments, les mêmes exemples, les mêmes formules revenaient au fil des conversations, quel que soit l’interlocuteur. Il en est de même pour LFI, que Mélenchon a organisé sur le modèle des structures qu’il a fréquentées jeune. Seul l’habillage a changé, pour s’adapter au temps. On parle de VIe République pour ne pas effrayer l’électeur avec le mot révolution, mais c’est bien à lui que l’on pense. Cela peut faire illusion auprès des jeunes inexpérimentés et idéalistes, mais ne devrait pas séduire les plus âgés ; or, il est clair que, même eux, se laissent séduire.
Les auteurs montrent avec quel cynisme JLM est capable d’abandonner ou de trahir ses amis pour servir sa cause. Pure stratégie stalinienne. Le mouvement va de l’avant par renouvellement, car il faut remplacer les déçus et les évincés. Evidemment, la question devient rapidement celle de la qualité des recrutements. Il suffit de considérer le lot des députés du groupe LFI à l’Assemblée pour avoir la réponse. Ce sont, pour l’essentiel, des primo-accédants de la politique, choisis pour cela : ils doivent tout à Mélenchon qui a assuré leur élection et peut tout aussi bien les priver de toute possibilité de se représenter. Les exemples de Corbières et Garrido, entre autres, sont éclairants. Dès que se fait entendre une voix dissonante, elle est observée de près, puis sermonnée. Si elle persiste, elle est retirée des boucles d’échanges et des groupes de discussion : elle disparaît, elle devient invisible. La mort numérique est aussi la mort politique. Les exemples cités sont nombreux et détaillés.
Toute l’argumentation de ce livre s’appuie sur des propos sourcés recueillis dans le temps long, qu’il est difficile de réfuter. Il se dégage de ce tableau une impression très désagréable. Celle d’avoir affaire à une grande entreprise de manipulation au service d’une ambition mégalomaniaque. Je dois dire que plus j’avançais dans la lecture du livre et plus j’avais la nausée ; j’ai rarement ressenti cela physiquement en lisant un ouvrage. J’ai pu aisément l’identifier, par rappel de souvenirs de lecture : c’est le malaise face aux ignominies des totalitarismes, nazisme, stalinisme, maoïsme et autres « -ismes » du XXe siècle. LFI est, pour moi, incontestablement de la même nature. Seul le contexte change et le costume de scène. Mais si l’on donnait malencontreusement le pouvoir à cette nébuleuse, le pays irait immanquablement vers le totalitarisme, car tous ses constituants sont là, à l’état latent : les discours de haine, la violence verbale ou physique (voir la crise d’hystérie de JLM lors de la perquisition de ses bureaux), les promesses démagogiques, le pacte avec le diable…
Il faut lire ce livre pour mieux saisir ce qu’est LFI et mieux s’en défendre. Surtout ne pas se laisser abuser par le discours de fausse compassion (très sélective chez eux) et voir en eux les défenseurs des petits et des invisibles de France. Leur pitié va uniquement aux Palestiniens de Gaza et aux musulmans de chez nous, victimes de ce nouveau mal qu’ils nomment islamophobie pour masquer leur antisémitisme hérité de l’extrême gauche trotskiste.
Ecrivant cela, je sais que je vais être vomi par certains. J’en prends volontiers le risque, au nom de tout ce que je crois et que JLM déteste : la France et ses modestes habitants, la civilisation chrétienne de l’Europe, les gens qui ont une histoire et en sont fiers, sans en écraser les autres… Tout ce qui sépare la gauche historique de Jaurès et Blum de cet ersatz piteux qu’est LFI.
Jean-Michel Dauriac- Les Bordes – août 2025.