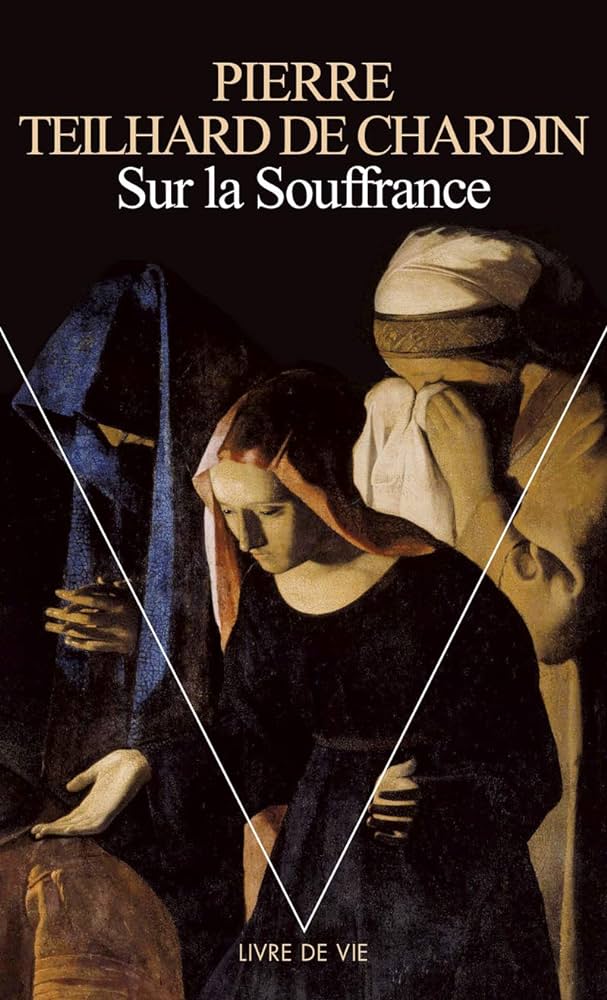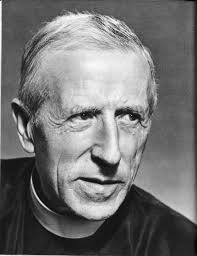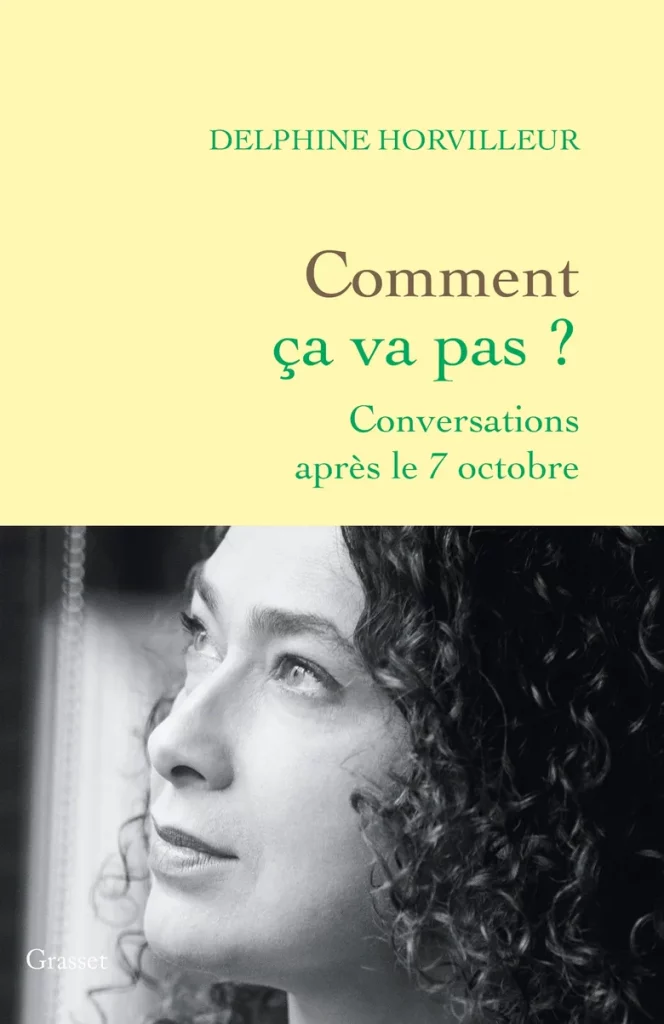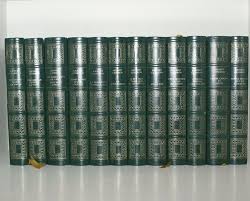Pierre Teilhard de Chardin
L’homme ordinaire du XXIe siècle n’imagine pas la notoriété (je préfère ce terme à « popularité » qui ne serait pas vraiment juste) de « Teilhard », comme on l’appelait alors. Ce jésuite (1881-1955) a été un intellectuel de tout premier ordre et un scientifique de renommée mondiale. Il a laissé une œuvre très riche qui associe réflexion philosophique et spirituelle et rigueur scientifique du botaniste et paléontologue qu’il était. Ses idées, extrêmement novatrices pour l’époque, lui ont valu des démêlées avec l’Eglise, qui lui a interdit, dès 1922, de publier des ouvrages religieux ou théologiques, le cantonnant ainsi à un rôle de savant. Ses grands écrits dans leur continuité n’ont pu être publiés qu’après sa mort et forment un corpus d’une grande richesse. Pour plus de précision, nous renvoyons le lecteur de cette note à l’article de Wikipédia sur le personnage (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin) , lequel est très bien fait, malgré des répétitions internes. Or, c’est une grave erreur d’oublier qu’il fut d’abord un prêtre et un croyant et qu’il n’a jamais failli à ses vœux, obéissant aux injonctions de l’Eglise et de sa hiérarchie. Le petit recueil que je chronique aujourd’hui peut utilement servir à remettre en avant sa foi et son espérance. Il est tout à fait possible de désapprouver ses choix et affirmations doctrinales et scientifiques[1] et trouver en lui un frère fidèle et qui peut nous encourager.
Ce recueil est une compilation sélective faite dans les divers écrits du père Teilhard. Le titre et le choix ne sont donc pas son œuvre et nul ne sait s’il les aurait approuvés. Mais, pour le lecteur attentif, ce petit livre est une très belle chose. La rédaction de ces écrits s’étale de 1916 à 1950, preuve d’une réflexion constante sur ce thème. La souffrance est un sujet profondément chrétien ; je dirais même, profondément christique. Aucun croyant sincère en peut éviter de le rencontrer et d‘y réfléchir, soit parce qu’il en est atteint dans son propre corps, soit parce des proches souffrent, soit parce qu’il est conscient que le Christ lui a donné une grande place dans sa vie et sa parole.
Levons d’emblée toute ambiguïté : à aucun moment, Teilhard de Chardin ne fait l’apologie de la souffrance et encourage au dolorisme ! Son propos est d’une hauteur spirituelle bien plus grande. Il cherche à travers la souffrance à « penser la mort » en chrétien. Et il y parvient fort bien. La lecture achevée, nous avons été amenés à nous familiariser avec cette réalité ultime et à relier avec elle une manière de vivre la souffrance qui peut la sublimer, faute, bien sûr, de la supprimer. Je donnerai ci-dessous quelques courts extraits significatifs et éclairants.
Petit texte, mais très riche en contenu et, bien sûr, objet de débat. Pour Teilhard, pas question de laisser croire au chrétien qu’il serait exempté de la souffrance ou qu’elle lui serait amenuisée. C’est bien à un autre niveau qu’il faut la considérer. La médecine a une mission de soulagement ou de délivrance. Quand elle n’y parvient pas, que faire de la douleur ? La maudire, se laisser briser par elle ou l’utiliser ? C’est ce troisième choix que propose le jésuite. Il voit dans le combat contre la douleur physique une arme contre le mal moral. Comprenons bien ce qu’il avance : il ne s’agit pas de gagner des « points de purgatoire » en supportant sa douleur ! Il n’e parle pas d’un retour des Indulgences. Il ne parle pas d’un dolorisme déguisé qui appellerait le souffrant à subir pour plaire à Dieu. Il parle d’un chemin de purification dont le terme est « une mystérieuse union du fidèle au Christ souffrant ». Ceci est tout à fait conforme à la théologie du Nouveau Testament, exprimée à la fois par Paul et Pierre dans leurs épîtres. Je regrette juste la formule « à la manière d’un sacrement », qui vient rappeler la vision catholique du ministère pastoral, à laquelle je ne puis adhérer, Bible à l’appui. Ce que met en avant l’auteur est une application consciente d’une mystique néotestamentaire qui peut utiliser à salut la douleur.
Après la douleur humaine, la mort est la deuxième grande source de souffrances. La mort d’un proche, d’un conjoint, d’un enfant d’un ami, chaque décès est douleur, plus ou moins violente, forte et durable. Certains d’entre nous ne guérissent jamais d’un deuil. Beaucoup préféreraient souffrir tout le reste de leur vie que de perdre un être aimé. Il est donc légitime de traiter de la mort dans des textes sur la souffrance. Ce thème est d’ailleurs entrelacé avec celui de la souffrance physique (et morale) dans plusieurs extraits du livre.
En soi, la Mort est une incurable faiblesse des êtres corporels, compliquée, dans notre Monde, par l’influence d’une chute originelle. Elle est le type et le résumé de ces diminutions contre lesquelles il nous faut lutter sans pouvoir attendre du combat une victoire personnelle directe et immédiate. Eh bien, le grand triomphe du Créateur et du Rédempteur, dans nos perspectives chrétiennes, c’est d’avoir transformé en facteur essentiel de vivification ce qui, en soi, est une puissance universelle d’amoindrissement et de disparition. Dieu doit, en quelque manière, afin de pénétrer définitivement en nous, nous creuser, nous évider, se faire une place. Il lui faut, pour nous assimiler en Lui, nous remanier, nous refondre, briser les molécules de notre être. La Mort est chargée de pratiquer, jusqu’au fond de nous-mêmes, l’ouverture désirée. Elle nous fera subir la dissociation attendue. Elle nous mettra dans l’état organiquement requis pour que fonde sur nous le Feu divin. Et ainsi son néfaste pouvoir de décomposer et de dissoudre se trouvera capté pour la plus sublime des opérations de la Vie. Ce qui, par nature, était vide, lacune, retour à la pluralité, peut devenir, dans chaque existence humaine, plénitude et unité en Dieu. » (P. 82-85.)
Les deux paragraphes de ce texte établissent une progression face à la mort. Dans le premier, il s’agit de la mort spirituelle. Ce principe est illustré par la citation en latin d’une parole de Jésus :
Jean 3:30 « Il faut qu’il croisse et que je diminue. » Cette mort spirituelle à nous-mêmes est fort bien illustrée par Paul dans ses épîtres, notamment celle aux Colossiens. Les termes qu’emploie Teilhard sont directement ceux de la démarche mystique, car c’est bien de cela qu’il s’agit, « … des formes très réelles de l’extase qui doit nous enlever à nous-mêmes pour nous subordonner à Dieu. » Mais ce stade n’est qu’une première étape, même s’il est poussé à l’extrême. Ce que l’auteur exprime ainsi : « Nous n’avons pas encore franchi le point critique de notre excentration, de notre retournement en Dieu. » Il pose donc le principe d’une étape décisive d’entrée dans la communion spirituelle au Christ. Ce pas de plus est sans retour, c’est l’abandon total de soi.
Le second paragraphe traite de la Mort, comme fin physique de l’humain. Elle est, dit l’auteur, la somme des diminutions progressives que font vieillesse et maladie en nous. Et là s’opère le grand retournement mystique que seule la foi peut saisir dans toute sa dimension : « Eh bien, le grand triomphe du Créateur et du Rédempteur, dans nos perspectives chrétiennes, c’est d’avoir transformé en facteur essentiel de vivification ce qui, en soi, est une puissance universelle d’amoindrissement et de disparition. » C’est la reprise du « Oh ! Mort, où est ta victoire » de l’apôtre Paul. La Mort, pour le chrétien, c’est l’entrée dans la vie complète du Christ. Nous touchons le point de basculement du raisonnable humain, le seuil quel’homme naturel ne peut franchir sans l’appel de la Grâce. « La Mort est chargée de pratiquer, jusqu’au fond de nous-mêmes, l’ouverture désirée. Elle nous fera subir la dissociation attendue. Elle nous mettra dans l’état organiquement requis pour que fonde sur nous le Feu divin. » Je comprends bien ce que ces propos ont de scandaleux, d’incongru et de stupide pour l’intellectuel du XXIe siècle (comme pour le grand patricien romain du Ier siècle, hier !). Nous ne pouvons rien démontrer. Nous pouvons seulement montrer nos en exemple quand vient l’heure finale. Il faut bien user ici du mot « mystère », au sens théologique et non magique et sensationnel. L’achèvement du processus est proprement incroyable et, pourtant, c’est ce que nous croyons : « Ce qui, par nature, était vide, lacune, retour à la pluralité, peut devenir, dans chaque existence humaine, plénitude et unité en Dieu. » Le coeur de la foi est dans ce mystère que le Christ a éclairé pour nous, par sa mort et sa résurrection.
Il me semble que ces extraits sont à même de prouver que le père Teilhard de Chardin était véritablement un homme de foi et un mystique. L’Eglise a donc bien erré quand elle l’a interdit de toute production théologique. L’homme de science n’avait nullement tué l’homme de foi. Que le caractère novateur de sa démarche ait pu effrayer l’Eglise, on peut le comprendre. Mais la peur n’est pas un sentiment chrétien. Le Christ, s’adressant à ses disciples apeurés lors de la tempête sur le lac de Tibériade, leur dit : « N’ayez pas peur, c’est moi[2] ! » Il nous dit de même en parlant de la Mort.
Vous l’avez bien compris, ce petit livre (petit format et petite pagination) est un petit trésor qui pourra servir de livre-ressource régulièrement. Il est à nouveau édité et disponible chez les libraires (https://www.amazon.fr/Sur-souffrance-Pierre-teilhard-chardin/dp/202023971X) .
Jean-Michel Dauriac – Ascension 2024 – Les Bordes
[1] L’Eglise, à la fin du XXe siècle, par la bouche et l’écrit de Jean-Paul II et Benoît XVI l’a réhabilité ; le pape François le cite dans une de ses encycliques les plus lues, Laudato Si. Comme souvent pour les grands esprits, Teilhard a eu le tort d’avoir raison trop tôt !
[2] Marc 6 :50.
Leave a Comment