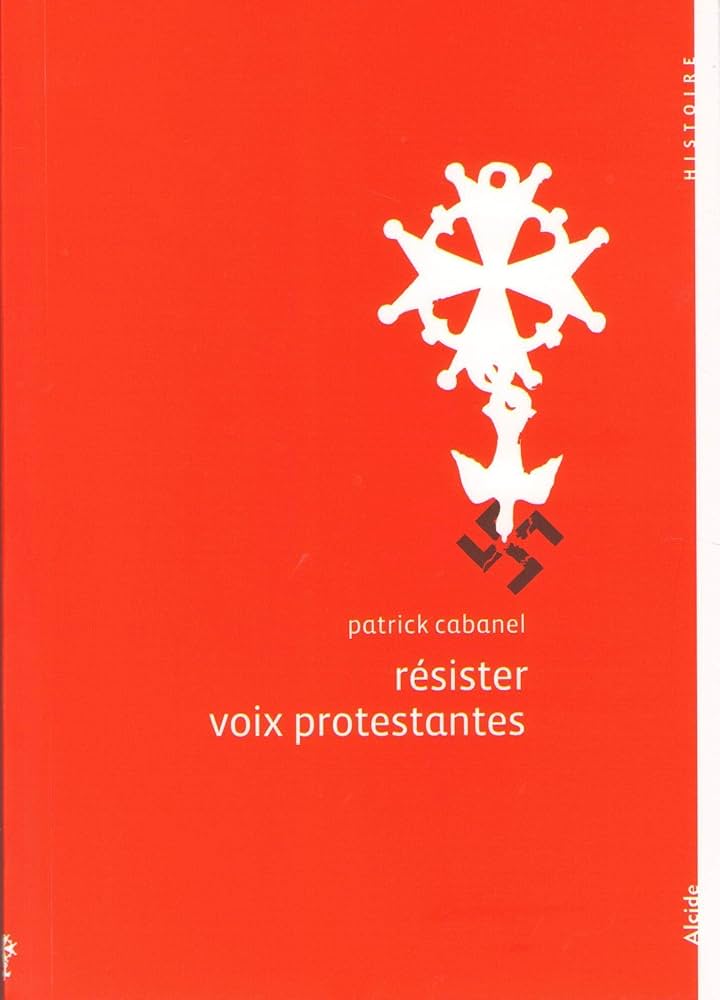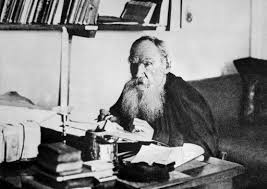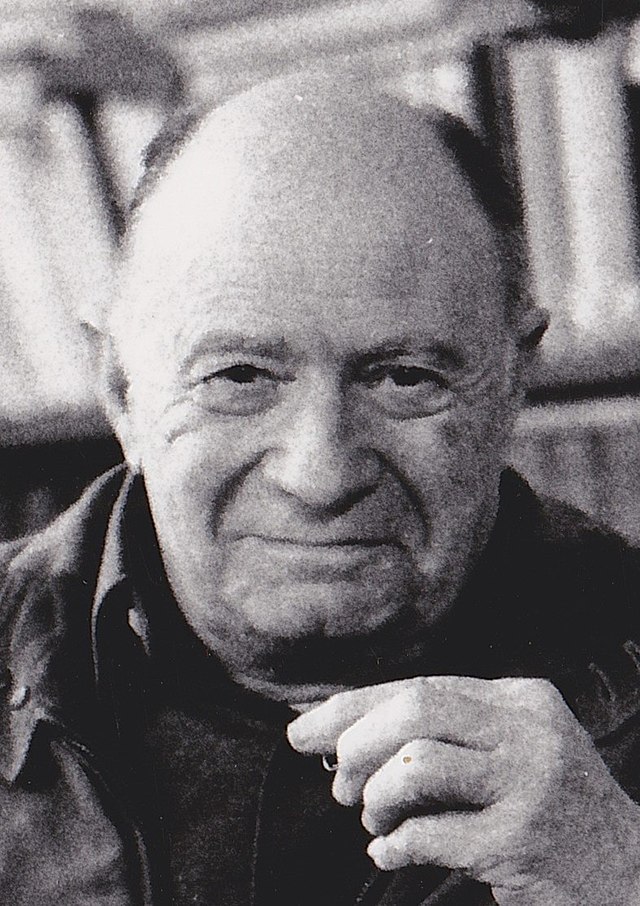Patrick Cabanel – Nîmes, éditions Alcide, 2014.
Le mot « Résister » a été gravé sur les murs de pierre de la Tour de Constance, à Aigues-Mortes, par Marie Durand et les femmes huguenotes emprisonnées pour leur foi par les dragons de Louis XIV, après la révocation de l’Edit de Nantes. Depuis cette date, ce verbe est devenu un mot d’ordre intemporel pour tous les protestants, dans diverses circonstances. La Seconde Guerre Mondiale fut une de ces circonstances où le mot retrouva toute sa signification. Le but de ce petit livre est de donner un aperçu de cette résistance protestante sous l’angle de la prédication pastorale.
L’auteur de ce recueil est Patrick Cabanel, éminent historien français, spécialisé dans les études sur la laïcité, la République, et les minorités juives et protestantes en France, entre autres sujets. Sa bibliographie est impressionnante (voir l’article Wikipédia). Il fait ici la démonstration de sa rigueur et de son talent, dans une synthèse et des notices très bien réalisées. Quel est l’enjeu ? Donner à lire un choix de sermons pastoraux prononcés durant le conflit, à des dates souvent importantes, en présentant brièvement les auteurs, en ayant brossé auparavant le contexte historique général dans un beau texte introductif.
Cabanel montre qu’il y eut une double résistance protestante au nazisme et à l’antisémitisme et au fascisme de Vichy. On connaît surtout celle des filières de sauvetage des enfants juifs par le village de Chambon sur Lignon, en Haute-Loire. Ceci a été illustré par des films, des documentaires, beaucoup de témoignages… Mais, parallèlement à cette résistance active, exista aussi une résistance spirituelle dont els pasteurs et les fidèles furent les acteurs anonymes. Le sort réservé aux Israëlites par Vichy fut un moteur puissant de cette résistance et du rejet de tout compromis avec l’occupant. L’introduction en fait le récit, mettant en avant le rôle des pasteurs dans leurs prédications hebdomadaires au Temple et les réactions que suscitèrent les grandes étapes de la turpitude vichysoise : statut des Juifs, port de l’étoile jaune, rafles, déportations et spoliations. A chaque fois, des ministres du culte réformé, souvent en langage codé biblique, encouragèrent leurs paroissiens à refuser la soumission, à garder la ligne de l’Evangile et celle de l’amour inconditionnel. Les figures héroïques ne manquent pas dans le texte biblique pour appeler à la résistance sans le dire ouvertement et risquer des mesures de rétorsion contre les églises.
L’auteur a retenu huit pasteurs en poste dans ces années, dans des paroisses diverses : Lyon, Aix-en-Provence, Chambon sur Lignon et, bien sûr, l’Oratoire de Louvre, le grand temple parisien. Chaque pasteur est présenté, dans une brève biographie, puis le contexte précis du sermon est donné, avant de livrer le texte. Le tout est accompagné de nombreuses notes de bas de pages, très riches en références et explications.
Patrick Cabanel, l’auteur de ce livre
Il faudrait tout citer, tant les textes sont intéressants ? Je me limiterai à une seule citation, qui me semble tout à fait représentative de ces sermons. Elle est de Gustave Vidal ( 1892-1970), tirée d’une prédication prononcée à l’Oratoire du Louvre le 3 novembre 1940, c’est-à-dire juste après l’entrevue de Montoire entre Hitler et Pétain (22 & 24 octobre) et le fameux discours du Maréchal, le 30 octobre, qui lance officiellement la politique de collaboration. Il est intitulé « Chiens vivants et lions morts », d’après la phrase du livre de l’Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Phrase mise en vis-à-vis de Marc ch. 8 verset 34, qui dit : « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. »
« Si nous voulons, pour notre génération et pour celles qui montent dans notre peuple et dans le monde, sauver la Justice aujourd’hui foulée aux pieds, la Vérité étouffée, la Liberté menacée par l’anarchie ou écrasée par l’oppression, l’Amour bafoué par les doctrines de violence et de haine qu’on veut nous imposer, si nous voulons retrouver ces saintes réalités qui font les âmes fortes et vivantes et, par leur vertu, arracher notre peuple à cette veulerie de chien couchant où l’on s’efforce de le conduire et de la maintenir pour le mieux asservir, il nous faut, dès maintenant, chercher en Christ – « le seul nom qui ait été donné aux hommes, par lequel ils puissent être sauvés » – la source de l’héroïsme. » Page 75.
Tout ce qui fait la puissance et l’intérêt de ce livre est là, rassemblé dans ces quelques lignes. Le rappel des « valeurs » qui méritent que l’on s’engage, au péril de sa propre vie est fait. Les majuscules du texte disent bien que nous avons là des concepts forts : la Justice, la Vérité, la Liberté, l’Amour. Notons que ces valeurs sont aussi celles de la République laïque, si l’on veut bien remplacer Amour par Fraternité. Or, ces vertus sont communes aux chrétiens et aux vrais républicains, cela se verra dans les maquis. En face de ces forces de vie se dresse la « veulerie de chien couchant », celle que promeut Vichy et la collaboration, qui est d’abord une défaite de l’esprit. Vidal va jouer tout au long de son sermon à inverser les termes de sa citation originelle et promouvoir l’héroïsme résistant des lions vivants au détriment de la soumission veule des chiens couchants et morts. Le pessimisme désabusé de Qohélet n’est pas de saison. Il faut transcender les difficultés et aller à la source, le Christ. On retrouvera quasiment dans tous les sermons les mêmes appels à revenir aux sources, à savoir les enseignements du Christ et des apôtres, pour en faire des maximes de vie et de combat. Le lecteur un peu féru de Bible se régalera à voir comment ces pasteurs jouent sur les images et les types pour faire passer leurs messages d’actualité. Il fallait, en effet, ne pas offrir de prise à la censure, très active en ces jours mauvais.
Ces sermons sont des témoignages très riches de cette résistance spirituelle qui anima le protestantisme dans son ensemble, en France. Vous aurez grand plaisir à les lire et les relire, je vous l’assure.
Mais, au-delà des circonstances propres à leur rédaction et prédication, ils sont aussi fort utiles pour nous dans le contexte actuel de notre pays et de la civilisation européenne. Ce n’est pas le nazisme qui nous menace, mais la menace est pourtant bien réelle. D’abord avec le retour de la « bête immonde » de l’antisémitisme et de la xénophobie sélective. Tout ce qui est dit sur les juifs et la nécessaire solidarité avec eux en 1940-1945 peut se dire aujourd’hui. Et qui connaît l’histoire ne peut qu’être choqué par ce retour en force de l’ignominie. Ce serait cependant incomplet de limiter el parallèle à cet aspect. Quand Vidal parle de vouloir « arracher notre peuple à cette veulerie de chien couchant où l’on s’efforce de le conduire et de la maintenir pour le mieux asservir », cela ne peut pas en pas résonner en nous en ce moment. La veulerie est partout, elle dégouline de nos médias, elle est le carburant de la plupart des discours politiques, elle submerge les écrans des smartphones et tablettes. Les lois iniques se multiplient sous une novlangue qui déconcerte le Français moyen, la propagande omniprésente colonise les cerveaux de gens de tous âges et toutes conditions, et l’on voit bien que les gens instruits, les intellectuels ou les artistes ne sont pas épargnés par cette colonisation mentale. Lire ces sermons peut donc être une sorte d’électrochoc salutaire, pour ceux qui croient au Ciel ou ceux qui n’y croient pas.
Jean-Michel Dauriac – mai 2025.
Leave a Comment