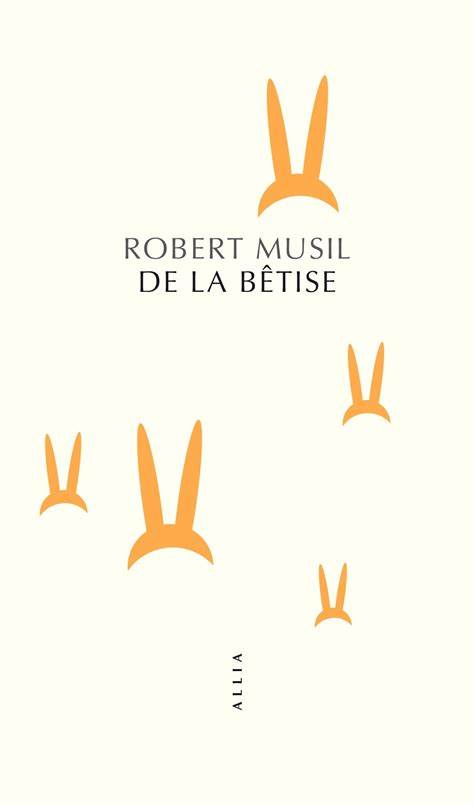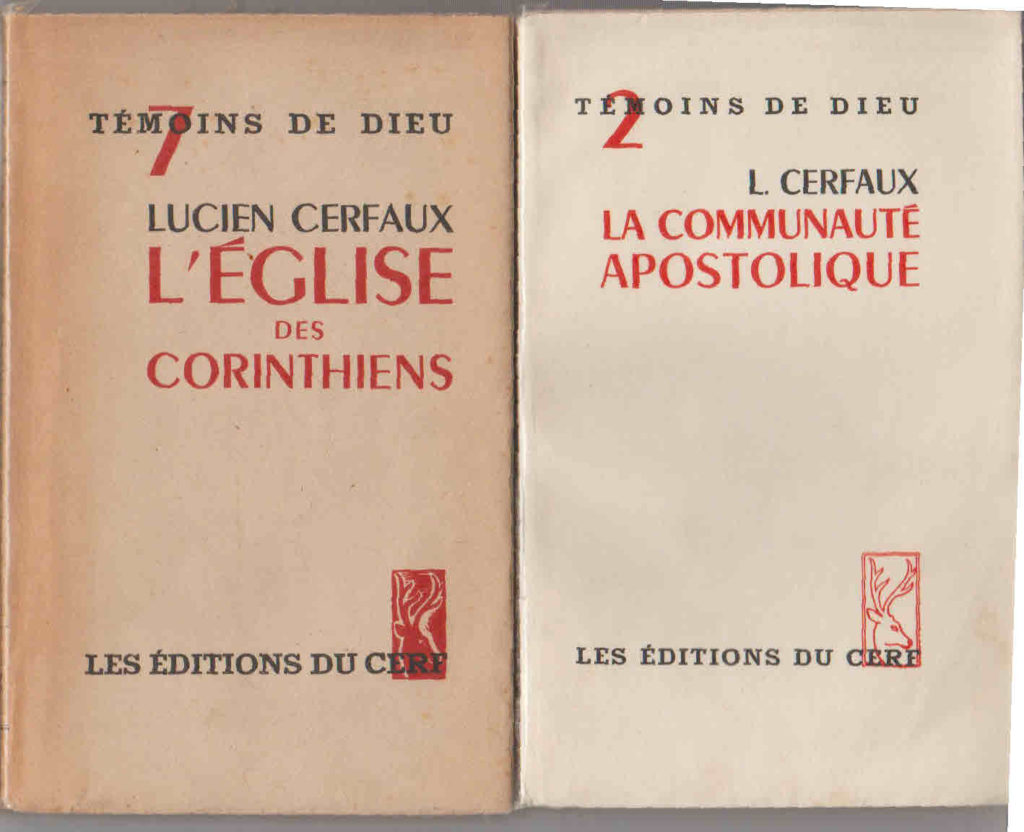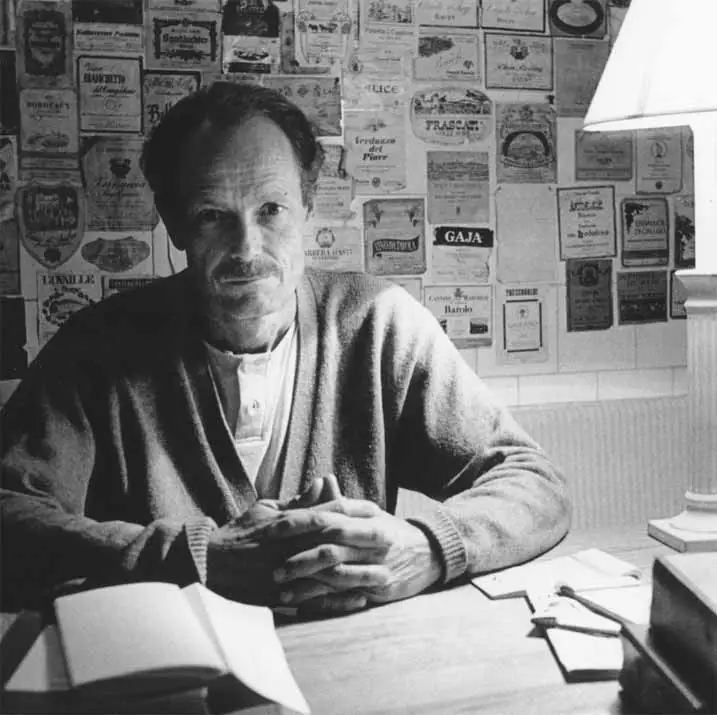Paris, Editions Allia, 2011.
Ecrire un livre intelligent sur la bêtise n’est pas donné à tout le monde. Ça tombe bien, Robert Musil n’est pas n’importe qui. Il est un des grands auteurs du XXe siècle en Europe mais, malheureusement très méconnu. Il mérite pourtant d’être aux côtés de Franz Kafka, Thomas Mann, Stefan Zweig, Joseph Roth et Ernst Jünger comme très grand prosateur de langue allemande, bien qu’il soit, comme Zweig ou Roth, citoyen autrichien.
Ce petit livre reprend le texte d’une conférence donnée en 1937, à Vienne, à deux reprises. Musil lui-même a déclaré avoir travaillé sur le sujet depuis des années, mais n’être pas arrivé à un résultat satisfaisant en suivant la voie choisie qui était celle de l’aphorisme. La demande de cette conférence lui a permis de donner un tour autre et plutôt définitif à sa réflexion. Il a choisi de traiter le plus sérieusement possible ce sujet très épineux, en l’abordant comme n’importe quel sujet philosophique. Il n’est pas inutile de rappeler que Musil est philosophe de formation, avant de devenir écrivain. Sa formation complète (il est docteur de l’Université de Berlin) en philosophie marquera toute sa production littéraire : il est un écrivain qui pense par la littérature.
Il aborde donc la bêtise comme un sujet de fond, à l’égal de la liberté ou de l’existence de Dieu. Et sa première découverte est de ne pas arriver à trouver chez d’autres penseurs une définition correcte de la bêtise, pas plus qu’il n’arrivera lui-même à le faire. La bêtise est indéfinissable, alors même que tout le monde sait bien ce que c’est. En cela, c’est bien une question philosophique. Faute de définition, il faut trouver d’autres moyens de l’approcher. Et là commencent les difficultés. La première est celle de l’intelligence. Pour disserter sur la bêtise, il faut ne pas être bête ; mais affirmer qu’on ne l’est pas (ou dire que l’on est intelligent) passe souvent aux yeux de certains comme une preuve de bêtise. Cette difficulté de se positionner objectivement explique que la plupart des textes qui abordent la bêtise sont des satires ou des pamphlets. Il est plus facile d’ironiser et de railler les manifestations de la bêtise que de les analyser. Cela, Musil le refuse. Son texte ne se moque jamais de la bêtise et de ceux qu’elle atteint. Il cherche au contraire à comprendre comment elle se manifeste et à en tirer un début d’explication.
La bêtise n’est pas un handicap mental et, d’ailleurs, nombre de déficients mentaux ne sont pas bêtes du tout. Mais elle ne se montre pas toujours de la même façon. C’est en étudiant les comportements que l’auteur va aboutir à une typologie binaire de la bêtise. Il part du principe que « chaque intelligence a sa bêtise ». Il existe donc un couple indissoluble intelligence-bêtise qui peut se déployer à divers niveaux. Pour simplifier la démarche, il va opposer e qu’il nomme « la bêtise honnête » à la « bêtise intelligente ».
« La bêtise honnête est un peu lente à comprendre, elle n’a pas « la comprenette facile », comme on dit. Pauvre en représentations et en vocabulaire, elle ne sait guère s’en servir. » (p.42)
Ceci définit assez bien ce que nous percevons comme la bêtise « ordinaire ». C’est une intelligence limitée, pauvres en moyens. On en a souvent fait l’apanage du petit peuple. Au moins depuis Molière, on sait que la bourgeoisie ou la noblesse n’en sont pas du tout exemptées. Musil cite des exemples pris dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie. C’est plutôt drôle ! Cette bêtise est, il le dit lui-même, assez touchante, et pas bien gênante. Elle donne d’ailleurs aux bourgeois le sentiment de leur supériorité.
Mais ce qui choque beaucoup plus Musil, c’est la « bêtise supérieure, la prétentieuse ». Elle sait user de toutes les ruses intellectuelles ; elle a les outils de compréhension de culture. Musil se cite lui-même, à ce propos :
« Il n’est pas une seule pensée importante dont la bêtise ne sache aussitôt faire usage ; elle peut se mouvoir dans toutes les directions et prendre tous les costumes de la vérité. La vérité, elle, n’a jamais qu’un seul vêtement, un seul chemin : elle est toujours handicapée[1]. » (P. 46).
Ainsi donc, la bêtise peut s’immiscer partout où existe l’intelligence. Et c’est dans ce cadre qu’elle est la plus insupportable. Nous avons tous rencontré des individus « bêtes » de cette sorte. Ils peuvent être médecins, avocats, professeurs, généraux… cela ne change rien à l’affaire. Car, pour Musil, cette bêtise-là est une vraie pathologie, une maladie de la pensée, qu’il oppose d’ailleurs à l’esprit sain. IL attire l’attention de ses lecteurs-auditeurs sur la grande attention à soi-même qu’il faut avoir en ce domaine, car nul n’est immunisé contre cette pathologie.
« En revanche, la bêtise « intelligente » a moins pour adversaire l’entendement que l’esprit et – à condition de ne pas entendre par là une simple somme de sentiments- l’affectivité. » P. 49.
La bêtise est donc plutôt à opposer à l’esprit qu’à l’intelligence : on le voit bien quand on évolue dans un milieu intellectuel, où la bêtise est omniprésente chez des gens très instruits.
En arrivant à la conclusion de sa conférence, Musil dit :
« Nous sommes tous bêtes à l’occasion ; à l’occasion aussi, nous sommes contraints d’agir aveuglément ou à demi aveuglément, sans quoi le monde s’arrêterait… » (P. 51)
Nul n’échappe à la bêtise ; elle est là, tapie en nous, prête à surgir à tout moment. Elle surgira, elle a déjà surgi. Le plus important est d’être capable de savoir que l’on a succombé à son culte et quand.
Ce texte de Musil est un véritable petit bijou de rigueur intellectuelle, non dénué d’humour. Il fourmille de formules à conserver. Ajoutons une précision fort utile : le traducteur principal de Musil se nomme Phillipe Jaccottet (1925-2021), qui fut aussi un très estimable poète du siècle passé. La langue est belle et le traducteur connaît parfaitement la pensée et la langue de son auteur. C’est un bel atout.
Il faut lire et faire lire – à ceux qui le méritent ! – cet opuscule (56 pages), essentiel sur ce vaste sujet, hélas inépuisable. C’est aussi un très bon moyen d’entrer en contact avec cet grand écrivain que fut et demeure Robert Musil.
Pour clore ce texte, je ne résiste pas au plaisir de vous donner un texte d’un autre grand poète du XXe siècle, Jacques Brel :
« L’air de la bêtise »
Extrait du célèbre opéra « La vie quotidienne »
Voici l’air fameux z-entre tous : L’air de la bêtise
Mère des gens sans inquiétude
Mère de ceux que l’on dit forts
Mère des saintes habitudes
Princesse des gens sans remords
Salut à toi, dame Bêtise
Toi dont le règne est méconnu
Salut à toi, Dame Bêtise
Mais dis-le moi, comment fais-tu
Pour avoir tant d’amants
Et tant de fiancés
Tant de représentants
Et tant de prisonniers
Pour tisser de tes mains
Tant de malentendus
Et faire croire aux crétins
Que nous sommes vaincus
Pour fleurir notre vie
De basses révérences
De mesquines envies
De noble intolérance
De mesquines envies
De noble intolérance
De mesquines envies
De noble intolérance
Mère de nos femmes fatales
Mère des mariages de raison
Mère des filles à succursales
Princesse pâle du vison
Salut à toi, Dame Bêtise
Toi dont le règne est méconnu
Salut à toi, Dame Bêtise
Mais dis moi, comment fais-tu
Pour que point l’on ne voie
Le sourire entendu
Qui fera de vous et moi
De très nobles cocus
Pour nous faire oublier
Que les putains, les vraies
Sont celles qui font payer
Pas avant, mais après
Pour qu’il puisse m’arriver
De croiser certains soirs
Ton regard familier
Au fond de mon miroir
Ton regard familier
Au fond de mon miroir
Ton regard familier
Au fond de mon miroir.
IL dit finalement à peu près la même chose que Musil, mais autrement. On peut écouter cette chanson ici : https://youtu.be/8_xtMXhagf4?t=74
Jean-Michel Dauriac – avril 2025.
[1] Il cite ici un extrait son chef d’œuvre inachevé, L’homme sans qualités , dont nous reparlerons un de ces jours.
Leave a Comment