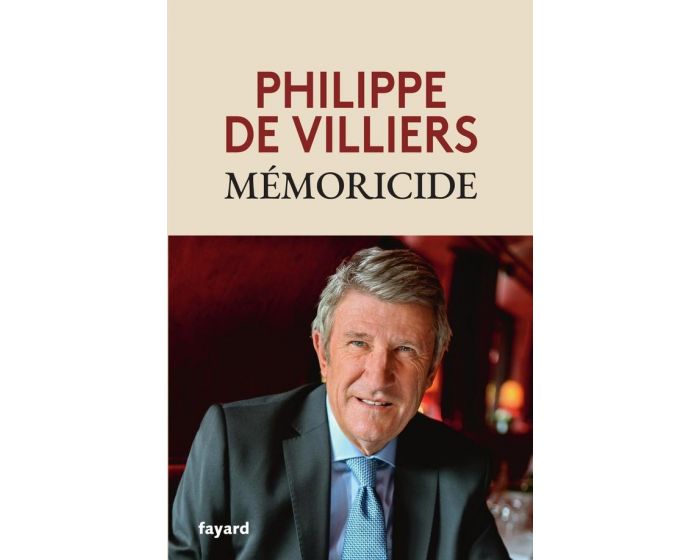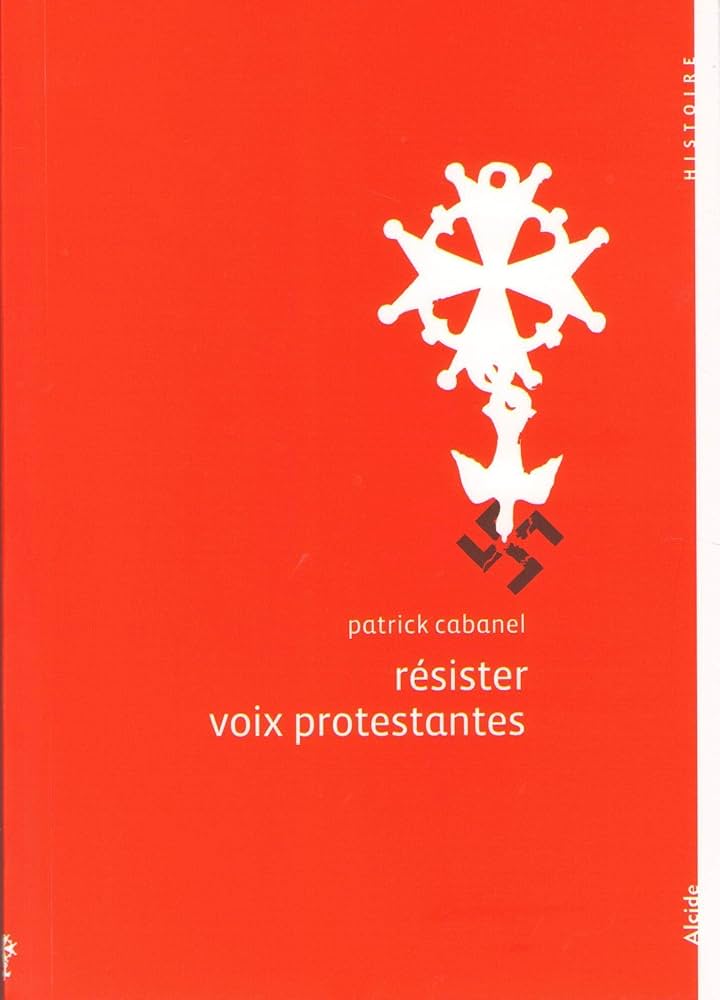Organisé par Aux rêves du Frêne
Association Loi 1901 – Fresselines
Les rencontres du Frêne, 10 ans déjà !
Dossier de presse 2025 à télécharger ici :
En 2015, Christine Guillebaud et Jean-Michel Dauriac décidaient de lancer un temps de réflexion et de partage autour de grands sujets de notre époque. Cela s’appelait alors l’Université Libre d’Eté de Creuse (ULE), reprenant un nom qui avait été créé par Jean-Michel Dauriac en 2008, à Chéniers, pour des rencontres, privées d’abord, puis ouvertes au public, avec ses étudiants de la région bordelaise. Cette expérience dura de 2008 à 2012, puis se mit en sommeil. La reprise de 2015 gardait la méthode de travail, mais s’ouvrait à un public plus large.
Il fut décidé que ce serait l’avant-dernier week-end de juillet qui serait le rendez-vous annuel. Ce qui s’est passé chaque année depuis, sauf l’année 2020 avec la pandémie.
Un cadre juridique associatif fut donné en 2020, avec Aux rêves du Frêne, référence à Fresselines, lieu des manifestations.
Cette année 2025 marque donc les 10 ans de ces rendez-vous. Chaque année un thème est choisi par l’équipe organisatrice, à l’intérieur d’un thème général, « Habiter le monde ». Le thème 2025 est :
Et nos campagnes, alors ?
Ce sujet s’inscrit dans la logique des années précédentes, où furent traités les thèmes suivants : Villes et campagnes, Le climat change, et nous ? , Nos modes de vie….
L’ensemble s’inscrit dans une démarche d’information, de discussion et de proposition autour de ces sujets qui nous concernent tous. Les rencontres du frêne n’ont pas vocation à soutenir telle ou telle position politique mais à ouvrir les esprits par la découverte d’informations de qualité et la pratique du débat. Il appartient ensuite à chacun de se servir de ces connaissances comme il l’entend. Les organisateurs revendiquent une complète liberté vis-à-vis de tous les partis politiques et groupes de pression, mais ils revendiquent également toute liberté d’expression des intervenants invités.

Le programme de la session 2025 en détail
La session de cette année s’étend sur le samedi 20 et le dimanche 21 juillet.
Nous proposons une variété d’activité : conférences, débat, soirée artistique, concert.
Les conférences
Quatre causeries sont offertes au public.
Samedi matin, à 10 h 30 : La méthanisation, par Francis Duchiron, professeur retraité de l’université de Reims.
La méthanisation est le processus naturel de dégradation anaérobie de la matière organique. Elle produit du biogaz essentiellement composé de méthane identique au gaz de ville ; mais celui-ci est renouvelable contrairement au gaz disponible actuellement.
Nous exposerons d’abord le fonctionnement de la méthanisation au sens scientifique ; c’est-à-dire les micro-organismes et les voies métaboliques impliqués.
Nous regarderons ensuite les sources potentielles de matière première, ce qui déterminera où implanter des unités de méthanisation. A la ferme, dans les villes pour en recycler les déchets organiques liquides (station d’épuration anaérobie) ou solides (station de méthanisation en phase solide) ; dans les usines agroalimentaires pour recycler les déchets.
Vaut-il mieux avoir des petites unités individuelles sur chaque ferme, ville, station d’épuration, usines agroalimentaires ; ou des équipements plus gros voir industriels ? Ce choix doit être un choix politique effectué en concertation avec les citoyens.
Samedi après-midi, à 14 h 30 : Les paysages racontent une histoire : la nôtre, par Jean-Michel Dauriac, Professeur honoraire de géographie dans les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE).
Le mot paysage est un terme commun. Mais il a aussi un sens plus précis, en art ou en géographie. Notre conférence se propose de définir les sens propres de ce terme et la richesse de son apport, en présentant les enjeux des paysages, leurs significations diverses et la synthèse géographique, la lecture historique que l’on peut en faire, ainsi que la présentation des acteurs qui en sont auteurs et usagers, voire fossoyeurs. Nous ferons le choix de privilégier les paysages ruraux.
Dans un second temps, nous effectuerons un voyage spatio-temporel dans les paysages de la France, du paléolithique au XXIe siècle et nous expliquerons, exemples illustrés à l’appui comment il est possible de lire notre histoire et notre avenir parfois dans ces paysages variés de la campagne française.

Jean-Michel Dauriac (à gauche) et Francis Duchiron (à droite) en pleine intervention publique, à Fresselines, durant l’été 2024. (Photo C. Dauriac)
Samedi après-midi, à 16 h 30 : Sauver les haies ? par Philippe Hirou, spécialiste des haies et bocages.
Alors que, depuis plus de 40 ans, l’on a pris conscience de l’importance des haies pour l’agriculture et les territoires ruraux et mis en place des politiques de replantation, pourquoi continuent-elles de disparaître ? Le constat est amer : on en replante 4000 km, mais il en disparaît plus de 20000 km chaque année. Leur image toujours négative au sein de la profession agricole, la radicalisation du débat entre écologie et économie, ou entre ville et campagne, la disparition des agriculteurs eux-mêmes et l’agrandissement des fermes l’expliquent en grande partie. Mais c’est aussi le résultat de pratiques d’entretien destructrices et du changement climatique.
Pourtant nous en avons encore plus besoin vis-à-vis du climat et de la biodiversité et elles peuvent être un atout pour l’agriculture et les territoires. Un atout économique en premier lieu, à la fois par des bénéfices et des coûts évités. De nombreux territoires se chauffent avec le bois des haies, dans le cadre de plans de gestion durable les préservant. Il ne s’agit pas du pillage auquel on assiste parfois, sans intérêt pour l’agriculteur ni pour le territoire local. En matière de lutte contre les inondations et l’érosion des sols, les haies sont une solution efficace. Le ralentissement du flux de l’eau et son infiltration vers les nappes phréatiques sont des bénéfices directs du maintien ou de la création de haies bien placées et en bon état. Les assureurs ne s’y trompent pas qui indiquent qu’à l’échelle des territoires, en moyenne, 1€ investi en prévention économise 8€ de dégâts. Et la haie ne coûte pas cher à implanter, on peut d’ailleurs recourir à la régénération naturelle, gratuite, ni à entretenir, car il s’agit au contraire de moins l’entretenir pour lui laisser plus de place.
Dimanche matin, à 10 h 30 : Séverine, l’insurgée, Séverine l’oubliée, par Marie-France Boireau, Docteure en littérature et professeur honoraire de lettres en CPGE.
Séverine (Caroline Rémy, 1855-1929), un nom quasi oublié. Et pourtant, elle fut l’une des grandes journalistes de la fin du XIXe siècle, sans doute celle qui a inventé le journalisme d’investigation, celle qui a construit son identité de journaliste en se choisissant ce nom de plume, Séverine, celle qui a été une des premières journalistes professionnelles .
Alors, pourquoi un tel oubli ? Peut-être parce que Séverine fut une sorte d’électron libre et aucun parti, aucune association féministe, ne put et ne peut se réclamer d’elle. Dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle, elle ne cessa d’affirmer sa liberté.
Disciple de Vallès qui a été son mentor, qui lui a appris le métier de journaliste, Vallès dont elle disait « c’est mon père », et dont elle prit la succession à la tête du journal Le Cri du peuple après la mort du vieux communard.
Mais ce n’était pas simple, en cette fin du XIXe siècle, pour une femme, de diriger un journal, et surtout de maintenir les colonnes de ce journal ouvertes aux différentes sensibilités de gauche. Elle finira par quitter Le Cri du peuple où les guesdistes avaient pris le pouvoir et elle vivra de sa plume, écrivant dans des journaux d’obédiences politiques différentes.
Comme le fera un siècle plus tard Florence Aubenas, elle n’hésitait pas à enquêter sur le terrain, à descendre, par exemple, dans la mine à Saint-Etienne, après un coup de poussier qui fit 112 morts, à se faire embaucher comme casseuse de sucre pour comprendre le rude métier des ouvrières.
Longtemps réticente à l’égard des mouvements féministes réclamant les droits politiques pour les femmes, mue par un antiparlementarisme viscéral, elle finira par considérer que le droit de vote est important, en rejoignant le combat de son amie, Marguerite Durand, créatrice du journal La Fronde.
Son titre de gloire : la défense des pauvres, sa lutte contre la misère, lutte pour laquelle elle a déployé des trésors d’imagination et d’énergie.
Le grand débat, samedi 20 juillet à 18 h 00 : Et nos campagnes, alors ?
En présence de F. Duchiron, J-M. Dauriac et Ph. Hirou
Avec en invité, grand témoin : Philippe Auvillain, agriculteur retraité, ancien responsable creusois de la Confédération Paysanne
Ce temps de discussion avec le public, permettra à chaque conférencier de préciser certains points de leurs conférences, à la demande et d’échanger des points de vue sur le monde rural et son avenir.
Le grand témoin présentera son parcours et les options majeures qui semblent les meilleures pour les agriculteurs, l’agriculture, le milieu et l’alimentation des Français.
A l’issue de ce débat, l’association Aux rêves du frêne offrira un apéritif consistant aux présents. (20 h 15 -21 h 30)
Une soirée culturelle Poésie et chansons (21 h 30 – 23 h 00 environ)
Les participants sont invités à venir avec un texte ou un poème qu’ils ont envie de partager avec l’assemblée. Christine Guillebaud, poétesse bien connue des Creusois, dira des poèmes de son choix, Jean-Michel Dauriac chantera des chansons de sa composition et fera chanter la salle sur des chansons françaises connues.
Avec un hommage à Marcelle Delpastre, poète corrézienne, née en 1925.
En option, en fonction de la météo du ciel : Observation astronomique, à partir de 22 h 30, avec Laurent Sartre, astronome amateur et conférencier scientifique.
Concert de clôture de la session : dimanche 20, église de Fresselines, 16 h 00
Fréquences Libres, par l’ensemble Gabriel
Un verre de l’amitié, servi dans la salle polyvalente, clôturera cette session 2025
Contacts :
Jean-Michel Dauriac : dauriacjeanmichelgmail.com – 06 33 84 71 69
Francis Duchiron : francis.duchiron@univ-reims.fr – 05 55 89 71 60
* * * * * * * *
En partenariat avec l’UPHG (Université Populaire des Hauts de Garonne – Lormont 33)
Vous pouvez vous abonner aux vidéos hebdomadaires des conférences UPHG, en adhérant à l’association, pour 10€ par an.
Contacts : Jean-Michel Dauriac, président, jmdauriac@laposte.net
Leave a Comment