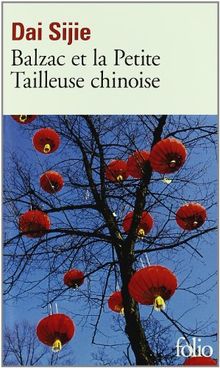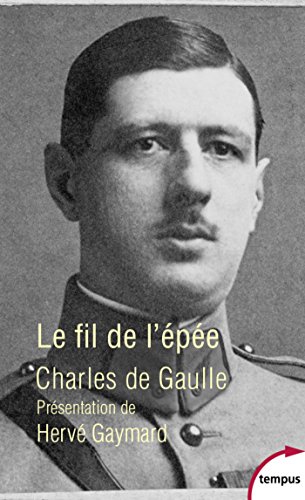Paris, éditions Perrin, collection Tempus, 2015, 146 pages
Il y a quelques années, les Mémoires du Général de Gaulle ont été mises au programme du bac français ; je me souviens que certains enseignants (de gauche évidemment) ont crié au scandale et demandé le retrait de cet auteur qui sentait trop la politique nationale. Querelle stupide et injustifiée, comme ce petit livre pourra le prouver à ceux qui prendront le temps de le lire.
Cet ouvrage paraît en 1932, chez Berger-Levraut . Il reprend le texte de conférences publiées en 1927 par le capitaine de Gaulle dans l’amphithéâtre de l’Ecole Militaire de Paris. L’ouvrage publiée ajoute au texte des trois conférences deux autres articles. Dans la version de poche que je présente ici, il y a une préface de Hervé Gaymard, gaulliste reconnu, qui introduit assez remarquablement le texte.
Le sujet peut sembler très spécialisé et ne concerner que les militaires : nous trouvons un chapitre titré « De l’action de guerre », un autre nommé « Le politique et le soldat », et un troisième appelé « De la doctrine », sous entendu « militaire ». Certes ces chapitres sont d’abord adressés à des officiers, en ce qu’ils traitent du commandement en temps de guerre, du rôle des diverses doctrines d’Ecole Militaire et des rapports entre l’homme d’Etat et le grand soldat. Mais dès que l’on entre dans la lecture de ces chapitres, il est aisé de se rendre compte que le propos est en fait bien plus large que les titres pourraient le laisser croire. L’auteur mène une réflexion a double entrée. Le premier niveau est objectivement militaire et pourrait faire partie d’un cours pour les officiers, dans une académie idoine. Le second niveau est une réflexion de portée philosophique et historique qui ne peut manquer d’intéresser le lecteur curieux et cultivé. La pensée reste certes axée sur la chose militaire, mais elle s’élève suffisamment pour la rendre civique au sens le plus large. Sous la plume de De Gaulle, le métier des armes est décrit comme une vocation et une forme de sacerdoce. Evidemment cela fait frissonner en moi l’anarchiste chrétien. Mais il faut avant de rejeter ces positions au nom du pacifisme ou de la foi, comprendre quel est le moteur de cette vocation.
Pour le capitaine de Gaulle, c’est d’une grande limpidité au fil des pages : c’est la France et l’amour qu’il lui porte qui justifient cette vocation. Dès le début des années 1930, il manifeste un attachement extrêmement profond à son pays. Cet amour n’a rien à voir avec un patriotisme belliqueux ou un nationalisme haineux comme les années 1930 en ont fait naître et en ont usé. Non, l’amour de la France est ici quasiment une mystique. De Gaulle se situe dans le droit fil de Jules Michelet et de Paul Vidal de La Blache, pour lesquels la France était une personne. On se souvient de la phrase qui ouvre le premier volume des Mémoires du Général : « Toute ma vie je me suis fait une certaine idée de la France. » Tout est dit : la France n’est pas une abstraction pour l’auteur, elle est une patrie vivante dont l’histoire est la source. En lisant Le fil de l’épée, le lecteur ne pourra pas manquer de remarquer à quel point son auteur est un fin connaisseur de cette Histoire de France, celle de Michelet ou de Mallet-Isaac. Et sa connaissance ne s’en tient pas à la chose militaire – dont il fait ici une démonstration remarquable -, mais elle embrasse à la fois l’histoire civile et religieuse et s’étend à l’histoire antique, par une connaissance précise des auteurs. Cet aspect justifie déjà à lui seul sa place de littérateur. Il est également évident que cette vaste culture et ces références ne peuvent plus du tout parler aux générations actuelles de lycéens et même d’étudiants, tant leur inculture historique est notoire (à quelques très brillantes exceptions près évidemment). D’où l’intérêt des très nombreuses notes de bas de page que l’auteur a incorporées à son travail. Dès la lecture de ce petit livre, nous savons que ce militaire est aussi un homme de grande culture.
Mais au-delà de ces connaissances très vastes, il faut aussi parler de l’écriture de De Gaulle. Il y a un style gaullien –que ceux qui ont eu la chance d’entendre les discours du Général ont perçu -, qui est très classique, marqué par les humanités qu’il a étudiées. On ne badine pas avec la concordance des temps chez le Général. ! Le lexique est très riche et la syntaxe parfaite. Pour De Gaulle, la langue française est un des aspects de la France : on ne saurait la maltraiter si on prétend l’aimer. J’ose à peine imaginer quelle serait sa réaction, aujourd’hui, en entendant le niveau de langue des journalistes ou des hommes politiques ! Cette langue est-elle de nos jours obsolète ? Si l’on s’en tient aux repères évoqués ci-dessus et à une grande partie des livres publiés, sans aucun doute. Mais elle est obsolète au même titre que la langue de La Fontaine, dont les élèves ne perçoivent plus le sens, ou que celle de Voltaire et de son ironie, sans parler de celles de Molières, Racine ou Corneille, et même Victor Hugo ! En lisant ce livre je mesurais à quel point nous avons sacrifié l’intelligence de notre jeunesse par lâcheté, en leur donnant de plus en plus de bouillie à boire au lieu de les habituer à mastiquer du consistant. Toute une énorme partie de notre patrimoine littéraire et théâtral est hors de portée des enfants de France et notre Président reçoit à l’Elysée des rappeurs et des influenceurs qui sont la quintessence de cet effondrement. Faut-il se résigner ? Certes non, mais le combat est très inégal. Comment faire livre ce petit livre à un élève de terminale ou à un étudiant en histoire moyen ? La tâche n’est pas impossible, mais elle est très ardue et nécessiterait un accompagnement à chaque page. Si l’on aime notre langue (et donc notre pays), on ne peut que déplorer la situation actuelle, fruit de cinquante ans de démissions successives, de droite comme de gauche.
A côté des trois chapitres spécifiquement militaires, il faut retenir deux chapitres beaucoup plus philosophiques et psychologiques, titrés « Du caractère » et « Du prestige ». Certes ils parlent d’abord du rôle des chefs militaires mais le lecteur comprendra très vite que la portée du discours est bien plus générale. Il y a quelque chose de stoïcien dans ces deux textes, par lesquels le capitaine De Gaulle décrit une ascèse et une éthique du commandement. Et que l’on ne dise pas que c’est un traité de management, pour essayer de le banaliser et de le ranger dans des cases pré-formatées. La réflexion que l’officier mène, alors qu’il a 37 ans quand il rédige ces pages, décrit par anticipation ce que sera son comportement dans les heures tragiques de la France, en 1940, en 1944, en 1958 ou 1962, voire même en 1968. Il y a là, déjà parfaitement décrite et analysée, sa conception de l’homme de caractère et la conduite à tenir dans des circonstances exceptionnelles qui abolissent la chaîne de commandement et mettent le chef face à ses seules responsabilités. Ce que l’auteur énonce est infiniment au-delà de la discipline souvent stupide de l’armée. Le chef est celui qui sait, quand il le faut, ne pas obéir à un ordre inadapté et choisir la solution qui lui semble la plus efficace et juste. Car le prestige du chef est nécessaire dans ces circonstances. Il faut qu’il ait gagné la confiance totale de ses hommes pour pouvoir les faire agir selon un ordre divergent de celui de la hiérarchie. Et ce prestige ne se gagne que dans l’action, nullement dans la théorie et les salons. Ce livre est d‘ailleurs un plaidoyer pour l’action, qui seule révèle le caractère et permet d’acquérir autorité et prestige. C’est parce qu’un chef est juste et au milieu de ses hommes qu’il peut exiger le sacrifice. On comprend bien que cette éthique de l’autorité est aisément transposable au domaine civil. Bien des chefs d’entreprises, notamment dans les start-up, devraient méditer ce texte, s’ils en sont capables. Le prestige et l’autorité ne s’acquièrent pas en donnant des jours de congé et des tables de ping-pong !
Donnons la parole à l’auteur, dans un extrait assez célèbre chez les gaullistes :
« Face à l’événement, c’est à soi-même que recourt l’homme de caractère. Son mouvement est d’imposer à l’action sa marque, de la prendre à son compte, d’en faire son affaire. Et loin de s’abriter sous la hiérarchie, de se cacher dans les textes, de se couvrir des comptes rendus, le voilà qui se dresse, se campe et fait front. Non qu’il veuille ignorer les ordres ou négliger les conseils, mais il a la passion de vouloir, la jalousie de décider. Non qu’il soit inconscient du risque ou dédaigneux des conséquences, mais il les mesure de bonne foi et les accepte sans ruse. Bien mieux, il embrasse l’action avec l’orgueil du maître, car s’il s’en mêle, elle est à lui ; jouissant du succès pourvu qu’il lui soit dû et lors même qu’il n’en tire pas profit, supportant tout le poids du revers non sans quelque amère satisfaction. Bref, lutteur qui trouve au-dedans son son ardeur et son point d’appui, joueur qui cherche moins le gain que la réussite et paie ses dettes de son propre argent, l’homme de caractère confère à l’action la noblesse ; sans lui morne tâche d’esclave, grâce à lui jeu divin du héros. » (p. 60-61).
Outre la beauté du style, on ne peut qu’être saisi par la force de la prise de position. L’homme de caractère est donc celui qui « paie ses dettes avec son propre argent ». Toute la force de l’éthique gaullienne est là : il existe des situations où il faut savoir trouver en soi la ressource qui permet de prendre l’action à son compte, alors même que celle-ci ne vous mettait pas en jeu. C’est ce que fera l’inconnu général de brigade en juin 1940, qui lancera, avec une audace incroyable, cet appel insurrectionnel du 18 juin, face à un régime de Vichy et à une France couchée devant la défaite et les vainqueurs. De cette date, les Français apprendront à connaître la force de caractère de cet homme unique qui avait déjà annoncé sa position dans Le fil de l’épée.
Un peu plus loin dans le même texte, il fustige la société de consommation naissante, avec des accents elluliens assez surprenants :
« Or, notre siècle, à peine au tiers écoulé, aura vu se succéder deux âges radicalement dissemblables et sans autre transition que la guerre [ de 1914-1918]. Les contemporains doivent faire effort pour se représenter les années d’autrefois : ère de stabilité, d’économie, de prudence ; société des droits acquis, des partis traditionnels, des maisons de confiance ; régime des revenus fixes, des traitements certains, des retraites calculées au plus juste ; époque du trois pour cent de l’échelle mobile, du vieil outillage et de la dot réglementaire. La concurrence, aidée de la technique, a fait fuir cette sagesse et tué cette douceur : groupe allégorique qui symbolise l’âge nouveau. La guerre a grossi en torrent le cours naturel des choses et transformé l’assiette des besoins. Pour satisfaire ceux-ci, tels qu’ils sont, divers, impérieux, changeants, l’activité des hommes se multiplie et se précipite. Plus éphémère que jamais sont le succès, la mode, le gain. Quelle clientèle se conserve, quelle réputation est définitive, combien de temps une machine demeure-t-elle assez moderne ? La chevelure de la Fortune, coupée court, offre peu de prise, et tous la poursuivent à présent, même celui-là qui, naguère, l’attendait dans son lit. » (p. 66-67).
Ainsi l’auteur a-t-il pressenti ce que Bernard Charbonneau appelle la Grande Mue et en rend-il responsable à la fois le marché (la concurrence) et la technique. Rédigé en 1927, ce texte mérite d’être connu pour sa prémonition, laquelle n’est en fait que l’analyse des gens profonds et intelligents ( ce qui surprend toujours les sots et les superficiels).
Dans la conférence « Du prestige », De Gaulle se livre à une analyse des ressorts de l’autorité et de son corollaire, le prestige, forme distinguée du respect. Il fait, là aussi un diagnostic temporel ;
« Notre temps est dur pour l’autorité. Les moeurs la battent en brèche, les lois tendent à l’affaiblir. Au foyer comme à l’atelier, dans l’Etat ou dans la rue, c’est l’impatience et la critique qu’elle suscite plutôt que la confiance et la subordination. » (p.73).
Si ce diagnostic est celui de la fin des années 1920, que dire d’aujourd’hui, où la notion même d’autorité est rejetée par la grande majorité des dirigeants et penseurs, souvent sous des formes détournées, mais bien réellement. Analysant un peu plus loin les constituants du prestige, il peut écrire :
« Mais s’il entre dans le prestige une part qui ne s’acquiert pas, qui vient du fond de l’être et varie avec chacun, on ne laisse pas d’y discerner aussi certains éléments constants et nécessaires. On peut s’assurer de ceux-là ou, du moins, les développer. Au chef, comme à l’artiste, il faut le don façonné par le métier. » (p.76).
Ici De Gaulle mentionne ce que l’on nommera un peu plus tard le charisme et dont les historiens de la fin du XXème siècle feront un grand usage. En termes de marketing pour commerciaux, on dirait que le leader doit posséder les qualités du leadership. Lesquelles sont toujours, quand cela fonctionne, un mélange d’inné et d’acquis. Mais, comme le souligne notre auteur, les qualités qui peuvent être acquises doivent être cultivées. Elles ne feront jamais le grand chef, tel César, Alexandre ou Napoléon, mais elles peuvent assurer la gloire des seconds couteaux de l’Histoire. De Gaulle aborde donc logiquement ensuite ces qualités à travailler . Et la première est sans nul doute surprenante en notre temps de réseaux sociaux, de paparazzi et de storytelling pour ne prendre que trois thèmes à la mode.
« Et, tout d’abord, le prestige ne peut aller sans mystère, car on révère peu ce que l’on connaît trop bien. » (p.76).
Nos présidents depuis 2007 devraient méditer ce texte chaque soir, avant de s’endormir et pas seulement Le Prince de Machiavel. Lorsqu’il fut le héros de la France puis son président durant onze années, le Général a suivi très scrupuleusement ce principe. Il est resté un homme inaccessible au commun, une sorte de héros antique, qui savait prendre des bains de foule pour prouver son incarnation, mais ne laissait rien filtrer de sa vie familiale et de son monde intérieur. L’exemple navrant de MM. Sarkozy, Hollande et Macron nous montre, a posteriori, combien il avait raison. Il énumère ensuite d’autres qualités sur lesquelles je ne vais pas m’étendre, mais qui sont tout aussi importantes : la sobriété du discours, la réserve systématique, l’identification avec de hautes idées… Il est très cruel de remarquer que ceci dépeint exactement le contraire de ce que font nos dirigeants actuels. De ce point de vue, aucun d’eux ne peut raisonnablement se prétendre gaulliste. D’ailleurs l’image du Général est devenue encombrante, il faut donc la ranger dans les livres d’Histoire, aux côtés des Clemenceau, Napoléon et autres caractères.
Je ne désire pas aller plus avant dans le dévoilement de ce grand petit livre, qui inaugure la carrière du plus grand Français du XXème siècle, quoi qu’on en pense par ailleurs. Je crois que le peu que je viens de citer suffit à monter combien stupide fut l’attitude de rejet des professeurs de lettres face à sa mise au programme : réaction de « petits » devant la grandeur, mais plus grave encore, aveuglement de professionnel devant l’écrivain, alors que les mêmes font étudier à leurs élèves des scribouillards qui disparaîtront comme la buée du Qohélet[1].
Le fil de l’épée est un jalon de premier ordre dans la naissance de l’écrivain De Gaulle, qui confirmera par la suite, dans ses Mémoires, tout son talent. Mais il est aussi une anticipation remarquable du destin de celui qui aima la France passionnément et eut assez de caractère et de prestige pour la sauver du déshonneur et l’ancrer dans une république démocratique et stable. Ce n’est pas rien !
Jean-Michel Dauriac – juillet 2021
[1] Dans le livre de l’Ecclésiaste, le mot est traduit par « vanité » : « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent ». Lire les chapitres 1 et 2 de ce livre de la Bible.