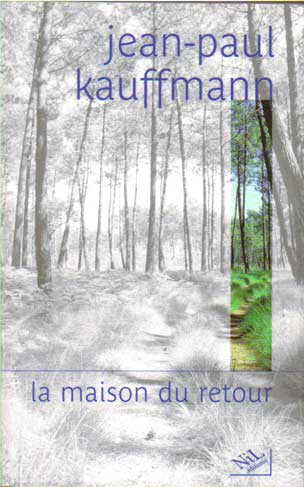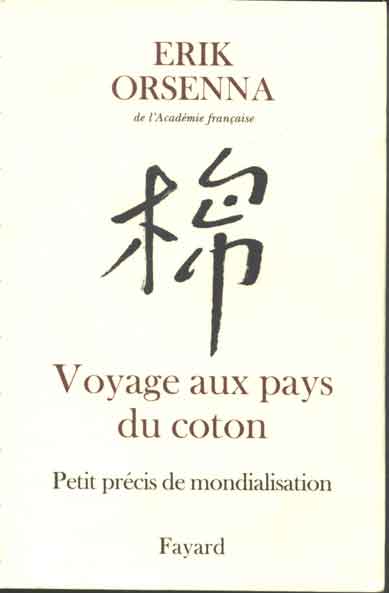Assurément ceci est est un bon roman. Je ne puis dire s’il deviendra un grand roman, seul le temps le dira et je ne serai plus là pour le savoir. Mais ce livre a tout ce qu’il faut pour le devenir, ensuite ce n’est plus que l’histoire complexe d’une transmission, d’une rencontre avec des générations de lecteurs, de choix scolaires et académiques… Bref, une part non-négligeable de hasard existe…
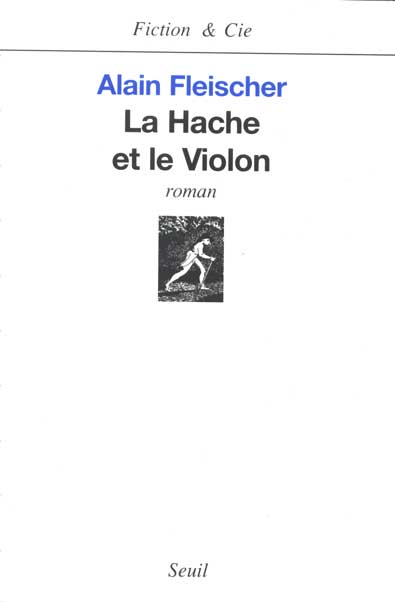
Le personnage principal de ce livre est un musicien et professeur de musique juif que nous rencontrons pour la première fois dans son appartement d’une ville d’Europe Centrale, hongroise plus précisément, au cœur du ghetto, alors que « la fin du monde débute sous sa fenêtre ». Nous voici embarqué pour une très long premier mouvement qui narre l’improbable épidémie mystérieuse qui frappe les habitants de cette ville et dont nous suivons, période après période, l’avancée ; Cela constitue en soi un roman de près de trois cents pages. Ce jeune musicien voit sa vie rythmée par trois jeunes filles toutes trois surnommées Esther, qui se succèdent pour divers motifs dans son appartement. Esther du matin fait le ménage contre un salaire qui lui permet de poursuivre ses études, Esther de l’après-midi est une brillante étudiante en piano et Esther de la nuit est à la fois la nièce et la maîtresse de notre héros. Fleischer entretient tout au long de cette partie l’idée que ces trois Esther sont une seule et même personne qui compartimente sa vie autour du musicien. Et nous y croyons dur comme fer ( de hache) ! Même si cela traduit une vie bien compliquée pour notre personnage. La Hache, c’est le nom que l’on donnera à la mort donnée par cette épidémie incompréhensible, en liaison avec le bruit sec qui accompagne la frappe brutale du fléau qui ne touche en rien le corps des victimes, mais les abat comme un chêne. Cette mort brutale est d’abord associée à la musique classique car les premières victimes revenaient d’un concert quand elles furent frappées. Fleischer déchaine alors son humour pour stigmatiser l’impuissance politique et médiatique. Son récit est de la grande famille des grands récits symboliques. La Hache est le totalitarisme dans ses diverses manifestations. Mais personne ne comprend vraiment cela et les dirigeants s’usent et se déconsidèrent en parades stériles jusqu’à l’effondrement définitif du système. La musique finit par être, au contraire, identifiée comme LA protection idéale, après avoir essayé toutes les variantes possibles de régime (militaire, nationaliste, populaire…). Le maître de notre héros, Chamansky est le créateur du violon du titre. Ce violon qui va détourner Esther de l’après-midi du piano pour en faire une violoniste de talent, jouant sur un instrument parfait. Le destin de notre personnage bascule, car il épousera plus tard la fille d’une de ces Esther-là, devenue violoniste concertiste à son tour. Le violon a sauvé sa vie, d’une certaine façon. Récit à clefs, on peut relire de nombreuses fois cette partie, elle aura toujours quelque chose de nouveau à dévoiler ; c’est le propre des grands romans, et la tare des mauvais de n’être pas « relisible ». Le style de cette première partie est travaillé de manière typiquement juive, par une réitération de certains leitmotives, à l’image de la musique kletzmer. J’ai songé évidemment au style du grand écrivain yiddish, I.B.Singer. L’auteur nous rythme et nous promène ainsi avec ces éléments de repère qui reviennent et sont devenus des évidences au bout des 289 pages.
Les parties suivantes seront de plus en plus courtes et ne retrouveront que deux ou trois thèmes du leitmotiv, « la fin du monde », « la fenêtre », « Esther ». La seconde partie nous plonge au cœur de la Hache du XXème siècle, le nazisme. L’action est resserrée ; l’auteur voir, toujours depuis sa fenêtre, les SS venir en force arrêter tous les élèves et profeseurs de l’école de musique qui est en face de chez lui. Seul le concierge sera relaché, il n’était pas juif. On comprend vite que nous sommes embarqués dans la logique des camps et de l’extermination, où les futures victimes de la solution finale sont accueillies par un orchestre jouant de la musique classique. Esther de l’après-midi est embarquée. Commence alors un long récit remarquable, celui d’un rêve où l’auteur est incarné dans le commandant du camp de Teresin, un officier SS. Il voit tout , comprend tout, nous explique tout, mais n’a aucune possibilité d’agir sur les faits. Esther de l’après-midi est la victime de cette période ; elle sert d’abord à satisfaire le caprice du commandant, puis celui-ci l’expédie à Birkenau où elle disparaît. Dans ce chapitre, Fleisher dissèque formidablement bien la barbarie SS et la schizophrénie culturelle des nazis. Et ce autant avec ce qu’il dit qu’avec ce qu’il ne dit pas. C’est ici que l’on rejoint une autre caractéristique de son style : une écriture de cinéma. Il travaille en longs plans-séquences, en flashbacks et en inserts, manie merveilleusement l’ellipse. C’est livre aussi visuel que sonore. C’est aussi dans cette partie qu’il détruit en quelques pages tout ce qu’il avait bâti dans la première partie sur les trois Esther. Il nous montre sans aucun doute qu’il s’agit de trois personnes différentes qui n’en ont fait qu’une par son imagination seulement. Sa nièce, son amante est partie avec une troupe de théatre Yiddish en Palestine, avant la mise en œuvre systématique de l’extermination ; Esther de l’après-midi est morte à Auschwitz. C’est avec Esther du matin qu’il va prendre la décision de s’enfuir en Amérique, à Chicago où il va retrouver son oncle Karoly. Là commence une vie de pianiste associé à la boxe, où il met au point une méthode d’entrainement des boxeurs de son oncle autour des rythmes de la musique classique. C’est une période assez banale qui ne portre aucun fruit. Esther meurt sans lui avoir donné d’enfant.. Il abandonne la boxe quand son oncle vend son école et rejoint un orchestre symphonique où il est une sorte de sparring-partener des musiciens. Avec cet orchestre il va parcourir le monde, c’est ce qui nous amène à la troisième époque, en Israël en 2002.
Notre musicien a quatre-vingt dix ans, mais il a la force et la vigeur d’un homme de trente ans (est-il d’ailleurs ce vieillard ou son petit-fils, nous ne le saurons jamais). Il rencontre une violoniste superbe, appelée Esther dont il tombe amoureux et avec laquelle il va parcourir le monde. En 2002, ils sont à Jérusalem pour un concours de musique où il est juré et où Esther présente ses élèves. Et revient soudain « La fin du monde sous ma fenêtre » qui avait disparu de l’époque américaine. Un attentat a lieu juste en face de l’hôtel où il est, il assiste à l’explosion, mais sans un bruit audible, derrière les vitres isolées du palace. Encore une fois, effet cinématographique assuré. Dans la mare de sang, Esther et ses deux étudiants. Il décide alors de s’installer en Israël, seule terre qu’il peut envisager comme pays. Nous arrivons alors à la dernière époque, située en 2042.
Comme la première, celle-ci nous fait basculer en plein fantastique. Israël ne doit son salut qu’à une diaspora chinoise de convertis au judaÏsme, d’abord venus en Israël pour remplacer la main d’œuvre juive défaillante, car il y a un exode de population juive devant l’état de guerre permanent. Notre héros chenu mais toujours vert rencontre alors une de ces juives chinoises, évidemment rebaptisée Esther qu’il épouse et qui, cette fois, lui assurera une descendance nombreuse avec sept enfants, un peu comme dans les postérités miraculeuses de la Torah. Puis ces chinois reviennent en Chine et se livrent à une action incroyable : constituer Le Très Grand Israël sur le territoire chinois, en traçant un pays invisible, mais calquant Israël en l’étirant aux dimensions de l’Empire du Milieu. Notre héros habite dans la nouvelle Jérusalem de Chine Yelousaleng. Il y est devenu une sorte de patriarche de 120 ans vigouerux comme un Priape dont la tâche consiste à inséminer de jeunes juives chinoises pour créer une postérité de sang juif. Il a déjà environ 7 000 descendants. Apparemment on se retrouve ici dans une autre parenthèse du récit. Là, pas de Hache et de violon, sauf sur le blason de la ville. Mais que pourra-t-il advenir de ces nouveaux juifs chinois ? Le livree s’arrête là. Notre héros rêve toujours de son Esther de la nuit, dont il attend le retour, qui ne peut avoir lieu que par sa mort.
Que dire de ce livre ? Le style est d’abord un peu horripilant car déroulant une sorte de caricature littéraire juive ; puis on se laisse emporter. L’aspect extrêmement visuel du récit est un bel atout. L’imagination est fortement stimulée. Les trouvailles scénaristiques marchent à fond, et je ne serais pas autrement surpris que Fleischer signe un jour une adaptation cinématographique de son livre. Mais je ne sais quel cinéaste vivant aura le talent de mettre cela en images. Il faudrait un nouveau Fellini !
On peut cependant émettre des critiques. L’histoire peut être jugée de deux points de vue opposés avec pertinence. Soit comme un récit ésotérique extrêmement bien construit, kafkaïen en quelque sorte. Soit comme une histoire un peu baclée qui ne recule pas devant les facilités pour aller au bout du récit. Il y a sans doute des deux. La première partie est très réussie, très homogène et, avec quelques aménagements cela aurait fait un roman satisfaisant. La seconde s’enchaîne assez bien, mais il faudrait sans aucun doute une conclusion plus claire qui fasse le lien avec la partie précédente : comment est-on passé du règne de la musique et des musiciens se faisant élire à la tête de l’appareil politique locale à l’hégémonie nazie. Le seul lien est fourni par le cadre temporel et les personnages, ce n’est pas du tout clair. Mais c’est avec les trois épisodes suivants, Chicago, Israël et la Chine que l’histoire semble un peu brouillonne. Il me semble qu’il y a là des faiblesses du récit. Le lecteur ne peut pas reconstruire tout ce qui manque. Il aurait besoin d’être éclairé, mieux guidé. C’est ce qui donne, quand on referme la dernière page un sentiment mitigé, une sorte d’insatisfaction. Mais une autre hypothèse est que je ne sois pas assez intelligent pour comprendre ce livre, ce qui est tout à fait possible.
Un bon livre donc, mais sans doute pas un grand livre, pour les défauts signalés ci-dessus. Mais il faut le relire pour émettre un avis définitif.
Jean-Michel Dauriac – Août 2007
Leave a Comment