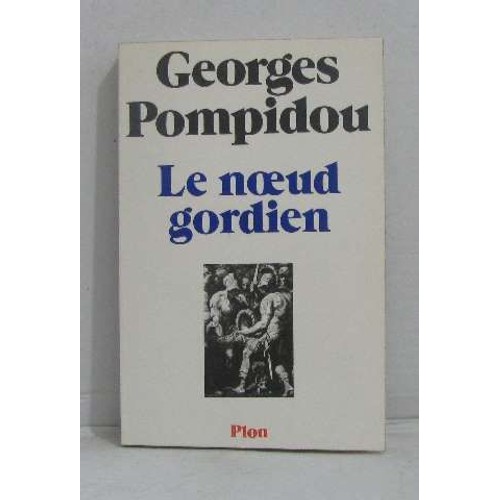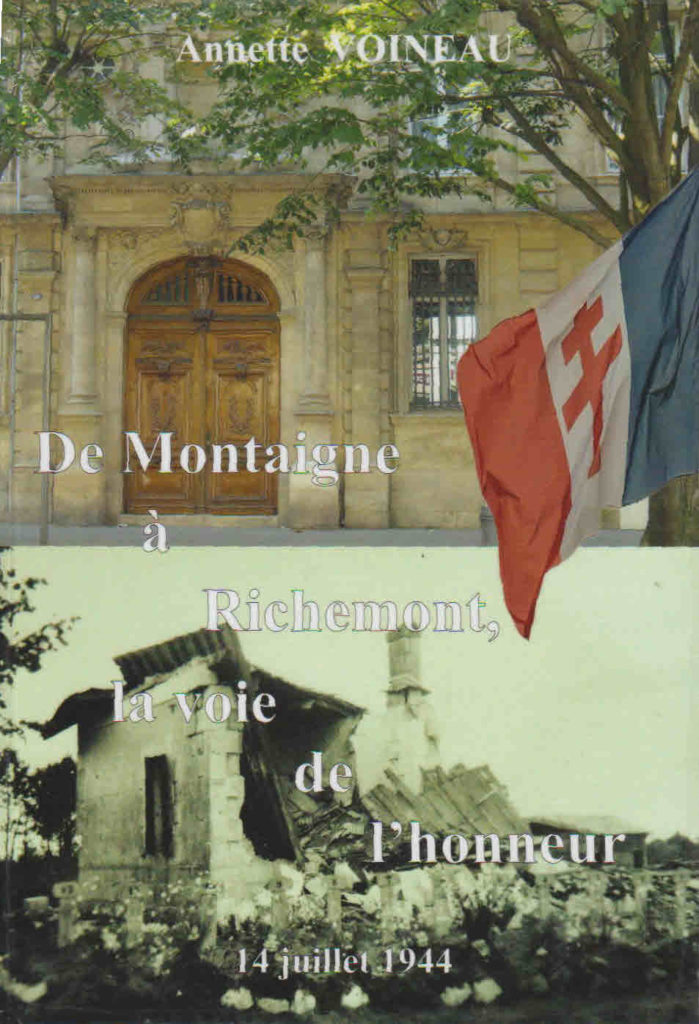Le Noeud gordien – Georges Pompidou (1974)
Paris, Editions Plon, 1974.
En 1970, j’avais 16 ans et le peuple français des citoyens de plus de 21 ans venait d’élire un président, qui n’était pas du tout un inconnu, puisqu’il avait été premier ministre du général de Gaulle durant 6 ans : Georges Pompidou. C’est peu dire que ce bonhomme-là ne m’emballait pas. Déjà, physiquement, avec ses sourcils broussailleux, il avait un aspect sauvage que ne pouvait évidemment pas effacer son minois de renard. Je ne pense pas que la jeunesse de l’époque, quelles que soient ses idées politiques, ait été enthousiasmé par Pompidou : il incarnait la poursuite de la vieille France de De Gaulle, dont nous étions alors incapables de saisir toute la grandeur (mais ce temps viendrait !). Sa présidence fut interrompue par sa maladie, qui le faisait changer à vue d’œil, son cou enflant à chaque apparition télévisée, puis, un jour, on nous annonça sa mort… Et il passa dans les oubliettes de l’histoire, ringardisé par les Kennedy français que rêvaient d’être Jacques Chaban-Delmas et Valéry Giscard d’Estaing. On sait comment le premier fut politiquement assassiné par le second qui devint le Président suivant. Et la poussière de l’oubli tomba sur Pompidou qui ne survécut dans la mémoire collective que grâce à Beaubourg. L’histoire pourrait s’arrêter là.
En cette année 2024, on vient de commémorer les cinquante ans de sa mort – c’est fou ce que l’on commémore quand on n’a plus d’idées pour l’avenir ! – et il est clair que l’on a assisté à une forme de réévaluation de la personne et de son action. C’est peu dire que nous avions été injustes avec lui ! Mais la jeunesse n’est pas réputée pour son sens des nuances et sa grande culture. Nous n’échappions pas à la règle. C’est avec le temps que je me suis rendu compte de mon erreur. Non que je sois devenu pompidolien, mais les années passant et les présidents se succédant, je n’ai pu que constater que leur qualité se dégradait progressivement, jusqu’à toucher le fond avec les trois derniers (Sarkozy, Hollande et Macron). Rétrospectivement, Pompidou apparaît enfin comme un homme intéressant et un président digne. Ce sera le travail des historiens de le remettre en son juste rang dans la Ve République. Les Américains se sont ainsi livrés au même travail envers Jimmy Carter.
Peu après la mort de Georges Pompidou paraissait une livre intitulé Le nœud gordien. Dès le titre s’impose l’évidence d’un choix de haute culture. Le nœud gordien fait allusion à la légende sur la ville de Gordius, où se trouvait un chariot enserré par un nœud de branches de cormier ; il se disait que celui qui pourrait dénouer ce nœud serait un jour roi de toute la terre. Alexandre (le grand) passant par là, prit connaissance de la légende ; voyant qu’il était impossible de dénouer ce lacis de racines, il tira son épée et trancha le nœud par son milieu. G. Pompidou place donc ses réflexions sous ce patronage, montrant ainsi la difficulté à exercer le pouvoir et à dénouer les liens qui l’empêchent.
A la lecture du contenu du livre, ce titre devient une évidence. Le livre permet de découvrir un homme d’une grande lucidité et assez modeste pour reconnaître les limites de son rôle et de celui des politiques en général. Il s’agit d’une réflexion sur certains moments de sa vie politique et sur la société française de son temps, avec une vision prospectives très lucide.
Le livre commence par « Réflexions sur les événements de mai ». Il s’agit évidemment de mai 1968 et de ses grèves et manifestations, de la situation pré-insurrectionnelle et de ses acteurs. Pompidou se trouva précipité dans cette tempête et fut appelé à y jouer le rôle principal, celui qui permit de dénouer la crise, en négociant et signant les accords de Grenelle avec les grévistes. Le texte ne prétend pas être un compte-rendu de ce moment, mais une suite de réflexions personnelles. Pompidou met en avant deux faits majeurs de cette période agité : l’ennui d’une société matériellement satisfaite et le malaise d’une jeunesse étudiante privilégiée.
Sur ces étudiants il écrit :
« Oui, au regard de tant d’autres jeunes, ces révolutionnaires de Mai étaient des nantis, des privilégiés. Mais beaucoup de révolutions sont le fait de privilégiés insatisfaits. Le problème est de savoir pour quoi les nôtres étaient insatisfaits » (p. 37).
Tous les témoignages et travaux sur Mai 1968 lui donnent raison. Des fils de bourgeois qui ne manquaient de rien voulaient tout casser, mais pour quoi mettre à la place ? Là est la vraie question, qui n’a pas de réponse : il n’y avait aucun projet sérieux alternatif, et on se souvient de l’embarras de la gauche face à l’éventualité d’un renversement du régime.
Sur le climat général, voici une remarque :
« Mais il serait imprudent d’oublier cette lassitude, cet ennui provoqué par l’existence d’un régime stable et la présence du même homme à la tête de l’Etat, signe de la maladie endémique de la France et surtout de Paris : la légèreté.» (P. 32).
On sait que le Général ne comprit absolument pas ce qui se passait, sauf qu’il était décalé par rapport à ces jeunes contestataires. Et que c’est sans doute à ce moment-là qu’il prit la décision de se retirer à la première occasion opportune.
Par ailleurs, pour le plaisir, il faut lire les quelques lignes vachardes que Pompidou écrit sur la sociologie, faculté qui fut à l’origine de l’embrasement.
« Il s’agit là d’une science balbutiante, dont beaucoup de spécialistes ont d’autant plus d’assurance que leurs connaissances sont plus incertaines et bien souvent, en France au moins, mal assimilées. […] Ne menant pratiquement à rien et les bourses aidant, ces études n’ont pas de raison de finir : il est caractéristique de constater que la plupart des leaders du mouvement de Nanterre avaient passé l’âge où un homme normal déserte la faculté pour un métier et l’étude pour l’action. » (P. 22).
Oserais-je dire, sans choquer mes lecteurs que je partage assez ce point de vue.
Georges Pompidou a cependant compris qu’il ne serait plus possible, après mai 68, de gouverner de la même façon, il le dit expressément. Il avait pleinement raison. Sous les pavés du BoulMich’ furent ensevelis les pratiques républicaines usuelles et les repères des générations précédentes. Ce texte assez court montre, d’entrée, le ton du livre : une acuité de jugement remarquable et un net recul sur les événements. Après ce texte, il ne sera plus guère question d’événements précis, sauf peut-être dans le second chapitre, « Du dialogue », dont on comprend qu’il s’inspire de l’expérience de Grenelle. Il y livre quelques pensées sur les héros et le lien avec le peuple. Mais, par la suite, il va prendre de la hauteur et aborder des sujets généraux sans les relier directement à la politique gouvernementale. Il abordera ainsi la question des institutions, de l’université, des politiques économiques et sociales et le crépuscule du marxisme.
Je n’ai pas l’intention de résumer chaque chapitre, il faut les découvrir. Je me bornerai à relever quelques citations apéritives.
Dans le texte « Du gouvernement des Français et l’avenir des institutions », Pompidou se livre à une défense et illustration du système politique de la Ve République. Il affirme clairement que le Premier Ministre est sous la dépendance du Président et qu’il est normal qu’il en soit ainsi. Il loue d’ailleurs ce système pour sa stabilité. Il insiste sur la nécessité pour un Président de choisir un Premier Ministre qu’il connaisse et apprécie, car de leur complémentarité découle le bon fonctionnement des institutions. Il faut relire ce texte dans le contexte politique d’aujourd’hui pour mesurer à quel point le peuple français a changé et combien sa défiance envers le personnel politique et les institutions est grande.
Dans le chapitre sur l’université, on peut lire ceci :
« Le baccalauréat « national » est une absurdité, de plus en plus difficile d’ailleurs à organiser, même pratiquement. […] Pour parler clair, je suis partisan de la suppression du baccalauréat national. J’estime que chaque établissement secondaire, ou – à titre de transition – chaque académie départementale, devrait attribuer aux élèves ayant suivi les cours de l’enseignement secondaire un diplôme indiquant qu’il a fait ses études dans des conditions bonnes, moyennes ou médiocres. » (P. 92-93).
C’était il y a cinquante ans. C’est devenu une évidence criante aujourd’hui que l’on feint de ne pas voir. Et on ne peut pas accuser G. Pompidou de mépriser le système scolaire et l’ascenseur social qu’il représente : il en est une parfaite illustration. La fiction de valeur de cette pelure est battue en brèche à chaque instant dans le parcours de formation et la recherche d’emploi. Il est un colifichet offert aux familles populaires qui, pour certaines, y croient encore.
Le texte intitulé « Crépuscule du marxisme » est fort intéressant et montre bien la perspicacité de Pompidou. Il annonce en effet la mort prochaine du marxisme, alors que dans le pays, le PCF pèse encore fort lourd et que le bloc soviétique impressionne encore.
« Sans forcer la dose, je crois pouvoir dire ceci : en dépit des succès considérables remportés par l’U.R.S.S. dans quelques domaines privilégiés et spectaculaires, l’économie de type marxiste est en train de perdre ouvertement la partie dans la compétition avec les économies occidentales. » (P. 111).
Il fallait déjà une grande lucidité pour affirmer cela à cette époque tant la propagande et le trucage des statistiques faisaient de l’U.R.S.S. le grand rival des Américains. Mais tout cela était une économie Potemkine, un décor pour abuser les Occidentaux. En 1978, quatre ans plus tard, la Chine rouge décrétait l’invention du « socialisme de marché », soit un virage à 180° et une option pour un capitalisme contrôlé par le Parti. Il faudra 17 ans au bloc soviétique pour s’effondrer et l’on découvrira alors le désastre économique.
Les derniers chapitres sont des considérations sur l’économie et la politique sociale française, non pour une apologie de la politique pompidolienne, mais pour tracer des perspectives. On sera surpris, là encore, par la finesse de certains remarques prédictives. Je voudrais, pour terminer, citer quelques phrases du dernier chapitre intitulé De la société moderne. On y découvre un auteur inquiet devant le contenu même de cette société.
« D’autre part, il est clair que pour ceux qui se donnent la peine de penser et aussi pour une grande partie de la jeunesse, le matérialisme de la société d’abondance ne satisfait pas les aspirations de l’homme et ne donne pas un sens suffisant à la vie. » (P. 177).
Georges Pompidou est l’auteur d’une très belle Anthologie de la poésie française, devenue une référence en la matière. Un homme qui aime la poésie ne peut pas être matérialiste pur et dur ! Le constat qu’il dresse dans cette phrase est bien vrai en 1974, il l’est encore plus en 2024 ! La société de consommation et la seule aspiration matérielle sont une impasse sociale et morale. Il poursuit, un peu plus loin :
« Quoi qu’il en soit, il faudra bien remettre en place des valeurs qui puissent servir de fondement à la société en même temps qu’assurer l’équilibre moral des individus. Il est inutile de chercher à ralentir le progrès scientifique, technique et matériel. On ne peut que s’en accommoder et chercher à préserver ou à recréer les valeurs élémentaires dont chacun a besoin pour se satisfaire de ses conditions de vie. Le progrès matériel, loin d’aider à la solution, la rend plus difficile, car il étend le champ de la réflexion et donc d’une certaine angoisse. » (P. 179).
Le gros mot est lâché, « valeurs ». Nos beaux esprits de gauche ont, depuis plus de trente ans, décidé que la notion de valeur sociale ou morale était une notion réactionnaire et de droite. Et il est vrai qu’ils ont prouvé par l’action qu’ils n’en étaient pas, en sapant et détruisant méthodiquement ce qui cimentait notre société. Il leur faudrait relire Jean Jaurès ou Léon Blum, ils en seraient scandalisés ! Pompidou voit bien, dès 1974, que le système de valeurs françaises est en train de s’écrouler, Mai 1968 en a été le grand ébranlement. Il sait aussi qu’une nation ne peut exister que si elle partage des repères communs, des envies et des ambitions. C’est ce qui s’étiole à partir des années 1970. Nous en sommes arrivés à un paysage moral et social qui est un champ de ruines. Nous avons, en conséquence, la société qui va avec, et qui va mal. La perception du malaise et du risque est donc vieille d’un demi-siècle pour qui savait réfléchir. Mais il n’y a pas eu de mobilisation en ce sens et on peut se demander, par exemple, quelles valeurs ont donc bien pu représenter pour les Français, les présidents Sarkozy et Hollande, sans parler du désastre Macron. A côté de ces ectoplasmes intellectuels, Georges Pompidou fait figure de génie ! On trouve, un peu plus loin dans le texte cette phrase pour le moins surprenante :
« Dans quel sans agir ? Je ne saurais aborder ici le problème le plus profond qui est évidemment spirituel et religieux. L’option fondamentale est bien de savoir si l’on considère la vie terrestre comme une fin en soi ou comme un passage, et du point de vue moral, si l’homme sera ou non jugé. » (P. 181-182).
J’avoue avoir été fort surpris de lire cela sous la plume de Pompidou. Je partage tout à fait ce diagnostic de l’importance vitale de la transcendance et de l’espérance. Mais avouons que ce n’est vraiment pas un propos tendance. Mais il s’avère que cette phrase n’est pas une sorte d’erreur d’écriture, mais bien la preuve d’une véritable conviction en la matière. La preuve :
« La conviction qu’il existe une puissance qui s’impose aux hommes constitue pour ceux-ci et donc pour ceux qui les dirigent une sorte de garde-fou d’autant plus utile que les moyens dont nous disposons aujourd’hui sont plus terrifiants. Il appartient aux Eglises de rendre aux hommes la foi dans l’Eternel : elles n’y parviendront pas, selon moi, en se sécularisant et en se plongeant dans le temporel. Mais cela n’est pas de mon sujet, ni de ma compétence. » (P. 190).
L’auteur est donc bien convaincu qu’il existe une puissance supérieure aux hommes, dirigés et dirigeants. Il a, dans la phrase cité plus haut, évoqué la possibilité d’un jugement de nos actes. Il s’agit bien, sans aucun doute, de références au christianisme et à sa doctrine. Et il va plus loin, en égratignant les Eglise qui, selon lui, se fourvoient et abandonnent leur mission. Elles cherchent à se fondre dans la société moderne pour continuer d’exister, alors que leur devoir est de développer la foi dans l’Eternel. Elles sont donc coresponsables de la débandade morale quand elles se fondent dans la doxa dominante. Leur devoir est dans la transmission et l’entretien de la foi, et dans la mise en œuvre de la charité (traduction du mot amour en grec). Il l’affirme un peu plus loin :
« La notion de charité, forme la plus élevée de la solidarité, reste donc nécessaire et doit être revivifiée et la solidarité des peuples riches vis-à-vis des peuples pauvres est une exigence fondamentale de l’avenir humain. » (P. 191).
Il ne parle pas là de colonialisme ou de néo-colonialisme, mais de véritable fraternité chrétienne, sous la forme de la charité évangélique. Très étonnant pour un président de la république laïque française.
Le livre s’achève sur un petit texte appelé « Le nœud gordien », qui est une mise en garde contre la montée des périls politiques. C’est encore une fois extrêmement pertinent.
J’ai lu avec beaucoup de plaisir ce petit livre (par la pagination) qui s’avère grand par son contenu. On peut, bien sûr, le lire comme un témoignage historique daté. Mais on doit aussi le lire comme une réflexion de fond sur l’évolution de notre pays et notre société. On y trouvera alors quelques accents prophétiques. Je dois donc dire que cette lecture a changé radicalement mon appréciation de Georges Pompidou. Bien entendu ce livre n’est pas réédité, il faut le chiner sur internet.
Jean-Michel Dauriac – octobre 2024.
Leave a Comment