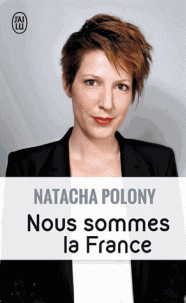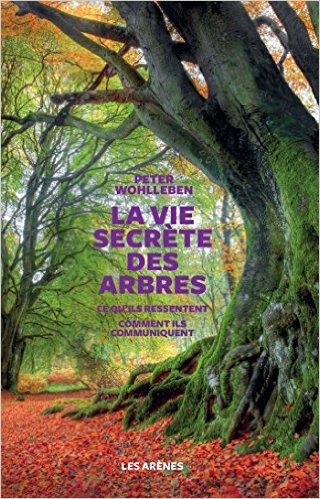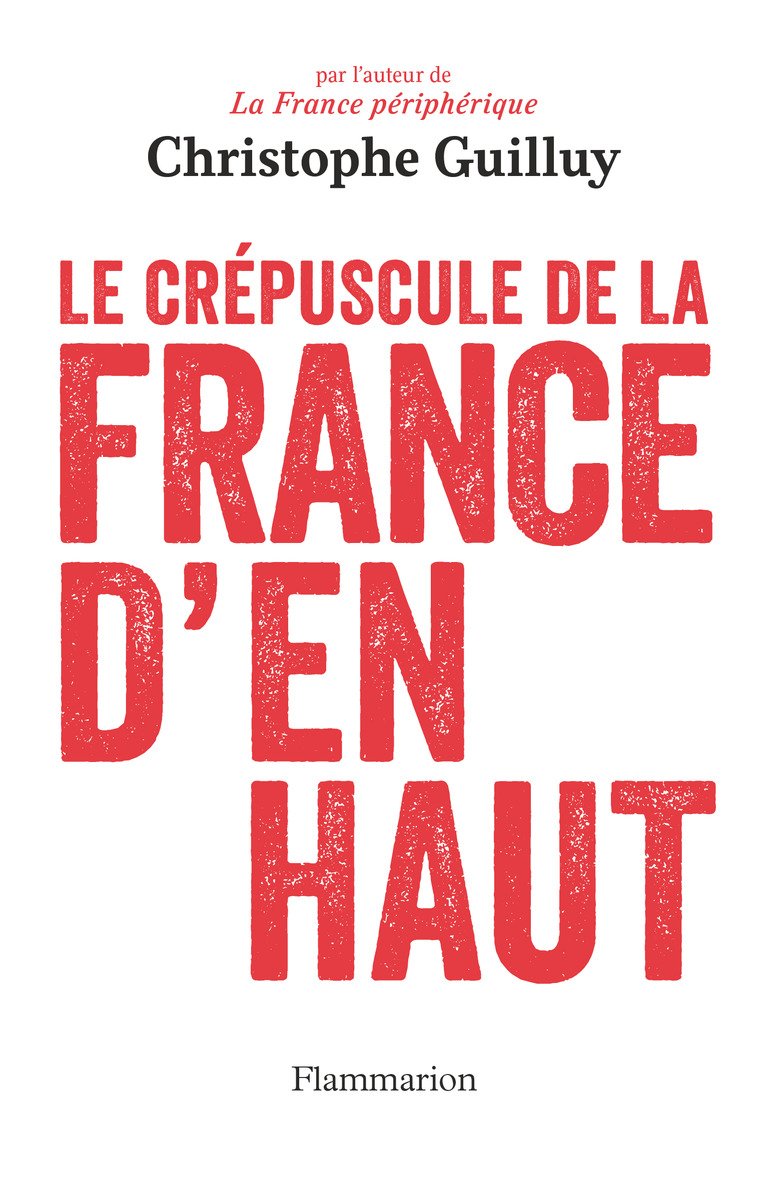Ce livre est le troisième volet d ‘un tryptique consacré à la fracture française, dont la publication a commencé en 2013, avec « Fractures françaises », puis ‘est continué en 2014 avec « La France périphérique » et s’achève, au moins temporairement avec le titre présenté ici. Tout ayant commencé en 2000 avec la publication d’ un « Atlas des fractures françaises » chez L’Harmattan.. Depui0 s plus de quinze ans donc, Christophe Guilluy explore la société française en géographe autour des lignes de séparation sociales, politiques, économique set humaines qui se manifestent dans notre pays. Il faut se souvenir qu’Emmanuel Todd, avant lui, avait inventé l’expression « Fracture sociale » que Jacques Chirac avait préemptée sans vergogne pour sa campagne victorieuse de 1995 et dont on sait à quel point elle n’eut aucune suite ni mise en œuvre dans ses deux mandats.
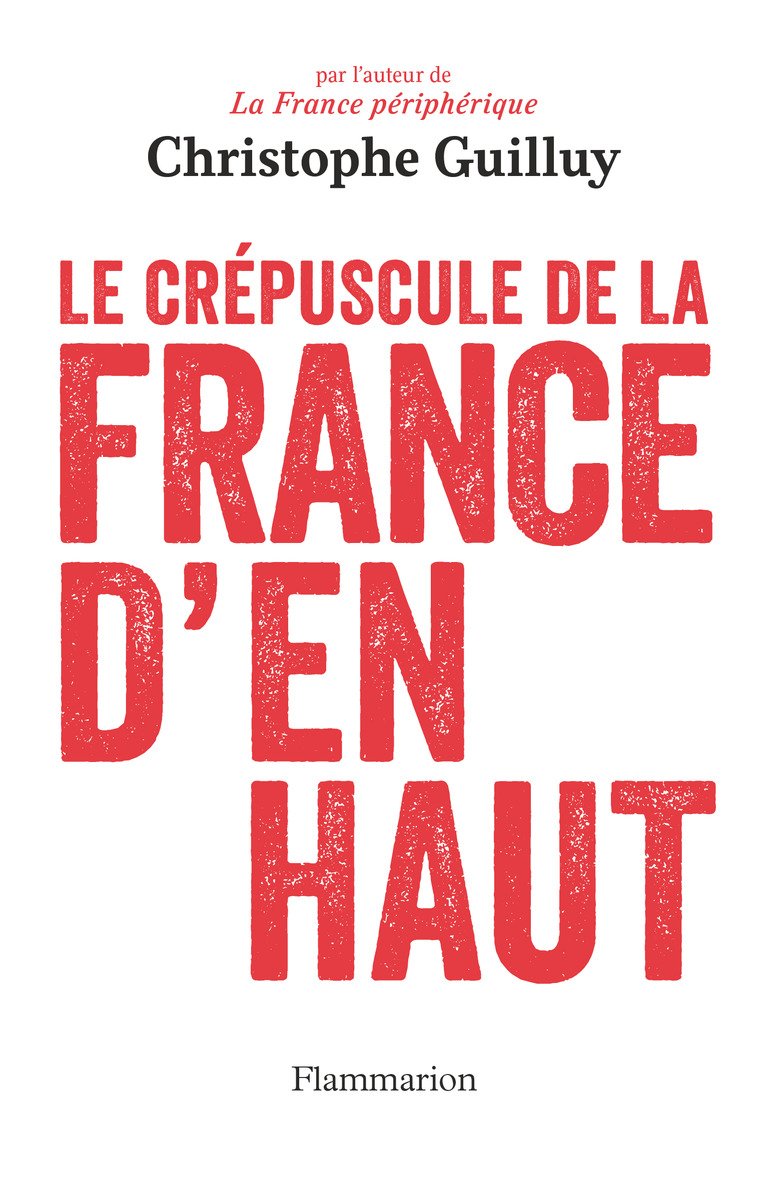
Il vaut mieux avoir lu « La France périphérique » avant de lire ce volume, tant il s’appuie dessus et en est le contretype. Dans ce précédent volume, l’auteur avait fait le portrait d’une France abandonnée à ses ennuis et à sa misère par la France gagnante. Son diagnostic était sans complaisance et lui a valu l’ostracisme de la gauche bien-pensante, alors même que, comme Michel Onfray ou Jacques Julliard, il est incontestablement homme de gauche. Mais la chape de plomb de la pensée unique sévit beaucoup plus à gauche depuis vingt ans qu’à droite, il est extrêmement aisé de le démontrer par les tribunes publiées dans la presse de droite par des penseurs de gauche qui ne peuvent plus le faire que là.
Les idées fortes sont peu nombreuses dans ce livre, qui n’est pas un ouvrage universitaire mais un livre grand public. F. Guilluy prend cependant la précaution de citer toutes ses sources qui sont sérieuses et étatiques le plus souvent. L’idée qui arme tout le livre et qui est répété à satiété est que les élites diverses (de la pensée, de l’économie, de la politique et de la culture) se sont non seulement coupées de la France modeste, mais la rejettent par un certain nombre de procédé techniques et médiatiques, au nom de valeurs humanistes dont elles auraient l’exclusivité et la compréhension. De cette idée majeure d »coulent des idées mineures qui valident la thèse. Les élites ont fait des métropoles ce que Guilluy appelle « les nouvelles citadelles » qui pilotent le pays et excluent ou incluent les populations. Ces citadelles reposent sur une nouvelle féodalité qui se consolide avec le temps. Une quinzaine de métropoles à l’échelle du pays dominent les secteurs-clés de l’économie, de l’emploi et de la pensée sous toutes ses formes. S’y retrouve une partie de la France périphérique, au titre de la force de travail non qualifiée nécessaire aux basses besognes. La société s’y est américanisée totalement et use des médias comme paravent de ses manœuvres idéologiques. La ségrégation spatiale est son arme, camouflée derrière le discours sur la diversité qu’elle promeut mais en évitant surtout, pour les dites-élites, de la vivre au quotidien. Paris en est la quintessence. Cette société ne cherche nullement à assimiler ou intégrer les arrivants, elle a tout misé sur le multiculturalsime de fait et choisit de plutôt misé sur les immigrés que sur les classes populaires traditionnelles (ouvriers et employés). Tout ce modèle repose sur un contrôle médiatique sans faille qui crée les représentations collectives nécessaires à la poursuite des choses. Mais ce schéma se grippe, car les classes populaires se sont nettement désaffiliées du discours politiques et sont entrain d’inventer d’autres modèles de terrain, dans une solidarité contrainte, qui laisse le champ politique abandonné. C’est ici que sont présentées les deux idées les plus intéressantes de ce livre qui, par ailleurs se répète pas mal.
La première idée donne son titre au dernier chapitre : « Le marronnage des classes populaires ». Guilluy développe l’idée que les catégories abandonnées de la France périphérique se comportent comme les nègres marrons des plantations d’outre-atlantique. Il s’agissait des esclaves en fuite qui allaient se cacher dans des terres inaccessibles et y créaient une société nouvelle détachée du monde des maîtres. Ce fut le cas du peuplement des cirques de l’île de la Réunion, refuges de négres marrons en raison de leur isolement.. les bayous du Mississippi jouèrent aussi ce rôle pour les esclaves américains. Cette approche est intéressante car l’étude du terrain la valide à de nombreuses échelles. Il existe une forme de contre-société en marche dans les espaces marginaux du pays, et ceux qui la composent et l’animent ne sont pas de hippies ou des baba cool, mais des français moyens que l’on a relégués et qui ont pris le parti de vivre autrement. Dans son très beau livre « Remonter la Marne », Jean-Paul Kauffmann utilise le mot « conjurateur » pour désigner ces hommes et ces femmes qui se battent pour conjurer le sort qu’on leur a jeté ou qu’on leur fait subir. L’idée est la même : les gens qui « marronnent » selon Guilluy sont les « conjurateurs » de Kauffmann. Il y a maintenant tout un travail fait pas des chercheurs et penseurs libres pour mettre en évidence ces initiatives sociales, économiques et culturelles qui fleurissent dans les territoires des villes moyennes et petites et dans l’hyperruralité comme on dit aujourd’hui à Paris. Il faut synthétiser tout cela pour saisir l’évolution irréversible qui coupe la société française en deux groupes qui n’ont plus grand chose en commun. Mais l’appréhension de cette forme émergente de marronnage ou de conjuration est porteuse d’espoir, d’autant plus qu’elle a lieu dans un contexte de sobriété subie qui est l’avenir de nos sociétés, n’en déplaise aux technophiles béats qui veulent nier l’appauvrissement planétaire des ressources et l’impasse qui nous attend s nous n’entrons pas dans la « conversion écologique » dont parle le pape François.
La seconde idée est plus politique et traduit bien la manipulation des mots et des médias que réalise la caste dirigeante de droite et de gauche ici réunie par la promotion et la défense de son modèle social mondialiste et ségrégatif. Il s’agit de l’usage de l’antifascisme (et donc en creux de l’usage du mot et de l’idée de fascisme).
« Véritable arme de classe, l’antifascisme représente en effet un intérêt majeur. Il confère une supériorité morale à des élites délégitimées en réduisant toute critique la mondialisation à une dérive fasciste et raciste . » page 173
Ce propos est clair et rend bien compte d’une technique rodée, qui consiste à traiter de fasciste tout individu qui remet en cause le modèle actuel mondialiste, multiculturaliste, métissé, technophile et libéral. L’anathème est immédiat et les médias le répercutent ad nauseam. Citons les cas de Finkielkraut interdit de venue au rassemblement de Nuit Debout ou de Michel Onfray, devenu brutalement réactionnaire parce qu’il dit des évidences niées par les bobos socialos qui font le contrôle médiatique. Cela serait dérisoire si l’on s’adressait à un public qui sait ce qu’est le fascisme. Mais ce n’est plus du tout le cas. Les mots « fascistes » et « nazis » sont instrumentalisés en dehors de toute vérité historique et idéologique. Est « fasciste » tout ce qui s’oppose clairement à la doxa dominante décrite en quelques qualificatifs ci-dessus. Il est donc aisé de constituer un front antifasciste contre une menace qui n’est pas réelle. Guilluy renvoie, et je le fais aussi, au livre de Pier Paolo Pasolini, « Ecrits corsaires », chez Champs-Flammarion, où, dans de nombreux articles de combat publiés dans la presse italienne nationale au début des années 1970, il dit de manière très claire ce qu’est le fascisme et ce qu’il n’est pas. Il avait su distinguer bien avant nous la dérive qui règne aujourd’hui et interdit tout vrai débat d’idée en France. Sont également frappés d’indignité nationale le souverainisme, les revendication régionalistes ou la promotion des identités locales.
Guilluy termine par l’idée que demain on pourrait faire un suffrage à points qui hiérarchiserait les électeurs en fonction de leurs « aptitudes » à bien voter. Il s’appuie sur l’exemple de l’analyse des résultats du Brexit par les médias français et les experts. En gros, ce vote est celui d’imbéciles qui n’ont rien compris à leur propre intérêt ; il faudrait donc ne pas tenir compte de ce vote ou en réorganiser un qui donnerait un résultat conforme à la pensée dominante. La même chose s’est produite en 2005 au moment des résultats du référendum sur le trait européen constitutionnel que les Français ont rejeté. Les propos des commentateurs et hommes politiques divers ont été ignobles de mépris pour les citoyens français et laissaient déjà augurer de l’objectif de ces classes dirigeants hors sol. Anne Hidalgo à Paris en est le plus magnifique exemple.
Ce livre n’est pas exempt de défauts formels, notamment dans ses répétitions, mais il a le mérite de dire tout haut ce que nous sommes nombreux à penser. Il va l’encontre de toute une doxa universitaire géographique que je connais parfaitement et qui empêche toute discussion au fond, en privilégiant un formalisme stérile et une pensée monocolore élaborée par quelques groupes parisiens essentiellement. Reclus, reviens, ils sont devenus fous !
Jean-Michel Dauriac
Beychac, le 13 octobre 2016