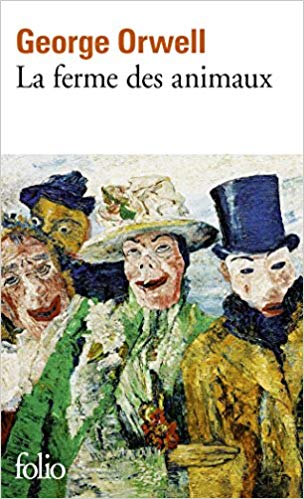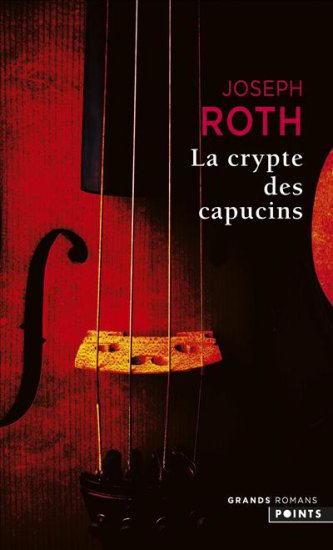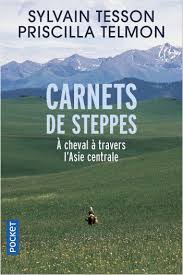La ferme des animaux
George Orwell Folio Gallimard
1945 première édition anglaise
1981 traduction française (2017)
George Orwell a écrit deux fictions dénonçant le totalitarisme de son siècle ; l’une est un ouvrage de science-fiction, « 1984 », et l’autre une fable animalière, « La ferme des animaux », qui est le sujet de cette chronique.
On le sait depuis l’Antiquité, rien n’est plus efficace que le conte ou l’historiette pour dénoncer les abus des puissants. Le genre de la fable en est l’illustration la plus populaire et la plus évidente à comprendre. La Fontaine n’a pas écrit des histoires sur le loup, le renard ou la belette. Il n’est pas un auteur animalier ou pour enfants. Il a saisi toute la puissance de ce style et l’impunité relative qu’elle pouvait lui accorder dans sa critique des travers sociaux de son temps. On n’arrêterait pas de citer ce genre d’écrits cryptés que la censure ne peut pas censurer sans se rendre totalement ridicule. J’ai souvenir d’un court métrage roumain sur l’élevage industriel des poulets, apparemment à la gloire du socialisme agricole de Ceaucescu et qui était en réalité un pamphlet impitoyable sur le régime déshumanisant du « Danube de la pensée » roumain. Tout est affaire de degré. De telles œuvres sont redoutables justement parce qu’elles sont compréhensibles simultanément à des niveaux différents par des publics mêlés.
« La ferme des animaux » a cette redoutable qualité de toucher tous les âges. On peut la lire avec des enfants, ils y verront un conte plutôt cruels sur la vie des animaux de la ferme. Il n’auront aucune difficulté à entrer dans cette histoire de révolte des animaux de la Ferme du Manoir, car l’auteur a observé les règles de simplicité du récit ; les animaux et les hommes se comprennent sans difficulté, sans faire intervenir une quelconque fée. Un enfant sera sensible au terme de la souffrance initiale des bêtes et à l’idée de révolte. Il prendra pour héros selon ses goûts, le solide cheval Malabar, le cochon Boule de Neige ou l’âne Benjamin. Il s’émoeuvra des ennuis des bêtes avec leur moulin à vent et sera révolté par la trahison des cochons de Napoléon. Et ce sera formidable ainsi, car c’est une lecture satisfaisante d’un enfant de dix ans.
L’adulte qui lira la Ferme des animaux, s’il a trouvé ce livre sans avoir jamais entendu parler de lui, sera surpris de cette histoire qui démarre comme le dessin animé « Chicken », où la volaille d’une ferme se révolte Il faut évidemment dire qu’ils se sont inspirés d’Orwell, dont le livre est édité pour la première fois en 1945. Mais assez vite, il comprendra le double sens politique de la fable. Et il sera pris au piège d’Orwell, qui nous fait adhérer complètement à son propos.
Il n’est pas question ici de résumer l’histoire, mais de comprendre ce que l’auteur, en 1945 veut dire aux lecteurs anglais. Il s’agit d’une réflexion sans concession ni aveuglement sur l’utopie révolutionnaire communiste. On pourrait bien sûr relever les expressions directement empruntées à la rhétorique soviétique. Ce qui est passionnant dans ce court récit, c’est de voir les diverses approches que le lecteur peut en faire.
Il y a d’abord le récit dans sa globalité ; Il commence par la révolte utopique et optimiste des animaux et se termine par le retour à une situation de domination et exploitation, mais avec la différence notable que les nouveaux maîtres sont les anciens dirigeants de la révolte, qui finissent par devenir comme leurs voisins jadis honnis. Les cochons, leaders de la révolution animale, à un moment donné se mettent à marcher sur leur pattes arrières, puis à se vêtir des fringues de l’ancien propriétaire. A la fin, dans un épilogue d’une cruauté sans pareille, Orwell achève sur cette phrase :
« Dehors, les yeux des animaux allaient du cochon à l’homme et de l’homme au cochon, et de nouveau du cochon à l’homme ; mais il était déjà impossible de distinguer l’un de l’autre. » (p.151)
La révolution s’achève dans une retour à l’identique, c’est bien le sens premier du terme « révolution », terme astronomique désignant le tour complet d‘une orbite d’un satellite ou d‘une planète autour de son soleil. Pour l’avoir oublié ou ignoré, des centaines de millions d’hommes ont été leurrés comme les animaux de la ferme du Manoir. Mais avant ce retour, Orwell aura eu le temps de nous faire voir les trahisons aux faits historiques (comment on réécrit l’histoire de la bataille de l’étable et on transforme le rôle de Boule de neige, le vrai héros de la révolte initiale. Boule de neige, c’est l’image de tous les héros de la Révolution de 17 trahis peu à peu par Lénine et Staline). La modification cachée des commandements initiaux de la Révolution animale est une belle trouvaille qui matérialise les trahisons successives des cochons. L’ultime maxime unique qui remplace les autres est magnifique et devenue depuis proverbiale, sans savoir que c’est à Orwell qu’on la doit :
« Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que les autres ». (p. 144.)
Il nous aura, entre temps, fait vivre l’espoir fou des premiers moments où tout semblait possible et où l’honnêteté régnait vraiment, puis les premiers renoncements au nom du réalisme et de l’adaptation au réel. Il faut bien comprendre tout ce que cette œuvre a de prophétique pour son époque. En 1945, l’URSS est auréolée de sa victoire sur le nazisme, Staline est déifié et « petit père des peuples », et George Orwell balance son pavé dans la mare de la ferme européenne. Beaucoup n’ont pas voulu entendre. D’autres n’ont pas pu. Ecouter Orwell était reconnaître que le rêve de révolution socialiste en Russie était une imposture tragique, une bouffonnerie. Evidemment le cochon Napoléon nous rappelle Staline, mais il est le nom de tous les dictateurs ridicules, tels que Chaplin en 1942 les a ridiculisés dans le film « Le dictateur ».
C’est donc un livre majeur que ce petit opuscule au titre inoffensif. Preuve, s’il en était besoin, de l’immense talent de son auteur, il l’est aussi de sa lucidité. Orwell reste une des grandes consciences de ce XXème siècle si tragique. Et d’autant plus qu’il n’a jamais renoncé à être socialiste, mais pas de celui des dictateurs. Il faut lire, relire Orwell et le faire lire. Si vous avez des enfants, offrez-leur ce petit roman et voyez comment ils réagissent. Mais faîtes-le surtout lire autour de vous, car ce livre ne parle pas du passé, il nous conte aussi comment l’utopie numérique va finir. A ce titre il reste prophétique.
JM Dauriac – Août 2018
Leave a Comment