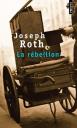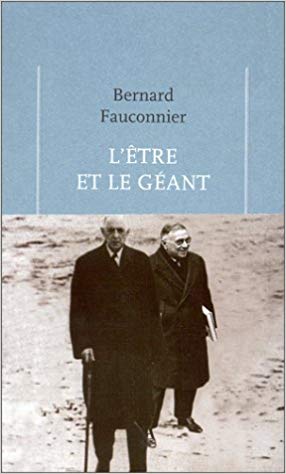Franz Schubert – La musique au cœur
Michele-Lhopiteau-Dorfeuille
Lormont, LE BORD DE L’EAU, 2019
206 pages, 33 €

Une si jolie musique!
Franz Schubert est, pour beaucoup, réduit à être l’auteur de La truite, et encore dans sa version adaptée en chanson plus ou moins enfantine. Pour la plupart des mélomanes amateurs, sa musique de chambre en petites formations constitue l’essentiel de son œuvre. Schubert souffre, comme on dirait dans la novlangue de notre merveilleuse époque, d’un « déficit d’image ». Mozart, Bach ou l’incontournable Beethoven de cette année 2020 (année anniversaire !) sont des stars, pour des raisons diverses. Le dernier membre de ce quatuor, lui, est ramené à ce portrait très classique qui orne la couverture de l’essai que lui consacre Michèle Lhopiteau-Dorfeuille : un jeune homme aux cheveux bouclés et à la face sympathique, simplement barrée d’une fine paire de lunettes. De lui, il est retenu qu’il mourut encore plus jeune que Wolfgang et moins sourd que Beethoven. Une des trouvailles de l’auteur est de proposer d’ailleurs comme explication de la mort du compositeur la même piste qu’elle avait explorée pour Mozart : l’empoisonnement aux produits pseudo-médicaux à base de mercure. Alors pourquoi donc Schubert est-il finalement beaucoup moins connu que ses illustres confrères ? Citons l’auteur, dans sa conclusion :
« Car Schubert est de toute évidence un homme moderne : Bach avait son Dieu, Mozart et Beethoven, en bons fils des Lumières, leurs utopies et leur foi en l’humanité. Franz, malade et désargenté dans un pays ruiné, prisonnier d’une époque à tous points de vue réactionnaire et dont l’avenir illisible préfigurait singulièrement la nôtre, n’eut rien de tout cela. Et en cela il nous ressemble. » (page 194).
A la lecture de cet essai – je préfère ce terme à celui de biographie, en raison des choix de l’auteur -, on découvre pourquoi, effectivement Schubert est notre plus-contemporain, par rapport aux trois autres compositeurs évoqués. Schubert est contemporain de l’Empire napoléonien et de ses guerres européennes, qui ont saigné une partie majeure de l’Europe, dont l’Autriche. Son époque marque le début de la fin (qui sera merveilleusement évoquée au plan romanesque par le grand écrivain Joseph Roth dans le dyptique La marche de Radetski et La crypte des capucins). Franz est essentiellement Viennois : Michèle Lhopiteau montre combien peu il voyagea, et pas très loin quand il le fit. Sa vie pourrait être sous-titrée « une histoire viennoise du début du XIXème siècle ». Sa vie ne met en évidence aucun fait saillant aucun scandale, aucun coup d’éclat. Il est le fils surdoué musicalement d’un directeur d’école, et lui-même débutera sa vie professionnelle en étant aide-instituteur, un boulot ingrat et mal payé qu’il n’aimait pas et abandonna dès qu’il le put. Voilà pour le portrait social superficiel. Mais là n’est pas l’important.
L’important est que Franz Schubert est un génie de la composition. Ce qui a été clairement compris et dit par ses amis, et reconnu par ceux qui ont pu entendre sa musique. Car le problème principal est là. Schubert, à la différence du trio majeur évoqué plus haut, n’a pas eu de mécène ou de protecteur , et sa musique n’a pas du tout obtenu l’audience qu’elle aurait mérité. Ajoutons à cela que le doux Franz n’est pas un animal de foire, virtuose dès l’enfance ou compositeur attitré, comme Mozart, Beethoven ou Bach. C’est là un des aspects passionnants de ce livre, de nous faire découvrir cette personnalité introvertie, que l’on qualifierait, aujourd’hui dans le cadre des mythologies de la réussite, de « loser ». Il n’a jamais su s’imposer, se pousser du col, ou simplement se signaler. Le résultat est impressionnant : sa musique, de son vivant ne fut jouée que dans des cercles restreints au sein desquels il évoluait. A l’exception d’un grand concert viennois organisé par ses amis, en 1828, jamais sa musique ne fut offerte au grand public.
Parler de Franz, c’est parler d’un cercle d’amis fidèles, qui l’accompagnèrent jusqu’à sa mort et même au-delà, se battant pour que sa musique soit jouée et reconnue à sa juste valeur.Très judicieusement, notre auteur débute son essai par un chapitre titré « La garde rapprochée » où elle brosse, par extraits de lettres et courtes notules biographiques le portrait de ce cénacle schubertien. On y voit donc que le compositeur a eu la chance d’avoir ces vrais fidèles autour de lui . Il est même assez vraisemblable de penser que s’il avait été seul, Franz Schubert aurait eu une petite vie terne et n’aurait peut-être pas créé tout ce qu’il a composé. Car nous apprenons, entre autres choses, que Schubert n’eut jamais de domicile vraiment personnel, mais vécut chez autrui selon les circonstances, tantôt chez son père, son frère ou l’un ou l’autre de ses bons compagnons. Car ceux-ci, bons viennois au fait de la musique de leur époque, avaient compris qu’il était vraiment génial et firent tout leur possible pour qu’il puisse composer et entendre se œuvres. Plusieurs étant de bons musiciens, montèrent des formations à cet effet. Un chanteur et une chanteuse de renom surent reconnaître la valeur de ses lieder et les firent connaître du mieux qu’ils le purent. Mais le bilan global des compositions jamais jouées ou seulement en cercle privé est impressionnant. Tout autant que la couardise (ontologique) des éditeurs qui refusèrent sa musique, soit parce qu’elle était trop complexe – ce qui était objectivement vrai -, soit parce qu’elle n’était pas connue (le serpent qui se mord la queue), soit simplement par paresse. Bref, si Schubert eut un bel enterrement –que la famille paya longtemps après – suivi par de nombreux amis et connaissances, à l’inverse de Mozart (Michèle Lhopiteau a aussi expliqué pourquoi dans un livre précédent), il mourut comme « inconnu célèbre » au-delà de Vienne.
C’est finalement l’acharnement de ses amis qui permirent d’éviter l’oubli et la foi de certains musiciens, comme Félix Mendelssohn, pour le remettre à sa juste place. Mais même aujourd’hui, le Schubert connu des musiciens et mélomanes reste celui des lieder et de la musique de chambre. Son œuvre religieuse et symphonique est mésestimée et méconnue. Ses opéras ne sont pas joués : mais là, il y a selon Michèle Lhopiteau, la raison objective de la faiblesse des livrets. Il y a encore une grosse marge de progression pour la reconnaissance de Franz Schubert.
A la lecture de cette chronique aura compris toute la richesse de ce livre, qui s’inscrit dans la continuité des trois autres (Mozart, Bach et Beethoven), que j’ai chroniqués en leur temps. Je dois ici redire le coup de génie qu’est le fait de joindre deux cd d’extraits à cette lecture. Ces extraits sont tous annoncés dans le texte, cela permet d’entendre aussitôt ce que l’auteur explique ou cite. Les plages sont dans l’ordre linéaire du texte. Mais, comme pour les précédents, ces deux disques peuvent s’écouter seuls, comme une sorte de best of de Schubert (ce que j’écris là est un crime pour l’amateur de musique classique !).
Mes remarques critiques porteront sur la forme et non sur le fond, auquel je n’ai rein trouvé à redire, l’information étant très sérieuse et l’expertise de Michèle Lhopiteau-Dorfeuille reconnue. Pourquoi ne pas mettre le lexique des formes et la chronologie de Schubert en fin de volume, comme cela se fait habituellement. C’est assez aride de débuter ainsi et le risque est soit que ce soit ignoré, soit que cela rebute le lecteur potentiel. Et il en faut peut, aujourd’hui, pour rebuter un lecteur, à l’ère du zapping qui n’épargne rien ni personne. Quant au chapitre XV « Schubert et le septième art », qui est une excellente idée (celle de montrer l’étonnant succès de Schubert comme « auteur » de musique de films), il aurait sa place en annexe, comme je l’avais indiqué dans l’ouvrage sur Bach, à propos du chapitre sur les « baroqueux ». Il s’agit simplement d’une précaution formelle visant à ne pas rompre l’unité thématique du livre. Tout en préservant ce travail intéressant qui vient en complément du reste. Car, il faut dire cela pour terminer, Schubert, bien plus que Mozart, Bach ou Beethoven, est un génie de la mélodie pure et en a composé un nombre impressionnant (d’où son succès au cinéma), toutes plus belles les unes que les autres, ce que les deux disques permettent amplement de vérifier.
Ce Schubert vient donc enrichir la connaissance des mélomanes et l’oeuvre de Michèle Lhopiteau-Dorfeuille qui, discrètement mais sûrement, s’impose comme un auteur de premier plan en musicologie populaire – secteur déserté par les spécialistes, car le peuple est infâme et ne mérite pas de jouir des trésors de la bourgeoisie éclairée (c’était la phrase Gilets Jaunes du jour) -, comme le démontre aussi le succès de ses conférences de vulgarisation (de vulgus en latin, le peuple, beurk !), notamment à l’Université Populaire des Hauts de Garonne, où elle officie bénévolement depuis des années, pour partager sa passion de la musique avec tous.
Jean-Michel Dauriac
Président-Fondateur de l’Université Populaire des Hauts de Garonne et mélomane.