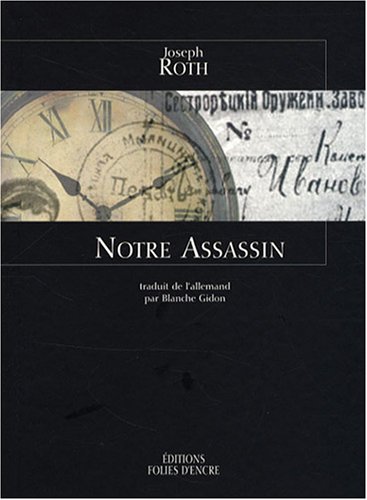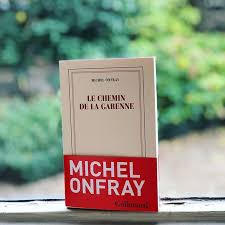
Le dernier ( ? n’en a-t-il pas déjà publié un autre ?) opuscule de l’écrivain-penseur normand est un petit livre de 90 pages, publié dans la qualitative collection blanche de Gallimard. A la lecture des pages de ces souvenirs, le lecteur comprend aisément le chemin parcouru (et pas seulement sur le chemin de la Garenne) par le petit Michel de Chambois. Lui, le fils du modeste et sérieux travailleur agricole (un brassier comme on disait avant la Révolution – qui n’avait que ses bras pour gagner sa vie) et de la femme de ménage, le voilà publié dans ce temple de la reconnaissance des lettres françaises. Bel exemple d’ascenseur social de la République et de son école laïque. Ne lui manque plus que l’Académie Française et La Pléiade pour être canonisé vivant ! Mais je sais que ce n’est pas vraiment son projet.
Ce livre est une promenade, au double sens du terme : promenade sur le dit-chemin de la Garenne, parcouru aujourd’hui, et promenade dans les souvenirs qu’éveille cette ballade contemporaine. On n’échappe pas à la nostalgie, quel que soit le nom qu’on lui donne. Il vient un âge, et Michel Onfray l’ a maintenant atteint, où l’âme nous pousse à nous retourner sur nos pas. Je dis l’âme volontairement et de manière provocatrice, car l’auteur, bien que réaffirmant son athéisme, livre un livre spirituel qui ne peut cadrer avec le matérialisme pur dont il se veut un tenant. Il se piège d’ailleurs lui-même à ce jeu, notamment vers la fin du périple, à propos du cimetière de Fel, où tout lecteur aura compris qu’il aimerait être enterré. Là, il rêve un instant à des escapades nocturnes pour aller quelques part sur le bord de la Dives, le petit fleuve né ici et contempler le monde Lisez la page 81 et vous verrez comment il désamorce cette tentation consolante. Un pur matérialiste ne pourrait même pas faire ce rêve de papier. D’ailleurs, à un autre endroit, Michel Onfray dit qu’il revendique une vie spirituelle laïque. Qu’est-ce qu’une vie spirituelle si ce n’est une vie de l’esprit ? Qu’est-ce donc que l’esprit, si ce n’est le contraire de la matière ? « L’âme, combien de grammes ? » demandait Staline à ses savants laquais ?

Il y a évidemment – c’est-à-dire de manière de plus en plus « en vue » – chez Michel Onfray une préoccupation qui dépasse le matérialisme. Cela me semble datable, pour moi, simple lecteur, qui ne prétend nullement avoir tout lu de lui, mais qui l’accompagne depuis ses débuts par mes choix sélectifs, de Cosmos et de sa préface, qui suit d’assez près la mort de son père et de sa compagne. La mort est souvent le révélateur suprême, inévitable et dérangeant nos certitudes. A cet égard, c’est encore un long chapitre ce court récit (le 4, pages 16 à 31) qui constitue le vrai cœur du récit. Prétextant le début de la promenade qui passe le long des murs de la vieille église du XIIème siècle, il raconte le dernier enterrement auquel il y a assisté. C’est celui de FB, un jeune homme (46 ans), qu’il connaissait et dont la famille avait des liens étroits avec la sienne (ils avaient été les employeurs du père), mort d’un enchaînements de maladies dont on ne se remet pas. Ce texte pourrait être sorti du livre et rejoindre les anthologies des écrivains à l’usage des scolaires. C’est aussi beau que du Maupassant et aussi vache que du Flaubert, avec un style d’authentique écrivain. En une quinzaine de pages, cela pourrait faire une nouvelle parfaite selon les canons du genre. Tout y est : une unité de lieu bien close : l’église et le cimetière, et une unité de temps très ramassée : le temps des funérailles. Les portraits vifs, parfois touchants d’émotion, souvent ironiques et quelquefois gentiment méchants, font mouche. Le curé du village n’en sort pas grandi, avec une homélie pitoyable qu’Onfray met en regard de la hauteur philosophique des propos qui l’avaient précédée, et notamment ceux du frère du mort, qui posait la question cruciale : Pourquoi ? Pourquoi un homme dont tout le monde s’accordait à dire qu’il était bon, aimable, généreux, attentif, etc.. est-il mort ainsi, dans la souffrance et si jeune, alors que d’infâmes abrutis finissent centenaires ? A cette question, Onfray espérait – est-ce une question rhétorique ? – que le prêtre apporterait un élément de réponse ; mais non, ce fut un recours pitoyable à un film et à sa mythologie, « Le seigneur des anneaux ». Voici comment il exécute ce curé :
« D’abord il ne savait pas quoi répondre, ensuite il convoquait Le seigneur des anneaux ! Qu’y avait-il d’autre à faire que de convenir que, décidément, oui, puisqu’il fallait entendre pareille péroraison dans la bouche d’un jeune prêtre, le christianisme était bel et bien mort… »
Eh bien, non, Michel, le christianisme n’est pas mort, mais il en est des curés, pasteurs, rabbins comme des médecins que tu as rencontré lors de ton AVC : il y a des bons et des mauvais : mais à la différence des médecins, ce n’est pas le savoir acquis au séminaire ou à la faculté de théologie qui déterminent le bon serviteur, c’est la foi vécue, l’expérience vraie de la transcendance et l’amour qui est découle de celle-ci qui sont les bagages utiles. A ce lancinant « Pourquoi ? » auquel nul n’échappe, pas même le croyant, la réponse n’est évidemment pas dans un recours stupide à un faux-fuyant mais dans le partage du doute et la force de la conviction. Tout ne s’arrête pas au cimetière lorsqu’on jette la poignée de terre sur la boite en sapins ou chêne, selon la richesse du décédé. Tu le sens bien, faute de la savoir par l’expérience, car tu succombes un instant à cette espérance :
« Rentrant chez moi et passant devant le cimetière, je n’ai pu m’empêcher d’être traversé par cette étrange idée : ce soir, le nuit venue, FB donnera à mon père des nouvelles des vivants. Je savais qu’il n’en serait rien, mais la seule idée m’a fait du bien. Puis j’ai songé à ce que serait désormais la date anniversaire de ce père privé de son fils. C’est ce qu’on nomme l’enfer, et il est sur la terre. Enfin, j’ai pensé également à la solitude de ses deux chiens qui ont perdu leur gentil maître. »
Cette étrange idée qui t’a traversé l’esprit – et pas l’intelligence neuronale des sciences cognitives – est ce que le croyant connaît sous le nom biblique de « pensée de l’éternité » dont la Bible dit sobrement en Ecclésiaste 3:11
« Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. »
Y-a-t-il une faiblesse à admettre que certaines choses puissent nous dépasser, et que la mort et la vie soient celles contre lesquelles butent tous les hommes depuis qu’ils pensent ? Qu’ils aient apporté à ces questions les solutions les plus diverses n’invalide nullement le sujet, mais prouve, au contraire, que c’est un invariant de la nature humaine.
A travers cette promenade se trouve aussi abordé la question de l’école républicaine. Il y a dans ce texte des pages magnifiques sur la foi des instituteurs d’antan, sur leur loyauté de service et le dévouement mis à servir l’enseignement pour tous. Je ne puis que te rejoindre sur ces pages : j’en suis comme toi, un pur produit. Comment un fils de modeste employé aurait-il pu devenir instituteur, puis professeur agrégé, puis professeur de classes préparatoires et théologien s’il n’avait bénéficié d’une formation scolaire d’une qualité extraordinaire. Je sais ce que je dois à l’école, c’est pour cela que j’ai aussi fondé et animé une Université Populaire. Je remercie ces instituteurs et professeurs qui ont cru en leur mission et en moi, ce qui était parfois difficile vu mon absolu manque de travail et mon agitation. D’ailleurs, devenant moi-même instituteur en 1974, j’avais l’impression sensible de poursuivre leur tâche et d’avoir seulement saisi le témoin lors du passage de relais. Je me souviens de la joie de mon ancien directeur d école primaire – qui m’avait corrigé manuellement bien souvent – quand il appris que j’étais instituteur : c’était sa récompense, la validation de son travail.
Mais je dois signaler mon désaccord sur la fin du chapitre où tu rends ce vibrant hommage à l’école. Tu livres deux paragraphes critiques qui commencent ainsi :
« Mai 1968 est passé par-dessus tout ça… »
Tu décris alors les changements brutaux survenus dans les classe, en des termes très satiriques et drôle, mais qui sont faux, car ils sont généralisés. J’ai vécu ces années dans une école primaire de banlieue dans un quartier de ce qu’on appelait alors une ZUP, mais pas encore stigmatisée par les signes de l’EN, la ZEP, le RADES et autres acronymes d’échec systémique. Je veux te dire que si l’école ne s’est pas effondrée à ce moment-là, pour devenir un immense barnum sans boussole, c’est bien à la résistance des enseignants qu’elle le doit. Il y eut bien ces instituteurs emportés par les modes et qui se mirent eux-mêmes dans une impossibilité réelle de transmettre. Mais ils ne furent jamais majoritaires et c’est pourtant eux que l’on a décrit comme les archétypes de l’évolution. Mai 68 a eu des bons côtés, en faisant sauter certains verrous stupides dans l’enseignement (notamment l’aspect militaire de l’organisation des lycées et collèges), mais aussi des côtés pervers, à cause du refus total des limites et contraintes. La « pensée 68 », si tant est que cela existe, a agi beaucoup plus dangereusement au niveau de l’Etat et notamment des structures de l’Education Nationale et la démolition de la grammaire française au nom du structuralisme et l’introduction des maths modernes, (incompréhensibles et inutiles à ce niveau), de même que l’irruption de l’éveil en lieu et place de l’histoire, géographie et sciences naturelles ont été des catastrophes nationales dont l’école primaire continue aujourd’hui encore à payer le prix, car elle ne s’est pas complètement guérie de ces errements impulsés par les brillants chercheurs des sciences de l’éducation, discipline qui devrait, en tant que telle, être bannie de l’Université au vu des dégâts constatés. Mais, de grâce, rendons justice aux instituteurs – et pas aux « professeurs des écoles » – d’avoir su, avec leurs moyens, dans leurs classes, résister et continuer de transmettre les bases utiles dans un bateau qui sombrait.
Enfin, à côté des pages spirituelles et de celles consacrées à l’école, il y a tout ce que tu écris sur la nature. Le texte sur l’empoisonnement de la Dives est un parfait résumé du « progrès » technique et agricole. Jadis il y avait une abondante faune et flore aquatique, dont tu parles avec délice et précision. Aujourd’hui le fleuve est mort, gavé de nitrates et autres produits invisibles. La Dives décrite est l’emblème du réseau hydrographique français, un des plus beaux du monde (c’est le géographe de métier qui parle) que nous avons massacré en quelques décennies pour arriver à une économie au bout de ses possibilités de croissance. Rassurons-nous, la nature est capable de se régénérer et, si nous disparaissons en tant qu’espèce, ce qui est tout à fait possible (c’est la fameuse « fin du monde » des chrétiens, vue sous l’angle terrestre) si nous ne changeons pas radicalement et immédiatement de route, la nature saura se relever : il suffit de voir comment elle a survécu et dépassé Tchernobyl, sur le site de la centrale, pour le comprendre. Les écologistes sont nés de cette peur, mais, comme tu le remarques, ils ont appris la nature dans les livres. J’ajouterais qu’ils ont essentiellement urbains, ce qui ne les rend pas particulièrement connaisseurs de la complexité du vivant en situation. L’histoire de la passe à saumon qu’ils ont obtenu sur la Dives est symptomatique de cette aberration. Il n’y a jamais eu de saumon sur ce fleuve, mais il faut qu’il puisse le remonter : on dirait du Pierre Dac ou du Desproges !
Alors, que conclure sur ce beau petit livre ? D’abord qu’il faut absolument le lire. C’est un texte court qu’on peut avaler d’une seule traite, comme la promenade décrite, quitte à y revenir par bribes, comme je l’ai fait pour écrire ce papier. Ensuite qu’il confirme le vrai talent d’écrivain de Michel Onfray. Peut-être est-ce d’ailleurs cette partie de l’œuvre qui restera ? La philosophie n’est jamais meilleure et plus efficace que quand on n’en fait pas expressèment. Mais par-dessus tout, on ne peut que constater que l’œuvre devient plus grave, non pas au sens latin de lourde, mais au sens de la profondeur des interrogations. Seul celui qui a vécu assez peut aborder certaines questions. On ne peut pas sérieusement disserter de la mort à vingt ans. Cela reste un exercice de Normalien. Il faut avoir vu mourir autour de soi des êtres que nous aimions, les avoir vus souffrir et affronter l’inéluctable, pour se colleter avec elle. Le grand « Pourquoi ? » est La Question des questions. Peu à peu Michel Onfray attaque cette énigme, à sa manière. Celle-ci vaut toute notre attention et notre estime.
Les Bordes (Creuse) – Jean-Michel Dauriac – 1er janvier 2020 .
Leave a Comment