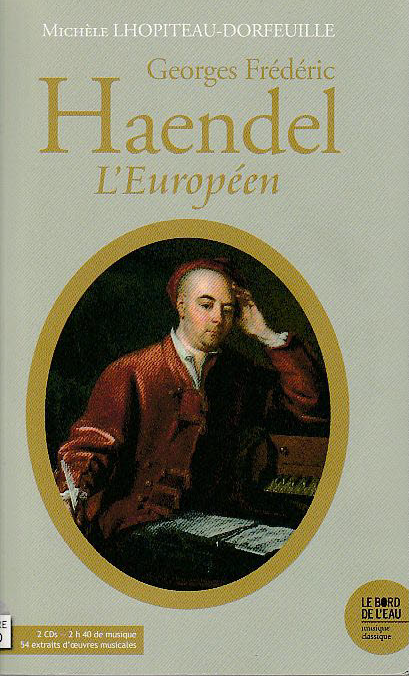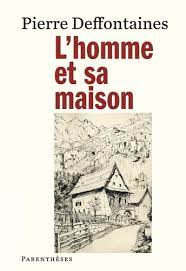Voici le cinquième opus de l’auteur consacré à un des grands maîtres de la musique occidentale, dite « classique ». Après Mozart, Bach, Beethoven et Schubert, c’est donc Haendel qui est l’objet de l’attention de cette musicologue épanouie.
Michèle Lhopiteau a créé un genre d’ouvrage, dont elle maîtrise maintenant parfaitement la construction. Ce qu’elle écrit ne relève pas de la biographie, genre dans lequel le résultat est souvent des énormes pavés exhaustifs et lassants que ne peuvent achever que des mordus ou des clients sous prescription, c’est-à-dire des étudiants. Ce n’est pas non plus une étude savante, musicologique au sens universitaire du terme, genre qui brille souvent par ses termes techniques abscons et ses études pour « happy few ». Il faut donc user du terme « essai musical » pour être le plus clair possible. Le genre de l’essai laisse à son auteur une grande latitude, tant dans le choix de ses thèmes que dans la forme littéraire, et c’est bien ce qui convient à notre auteur (-e ou autrice ?). Je reviendrai ci-dessous sur le choix des thèmes. Quant à la forme, elle est un savoureux mélange de musicologie jamais pédante – ce qui est déjà un exploit -, de considérations biographiques et d’analyses musicales, sans oublier les anecdotes personnelles et les petits jugements personnels glissés au passage, comme ça, un peu incognito. Le tout donne des ouvrages faciles à lire, que l’on a envie de poursuivre et dont on se souvient avec plaisir. C’est le cas de cet opus, comme des précédents (dont j’ai assuré aussi des chroniques au temps de leur parution). Les chapitres sont bien dosés et de longueur raisonnable (à l’exception des deux gros morceaux sur les opéras et les oratorios). Bref, c’est d’une lecture aisée.
Un autre atout de ces ouvrages est la qualité du livre en lui-même : ce sont de beaux objets, bien réalisés, avec des polices de caractères qui facilitent la lecture et une vraie couverture assez rigide, avec rabats. Ces rabats protègent les deux CD qui accompagnent la lecture. On dispose ainsi de 54 extraits d’œuvres éclairant la lecture. C’est un atout absolument capital et c’est aussi ce qui justifie le prix élevé (33€) du livre. Il faut ajouter que, dans cette réalisation, l’éditeur et l’auteur ont intégré 48 Qrcodes, renvoyant l’heureux possesseur d’un smartphone Androïd ou d’un Iphone de Apple, vers des extraits disponibles sur internet – enfin, quand vous avez passé la pub inévitable ! -, preuve tangible de modernité. N’ayant pas un de ces merveilleux appareils[1] qui changent la vie et bousillent les oreilles et le cerveau à long terme, je ne puis rien dire de ces carrés magiques, mais ils sont là et fonctionnent, Alléluia ! Les deux CD fournissent à eux seuls suffisamment de références pour approcher la création haendélienne, d’autant plus que, comme pour chaque volume, le choix est très bien fait.
L’essai est un genre littéraire qui suppose deux faits liés entre eux. Il s’agit, d’abord, d’une tentative d’aborder un sujet sous un ou plusieurs angles qui ne prétendent pas couvrir l’ensemble du problème, mais obéir à ce que l’on nomme pompeusement une problématique. L’auteur est le seul maître à bord et nul ne peut lui reprocher ses choix. Ensuite, l’essai est subjectif, présente une thèse et la défend : ce n’est pas un ouvrage scientifique neutre, même si nombre d’essais sont devenus des références sur leur sujet. Le livre de Michèle Lhopiteau-Dorfeuille correspond parfaitement à cette définition.
Les angles d’attaque de ce Haendel l’Européen sont, à mon avis, au nombre de trois. Le premier, qui aura le dernier mot (la conclusion est faite sur cette idée démontrée), est contenu dans le titre : Haendel fut un musicien que l’on dirait cosmopolite pour son époque, voyageant et connaissant bien l’Europe occidentale, ce qui était rare en son temps. Le second angle de vue concerne sa vie de musicien : l’auteur veut prouver, et y parvient parfaitement selon moi, que Haendel n’a pas été du tout ce musicien « de cour » que l’on décrit généralement. Il fut toute sa vie un créateur indépendant, même s’il était très apprécié de la cour de Londres et qu’il composa de nombreuses œuvres pour des événements royaux. Le troisième et dernier point de vue soutenu est celui de ses goûts musicaux. Pour l’auteur, la vraie passion de Haendel fut, toute sa vie, l’opéra italien. Et je dois dire que la démonstration est claire et indubitable. Et pourtant c’est la partie la moins connue de son œuvre et la moins jouée de nos jours, même si les nombreux opéras italiens qu’il a composés ont été exhumés depuis le milieu du XXe siècle.
A partir de ces trois points de vue, Michèle Lhopiteau tresse son travail, parfois en les mêlant tous, parfois en s’attachant à l’un ou l’autre. Les voyages et séjours à l’étranger de Haendel sont évoqués en début d’ouvrage, avec précision et posent ainsi l’importance de l’Italie, où il séjourné quatre années et composé de nombreuses œuvres pour le public de ce pays. Il en gardera donc toute sa vie la passion de cette musique d’opéra et la mettra en œuvre tant que cela sera possible, même s’il n’a pu éviter son déclin et passer alors à la composition d’ouvrages anglais – langue qu’il parla toute sa vie avec un fort accent teuton – et d’oratorios. L’auteur établit bien la chronologie des compositions qui font apparaître des périodisations nettes dans la vie du compositeur. Haendel, qui demanda et obtint la nationalité anglaise à la moitié de son existence environ, resta pourtant fondamentalement un saxon. Cela ne l’empêcha pas de prendre très glorieusement la succession de Purcell, sans aucun titre officiel, comme grand compositeur des souverains. Mais cette tâche ne le rendit jamais dépendant de la Cour et c’est avec ses autres compositions qu’il gagna très confortablement sa vie. Il a cependant le très rare privilège d’être enterré à Westminster, près des puissants de ce royaume.
C’est, évidemment, l’analyse musicale et la thèse de l’auteur sur le tropisme opératique italien de Haendel qui est la plus originale. Il faut dire que ce n’est pas du tout l’image officielle de ce compositeur, identifié d’un côté à ses musiques officielles (Watermusic ou autres fêtes royales) et de l’autre au prodigieux oratorio Le Messie. Il aurait donc composé uniquement des musiques circonstancielles et des oeuvres chantées de type oratorio, principalement à base biblique. C’est évidemment très réducteur et le lecteur de cet ouvrage ne pourra plus du tout adhérer à ces clichés. Haendel a composé de la musique instrumentale variée, tant pour le clavecin, dont il était un joueur émérite, que pour des petites ou grosses formations, accordant une place importante aux vents. Il est l’inventeur du concerto pour orgue. On peut donc dire qu’il a touché, avec une égale réussite à tous les genres connus à son époque. Mais, selon Michèle Lhopiteau, sa vraie passion, depuis la jeunesse est l’opéra italien, qui régnait, au début du XVIIIe siècle sur l’Europe. Il aurait composé sa première œuvre de ce type à 18 ans, quand il était claveciniste à Hambourg. Son long séjour en Italie l’a amené à composer une belle série d’opéras sur des livrets en italien, dont certains écrits par des prélats de haut rang. Lorsqu’il quitta ce pays pour revenir en Allemagne puis s’établir à Londres, il garda cette passion et écrivit une collection pléthorique d’opéras italiens, chantés par des divas et chanteurs enrôlé à prix d’or pour venir en Angleterre. L’auteur en recense 42 de sa composition ! Ces œuvres connurent, pour la plupart, un grand succès public à Londres et firent sa fortune. Mais la mode passa et vers 1750 l’opéra italien cessa d’intéresser les Anglais. Haendel s’adapta, mais puisa dans ce corpus énorme d’airs et de chœurs pour les réemployer dans ses œuvres anglaises : ainsi Le Messie est une grand œuvre de recyclage des arias italiennes antérieures. Il faut souligner un des caractères forts que l’auteur dégage : la qualité extraordinaire de mélodiste de ce compositeur ! Sans en connaître les titres, nous connaissons en effet pas mal d’airs de sa plume que le cinéma ou la télévision, voire la publicité ont repris. De ce point de vue, les titres des deux CD sont exemplaires, et l’on se trouve plus d’une fois à chantonner ces airs qui nous reviennent.
Est-ce à dire que ce livre est parfait ? Eh bien, non ! Si l’ensemble nous conquiert et atteint son but, je ferai un reproche double. Les chapitres 6 et 10 sont trop longs et finissent par lasser même le lecteur bien disposé, comme moi. En fait, ces deux chapitres souffrent du même défaut pour la même raison. Le chapitre 6 est titré L’opéra italien : la passion de toute une vie et le chapitre 10 Les 18 oratorios de Georges Frédéric Haendel., soit les deux formes les plus aimés de Haendel. Michèle Lhopiteau a été victime à la fois de sa passion et de l’abondance de ses sources. C’est un risque permanent quand on fait de la recherche. Elle avait visiblement rassemblé une somme d’informations sur ces deux genres et s’est trouvée, au moment de la rédaction, dans l’impossibilité de faire des choix et d’éliminer des informations qui lui semblaient capitales. Mais l’accumulation linéaire de présentation de ces opéras et oratorios aboutit à une lassitude, car c’est toujours selon le même schème que cela s’effectue. Il s’agit donc d’un double problème : celui du tri des données et de la variation des présentations, les deux allant ensemble. Si elle avait éliminé certains opéras et s’était concentrée sur les plus marquants, on aurait évité la répétition à l’identique qui provoque l’ennui. D’autre part, je reste persuadé qu’il vaut toujours mieux une approche thématique qu’une approche linéaire chronologique. Il y avait quelques grands thèmes qui s’imposaient : le problème des chanteurs et chanteuses, les salles et structures où faire jouer ces opéras, le financement et les recettes, et enfin les oeuvres elles-mêmes, qu’on aurait pu évoquer sous quelques points communs, comme l’imbécilité des livrets et leur absurdité, la technique de Haendel (arias et chorus) et son art de la composition – et parfois de la reprise de travail d’autres compositeurs ! Une présentation sur cette base aurait été nettement plus dynamique. On pouvait adopter un plan du même type pour les oratorios, dont la présentation souffre du même défaut que les opéras italiens. On aurait par contre bien apprécié une liste des opéras italiens et des oratorios dans les annexes. C’est ici le seul reproche majeur que j’ai à faire sur ce livre. En cas de réédition, je ne peux que conseiller à l’auteur de reprendre ces deux chapitres. Elle sait parfaitement faire cela, car elle a mis en œuvre cette démarche dans son chapitre 11 où elle compare Bach et Haendel.
Ce cinquième volume est donc une belle réussite et vient augmenter une collection de grande qualité qui mérite d’être dans la bibliothèque de tout mélomane ou de tout individu curieux.
Jean-Michel Dauriac – mars 2022
[1] Je suis resté au Blackberry avec son clavier physique et sa 3G+, c’est dire mon archaïsme coupable !
Leave a Comment