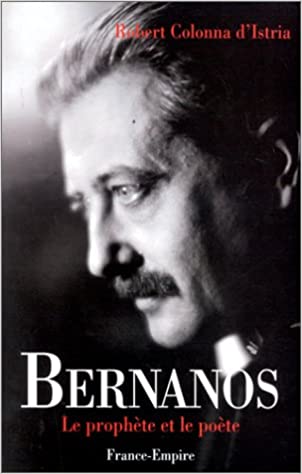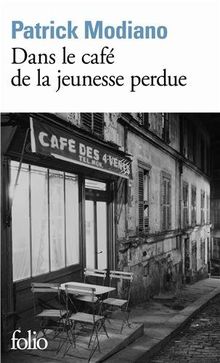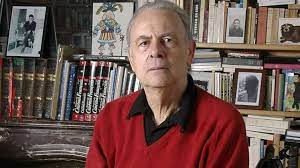Robert Colonna d’Istria
Editions France-Empire, 1998 – 195 pages
Georges Bernanos (1888-1948) reste bien méconnu aujourd’hui. S’il fut une grande voix, consultée même par De Gaulle après la Libération, il a été recouvert par la masse des publications survenue depuis sa disparition, en 1948. Il serait injuste de dire qu’il est tombé dans l’oubli, mais il n’est vraiment connu que dans certains milieux, comme les catholiques un peu rebelles ou les milieux politiques de la marge (aussi bien les anarchistes que la droite dure – ceci à cause de son monarchisme jamais renié). Il présente le cas, assez rare, d’un écrivain venu tard à la fiction, en 1926, à 38 ans, ce qui est canonique en littérature où il n’est de vrai talent que jeune, selon le petit milieu germanopratin. Et qui n’a écrit qu’une petite dizaine d’œuvre dites « romanesques ». Son premier livre, Sous le soleil de Satan est un véritable coup de tonnerre éditorial, la naissance d’un monolithe de l’écriture. On peut dire, sans forcer la note, qu’il est avec Céline et son Voyage au bout de la nuit, paru en 1932, un des rénovateurs du style du XXe siècle. Style âpre, rugueux, souvent à la limite de la lourdeur, un style de cogneur, illuminé de clairières poétiques, un style imagé qui arrache l’adhésion par sa puissance et sa persévérance au combat. Je renvoie le lecteur à mes critiques sur certains de ses ouvrages, notamment Journal d’un curé de campagne. Mais, à côté d’une œuvre littéraire qui divise, Bernanos est un formidable essayiste et un pamphlétaire inspiré, à la voix souvent prophétique. Ses écrits non-fictionnels sont rassemblés en deux forts volumes de la Pléiade. On y trouve aussi bien ses livres engagés, comme Les grands cimetières sous la lune ou La France contre les robots, que d’innombrables articles de presse. On y entend souvent une voix qui a eu raison trop tôt, ce qui est le propre des prophètes (confer Jacques Ellul ou André Gorz). Ce qui nous ramène au livre présenté ici.
Robert Colonna d’Istria (né en 1956) est, avant tout, un auteur corse qui écrit sur la Corse. Ce Bernanos est donc une sorte d’exception dans sa production. J’y vois, en reprenant la belle expression d’Emil Cioran, un « exercice d’admiration ». Le néophyte y apprendra l’essentiel de ce qu’un honnête homme (cela a-t-il encore un sens d’employer cette expression que bientôt plus personne ne comprendra ?) doit savoir sur ce grand auteur polémiste. Il a choisi le plan chronologique, qui est le plus facile à réaliser et le plus aisé à suivre pour les lecteurs, mais qui manque de profondeur et amène, forcément, à des répétitions ou à des omissions. Mais c’est déjà une critique formaliste d’intellectuel universitaire !
Dès le début, il pose son cadre, l’admiration :
« Je n’oublierai jamais mon émotion à la lecture du Journal d’un curé de campagne. Je me rappelle à quel point ce livre m’a bouleversé. » p. 9
Je serais mal venu de reprocher cela à l’auteur, tant j’ai d’admiration pour ce roman, sans doute le plus grand de Bernanos. C’est donc le point de départ de ce travail sur l’auteur. Qui est-il pour lui ? Il donne un élément de réponse un peu plus loin dans son chapitre introductif :
« Cassandre moustachu ? Ezéchiel ? Ou, respectueusement, Antigone ? Peu importe, le monde moderne a été regardé par un homme qui avait conservé une simplicité enfantine et qui avait une foi absolue. » p. 18.
Cette courte citation contient les trois thèmes qui seront tressés par Colonna d’Istria dans son livre : le prophétisme, l’esprit d’enfance et le monde moderne. Le tout sous-tendu (on devrait d’ailleurs dire ici sur-tendu) par « une foi absolue ».
Car, nul ne comprendra Bernanos, l’homme et l’œuvre, s’il n’accepte que son moteur soit la foi chrétienne. Les débuts du livre sont consacrés à l’enfance et la jeunesse de Bernanos, années fondatrices qui le construisirent. Elles sont d’une belle qualité synthétique. L’enfance reconnue et gardée, c’est celle de l’Artois, dans le village de Fressin, la connaissance du milieu des paysans et de la nature rude de ce pays. On sait que l’on retrouvera ce décor dans les deux chefs d’œuvre de Bernanos : Sous le soleil de Satan, où la campagne et le climat sont des personnages à part entière de la lutte spirituelle de l’abbé Donissan, et Journal d’un curé de campagne, où les quelques mois de ministère du jeune curé sont vécus dans ce milieu humide et froid, au milieu de paysans à demi païens. La formation spirituelle est celle d’un catholique élevé dans une famille bourgeoise. Il a toujours eu la foi et n’a jamais eu besoin d’une crise existentielle pour la trouver.
« Dire de Georges Bernanos qu’il était un croyant, qu’il avait la foi, qu’il a été profondément chrétien, dire que ces attitudes-là ne l’ont jamais quitté, de son adolescence à la fin de sa vie, c’est, bien évidemment, dire l’essentiel de ce qu’il a été. » p. 40.
Voilà donc posé la plus importante clé pour comprendre la vie et l’œuvre de G. Bernanos. Mais ce christianisme n’est pas du tout prisonnier d’une religion et de ses dogmes. Il met en avant la vie et sa vérité à l’épreuve du quotidien. Il écrit, par exemple, cette phrase sans appel :
« Je n’éprouve aucune gêne à déclarer qu’un ouvrier communiste de bonne foi, prêt à se sacrifier pour une cause qu’il croit juste, est infiniment plus près du Royaume de Dieu que les bourgeois du siècle dernier qui faisaient travailler douze heures par jour, dans leurs usines, des enfants de Dix ans. » (Nous autres Français) p. 57.
C’est cette honnêteté qui le fera apprécier même par des gens qui ne sont pas de son bord. Oui, Bernanos a été un disciple de Maurras, séduit par ses idées sur la France, comme des millions de jeunes en France. Serait-ce plus infamant que d’avoir idolâtrie Staline comme un phare de la pensée humaine, ou d’avoir fait de Mao Zedong un prophète sans égal ? Pour moi, nullement. D’autant plus qu’il a rompu avec Maurras quand l’Eglise l’a condamné. Mais il est toujours resté monarchiste, par une sorte de fidélité à son histoire. Tout en sachant qu’il n’avait aucune chance de voir la monarchie revenir sur le sol de France. Une autre de ses fondations est son expérience de la guerre de 14. Colonna d’Istria écrit :
« On ne simplifie pas beaucoup en écrivant que la guerre de 14 est à la base de toute l’oeuvre de Bernanos Certes aucun livre n’est, à proprement parler, consacré à cette guerre […], mais la guerre est à la base de l’œuvre de Bernanos en ceci qu’il y a été en contact avec un absolu, dans le malheur, dans la souffrance, dans la misère, le sacrifice et que c’est à l’aune de cet absolu, pendant le reste de sa vie qu’il va regarder le monde, sans comprendre que la vie puisse continuer comme si cet absolu n’existait pas. » p. 65.
La guerre, donc, vient s’ajouter à l’esprit d’enfance comme matrice de toute la pensée de Bernanos. Ces deux sources l’amènent à sonder le climat spirituel de son temps et en percevoir le vide. Car c’est là son combat principal : la défaite de l’esprit dans ce monde moderne. Il ne cessera de pourfendre cette pauvreté spirituelle, jusqu’à la fin de sa vie. Il attribua d’ailleurs la défaite française et l’arrivée du pétainisme et de la collaboration comme un fruit de ce dessèchement spirituel. Il rejoint là l’analyse de Marc Bloch dans L’étrange défaite.
« Ce qui marque Bernanos, c’est l’incroyable vide de l’après-guerre, vide spirituel, moral et même, en dépit de l’agitation superficielle qu’on pouvait observer, vide intellectuel. » p. 81.
Il ne changera pas d’avis au fil des ans. Les textes écrits au Brésil durant ses années d’exil volontaires ont été regroupés sous un titre évocateur : La révolte de l’esprit – Ecrits de combat (1938-1945). Sa plume aura combattu jusqu’au bout contre la montée de l’insignifiance et du matérialisme consumériste dont il a parfaitement anticipé la venue.
La deuxième partie est une analyse des grandes œuvres, de leur contexte, de leur réception et e la vie de l’auteur dans ces moments. Je ne développerai pas cet aspect, qu’il vaut mieux laisser découvrir au lecteur. Colonna d’Istria ne cache pas la difficulté d’accès de certains textes, comme les trois derniers romans publiés. Il souligne également la bataille politique de Bernanos, pour que la France relève la tête après l’humiliante parenthèse des années 1940-44. Mais, au fond, il ne croit guère à un renouveau de ce côté-là, même s’il a de l’estime pour le général de Gaulle et son amour profond de la France. Seule une renaissance spirituelle chrétienne peut rendre à la France son âme. De 1945 à sa mort en 1948 il continue donc à crier dans le désert, souvent incompris et raillé, d’autant plus que le communisme offre une espérance de substitution et que Moscou devient une seconde Rome pour les intellectuels français. Il achève sa vie dans une certaine solitude d’idées.
Ce livre est une bonne introduction à la pensée et à l’œuvre de Bernanos, même si je continue à penser qu’un plan thématique eût mieux servi la cause bernanosienne, même en conservant une première partie biographique et chronologique. Il n’a pas été réédité en collection de poche, mais se trouve encore en neuf et beaucoup en occasion, sur le net. Si vous ne connaissez pas Bernanos, il faut le lire, car sa lecture est aisée et sa démarche synthétique sans être squelettique.
Jean-Michel Dauriac – novembre 2022.
Leave a Comment