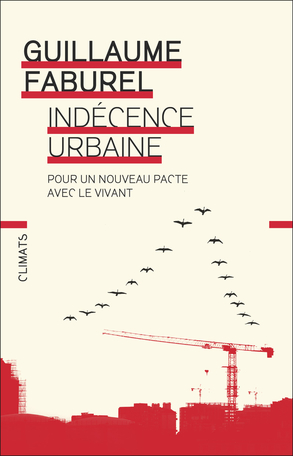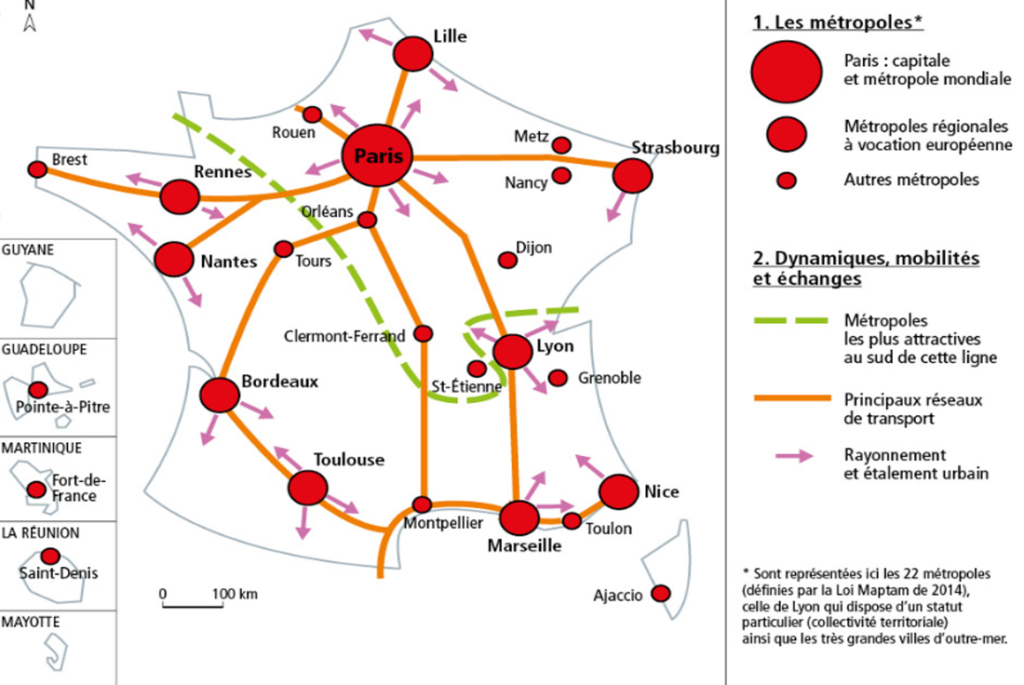Ma Roumanie communiste
Catherine Durandin, Paris, L’Harmattan, 2023.
Catherine Durandin est un nom que tout lecteur curieux ou tout chercheur ou étudiant s’intéressant à la Roumanie contemporaine connaît, car elle est l’une des meilleures spécialistes françaises de ce pays et y a consacré une bonne partie de sa carrière de chercheuse[1]. Historienne de formation, elle a écrit des ouvrages d’histoire de ce pays qui ont été salués en leur temps pour leur rigueur. Elle a également écrit de nombreux articles pour des revues[2]. C’est donc un auteur expérimenté et une personne savante en la matière. Ce livre ne fait d ‘ailleurs que confirmer ces affirmations.
Je dois, avant de parler du livre lui-même énoncer deux faits qui me semblent importants :
D’abord, je dois préciser que je connais assez bien la Roumanie, certes bien moins que madame Durandin, mais beaucoup plus que beaucoup de gens qui en parlent ou en font un sujet de cours. Comme elle, j’ai séjourné à de nombreuses reprises dans ce pays et m’y suis fait des amis fidèles. Comme elle, j’ai appris la langue roumaine, afin de pouvoir converser avec les habitants et lire dans les publications du pays. Comme elle, j’ai une formation universitaire qui m’a donné des outils d’analyse précieux pour avoir du recul sur le pays et ses habitants. Mais ma connaissance vécue débute juste après la chute de Ceaucescu. Elle, c’est l’histoire, et moi, la géographie. J’ai donc beaucoup apprécié son livre, comme je vais le montrer plus bas, d’autant plus que ce n’est nullement un ouvrage universitaire, mais bien plutôt un retour d’expériences et un album de famille.
Ensuite, je me dois de dire que la lecture de ce livre, pour être plaisante, doit s‘appuyer sur une réelle connaissance de l’histoire récente de la Roumanie et de sa formation en tant que nation et Etat. Faute d’avoir un solide bagage en la matière, le lecteur ne percevra pas l’intégralité de la réflexion ou ne pourra pas la contextualiser. C’est exactement la même chose que pour lire les mémoires des dissidents soviétiques. C’est donc plutôt, par son sujet et son positionnement, un ouvrage pour initiés.
Catherine Durandin, historienne, spécialiste de la Roumanie contemporaine
Le récit couvre une période d’une cinquantaine d’années, de la fin des années 1960 à 2016. Celle qui va pour la première fois en Roumanie en 1967 est une jeune étudiante naïve ; celle qui conclut l’ouvrage en 2016 est une professeure d’Université chevronnée au seuil de la retraite. C’est donc la mémoire de toute sa vie intellectuelle et professionnelle qui est ici rassemblée, sur le thème de ce pays. Il faut bien garder le titre choisi à l’esprit, Ma Roumanie communiste ; c’est cet angle-là qui arme toute la problématique du récit. C’est une histoire subjective vécue de la Roumanie de Ceaucescu aux crises actuelles de gouvernance. L’auteure a choisi, et elle a eu raison, de ne pas livrer un ouvrage de type universitaire, mais de revendiquer son expérience et de parler à la si redoutée première personne, que les universitaires refoulent toujours au nom de l’objectivité « scientifique », qui est une escroquerie dans les sciences dites humaines. On apprécie vraiment qu’il y ait une incarnation des sujets abordés. Ce qui n’empêche pas Catherine Durandin d’écrire en historienne et de sourcer toutes ses références. Le livre allie donc la rigueur méthodique nécessaire et l’engagement personnel.
Je n’ai pas l’intention de résumer le contenu de ce livre, qui est dense et complexe parfois. Il faut le lire, lentement, pour l’assimiler. Je voudrais plutôt donner des éléments d’analyse et de critique.
L’auteure nous montre, au cours de sa relation écrite, que sa perception du pays et des habitants a beaucoup évolué. La jeune fille qui va à Sinaïa en stage d’été, en 1967, n’est pas équipée pour saisir le contexte national du pays. Elle est saisie par l’attrait de cette nation, par sa langue, sa culture et le dépaysement qui en découle. Il lui faudra bien des années pour interpréter ce qu’elle a alors vécu. De même, lorsqu’elle retourne en Roumanie pour des recherches liées à sa thèse, elle est trop impliquée dans son travail pour bien appréhender le réel. Mais déjà elle découvre les failles derrière le décor. Il lui faudra avoir affaire aux services secrets du pays pour comprendre la paranoïa roumaine ; elle décide alors de ne pas revenir dans le pays. Si je me souviens bien, cela se produit tout à fait à la fin des années 1970. Pourquoi cette décision ? Parce qu’elle a été approchée par des barbouzes du régime, dans le but de lui faire comprendre qu’elle est surveillée. Elle a donc peur pour elle et les siens. Elle décide de poursuivre son travail sur la Roumanie, mais depuis la France. Elle ne reviendra dans le pays qu’après la chute du régime communiste.
Qu’a-t-elle découvert qui pourrait gêner le régime ? A dire vrai, rien d’important. Elle a simplement, avec le temps, vu les écailles tomber de ses yeux et compris que tout était très compliqué dans ce pays. A commencer par la notion d’amitié. Ce qui est très paradoxal, car il est très facile de se faire des amis quand on est Français, en Roumanie. Le pays jouissait jusqu’à ces dernières années d’une grosse côte d’amour, et nous étions particulièrement bien accueillis. Ceci étant renforcé par le grand nombre de locuteurs de notre langue, la maniant de fort belle manière. Mais ce que Catherine Durandin va apprendre avec le temps (et que j’ai aussi appris de la même manière), c’est que, dans ces années Ceaucescu, on ne sait jamais qui est en face de nous. Est-ce la jeune fille roumaine complice, le professeur sympathique ou la famille d’accueil chaleureuse, ou bien ai-je affaire à des agents de renseignements des services de la Sécuritate, véritable état dans l’Etat. Suis-je en train de parler à cœur ouvert avec une collègue cultivée et critique ou à un membre du Parti soucieux de ne pas avoir d‘ennui ? Ces questions, qui n’apparaissent que lorsque le système devient compréhensible, finissent par rendre très méfiant, voire paranoïaque, et installent des rapports troubles. Même après la chute du communisme, les vieux réseaux sont restés en place et les mentalités ont mis beaucoup de temps à évoluer.
A cette ambiguïté de la relation s’ajoute la découverte des opinions parfois choquantes de ceux que l’on estimait être des amis, et donc partager des valeurs communes. C’est le vieux fond d’antisémitisme, refaisant surface inopinément. C’est le racisme brutal et revendiqué envers les Tziganes ou les hommes de couleur. C’est la revendication pensée comme légitime d’une dette de l’occident envers la Roumanie, au nom de sa souffrance sous le communisme et l’abandon présumé des Occidentaux. Ceci pour ne prendre que quelques exemples courants. Le cadre mental communiste a perduré dans les têtes bien après la chute du régime des Ceaucescu. L’Eglise orthodoxe considère, de son côté, que les pays de l’Ouest ont trahi la vraie foi chrétienne et se vautrent dans le stupre et le lucre. Il faudra que disparaisse la génération qui a vécu et étudié sous Ceaucescu pour que la Roumanie devienne vraiment un pays libéré. Cela ne veut nullement dire qu’elle doit tomber dans les défauts et travers que nous vivons en ce moment. Mais elle doit repenser sa place en Europe, sans chercher des responsables à sa situation.
Tout cela fait qu’il est difficile, dans les années que narre C. Durandin, d’avoir de vrais amis, sincères et non inféodés au régime. Elle raconte plusieurs de ses déconvenues, mais aussi quelques belles amitiés durables. Cependant, il est clair que cet état de fait a été douloureux pour elle, et que ce livre est aussi une catharsis en ce domaine.
A cette possible duplicité des rapports humains se superpose la duplicité politique du régime de N. Ceaucescu. Catherine Durandin établit très bien, progressivement au cours de son livre, le fait que le régime de N. Ceaucescu était la continuité du précédent et qu’il était tout à fait orthodoxe en termes de marxisme. C’est la forme que lui a donnée Ceaucescu qui a pu laisser croire le contraire. Mais s’est surtout le désir des pays occidentaux de voir dans ce dirigeant et son régime un opposant à Moscou, et une possibilité donc d’affaiblir le bloc soviétique. Le Conducator a su habilement manœuvrer pour installer cette croyance et l’entretenir par des gestes symboliques. Ensuite, les Occidentaux ne voyaient plus que ce qu’ils voulaient voir. L’auteure décrit le fonctionnement réel du pays, qui n’a rien à envier à la RDA, qui à la même époque, était taxée de fidèle laquais soviétique par les Occidentaux. L’aveuglement français a donc été grand. Et le réveil fut tardif, provoqué seulement par la mégalomanie du couple et les frasques d’Elena, et les révélations de certains dissidents réfugiés en France. Le désamour fut d’ailleurs à l’échelle de l’illusion précédente.
Tout cela établit donc le portrait d’un pays qui a manié la duplicité politique et l’a instillé dans la vie quotidienne de ses habitants, à tel point qu’il était difficile de savoir ce qu’ils pensaient réellement. On sent bien que là se trouve une blessure intime de l’auteure, qui s’est sentie trahie par certains de ceux qu’elle croyait être ses amis. La période des 30 dernières années, qui clôt rapidement le livre, montre comment les hiérarques du régime et les cadres de tous niveaux se sont très vite reconvertis au capitalisme et à ce qu’ils croyaient être la démocratie. Comme C. Durandin, j’ai croisé d’ anciens directeurs communistes de fermes d’Etat ou d’usines, qui avaient racheté pour rien l’outil de travail, parfois en ayant saboté eux-mêmes les machines, pour justifier de ce rachat dérisoire. Cela a existé à tous les niveaux. J’ai connu un ancien professeur de marxisme qui est devenu, après la Révolution, professeur de religion ! Un des vestiges les plus tristes de la période communiste est la prévalence de la corruption, présente à tous les étages de la société. Je l’ai vue en action lors de mes années de travail humanitaire et de solidarité. Tout témoigne du fait qu’elle est encore très présente, malgré la lutte acharnée de certains acteurs roumains (comme la procureure Laura Kövesi)
Le portrait que dresse Catherine Durandin de la Roumanie communiste est tout à fait vrai. Elle a acquis une très grande expérience de ce pays et son témoignage est précieux. Pour clore sur la forme, je dirais que j’ai été surpris des grands contrastes de qualité de l’écriture. L’essentiel est écrit dans un style serré et tout à fait correct. Mais par endroits, certaines pages apparaissent comme des brouillons ou des ébauches non relues. Cela vient nuire à la cohésion du livre, c’est bien dommage.
Cette restriction étant exprimée, je recommande la lecture de ce livre, en réitérant les précautions initiales.
Jean-Michel Dauriac – Les Bordes, septembre 2023.
[1] Pour plus de renseignements consulter les sites suivants : https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_Durandin, pour des indications biographiques et une liste d’œuvres ; https://data.bnf.fr/fr/12105197/catherine_durandin/ pour la bibliographie.
[2] Voir, par exemple Diploweb : https://www.diploweb.com/_Catherine-DURANDIN_.html
Leave a Comment