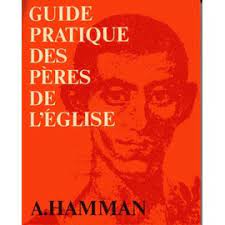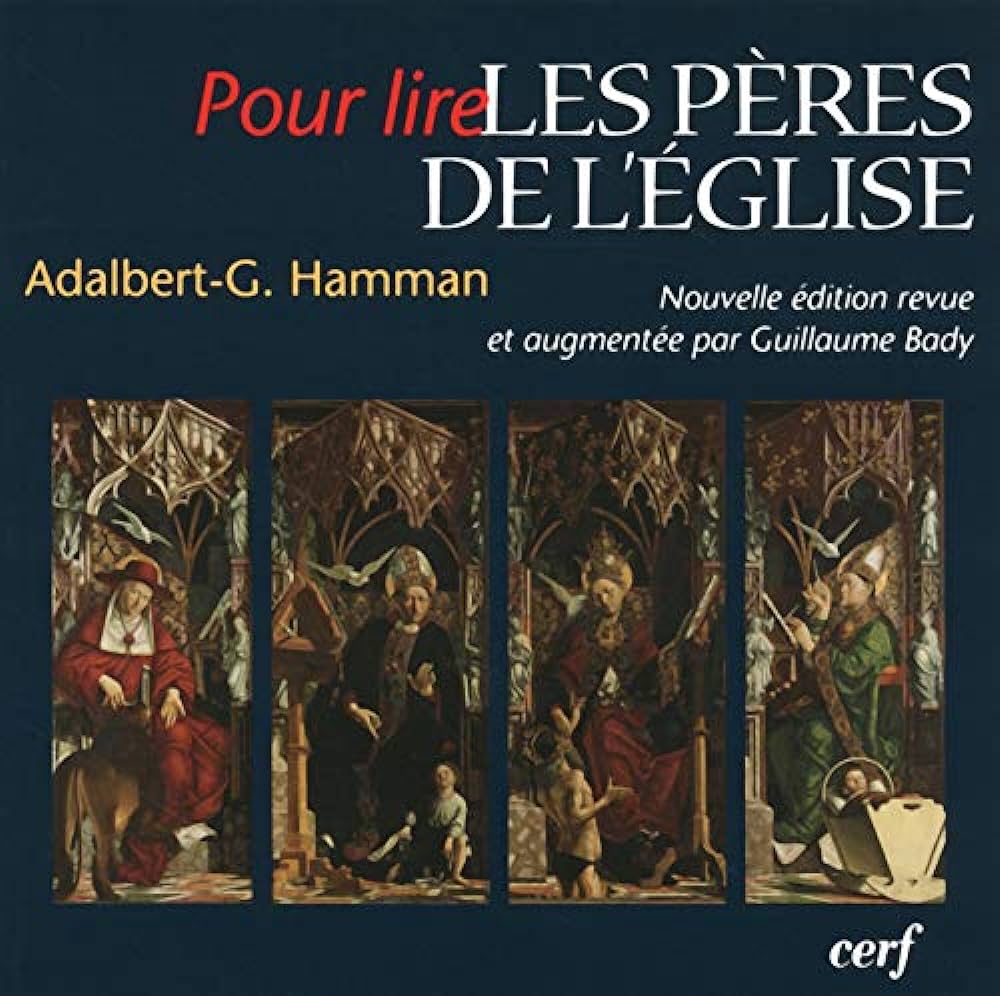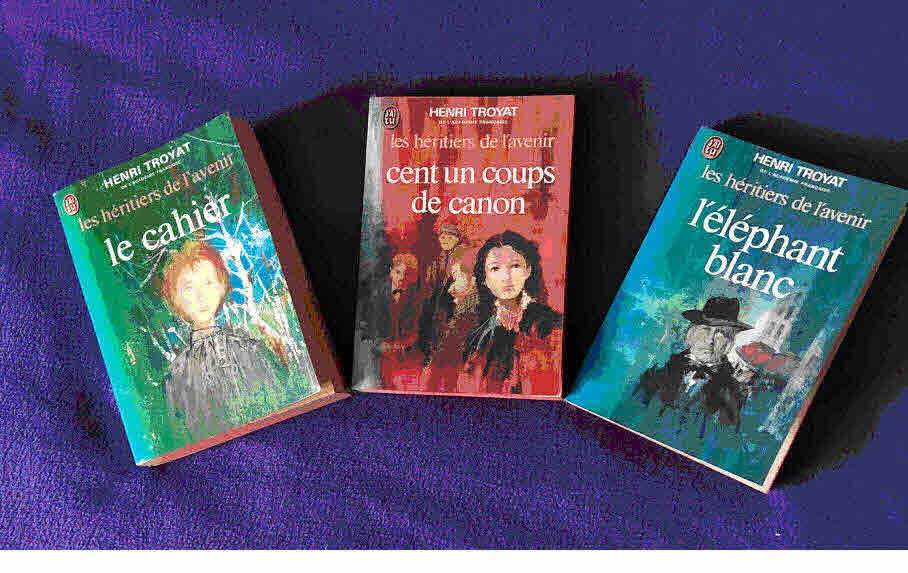Adalbert Hamman – Desclée de Brouwer, 1967 – 335 pages
Voici un livre ancien que je recommande vivement, qui se trouve facilement d’occasion sur internet et qui se lit vraiment très aisément.
La connaissance des Pères de l’Eglise est affaire de théologiens et d’historiens, me direz-vous. Et catholiques de surcroît. C’est effectivement la réalité pratique d’aujourd’hui. Ce que l’on nomme la patristique ou patrologie est une spécialité universitaire dont se tiennent éloignés les chrétiens, dont la plupart ignorent même l’existence et le nom. Or, ces textes sont ceux qui constituent, dans le sein de l’Eglise catholique romaine, la Tradition, source dogmatique de même importance que les saintes Ecritures. On comprend donc qu’ils soient décisifs pour cette Eglise et son histoire doctrinale. Evidemment, les protestants rejettent la Tradition comme écriture inspirée, et en restent au Sola Scriptura, une seule Ecriture, la Bible. Dans la pratique, la Faculté de théologie protestante de Strasbourg comporte un département et une revue de patristique. Car on ne peut ignorer ces écrits, souvent seules sources de renseignements sur l’Eglise des premiers siècles. Mais dans le cycle complet d’études théologiques, il n’y a aucun enseignement spécifique consacrés aux Pères de l’Eglise. Ils sont approchés par le biais de l’histoire de l’Eglise ou par la dogmatique. Ce qui laisse la plupart des diplômés (et donc des futurs pasteurs ) ignorants de ce patrimoine.
C’est pourquoi je me permets de conseiller absolument la lecture de cet ouvrage, et particulièrement à mes lecteurs protestants. Il s’agit d’une belle introduction à la patrologie, et un excellent éclairage sur une certaine histoire de l’Eglise des premiers siècles.
Les Pères de l’Eglise sont des auteurs que le pape Jean-Paul II a appelé ceux « qui, par la force de leur foi, par l’élévation et la fécondité de leur doctrine ont donné à l’Église une vigueur nouvelle et un nouvel essor. Ils sont vraiment les ‘Pères’ de l’Église car c’est d’eux, par l’Évangile, qu’elle a reçu la vie. Ils sont également les bâtisseurs puisque, sur la base de l’unique fondement posé par les apôtres, (……) ils ont édifié les premières structures de l’Église de Dieu. » L’Eglise n’en a pas dressé une liste définitive, mais il s’agit plutôt d’un consensus sur le temps long. Il existe des différences selon l’Eglise catholique ou orthodoxe. Je joins en fin de cette article une liste chronologique emprunté à l’article de Wikipédia, « Pères de l’Eglise ».
L’ouvrage du père Hamman est la présentation d’une sélection des Pères les plus importants et les plus incontestables. Il a ainsi choisi vingt auteurs, répartis du IIe au Ve siècle. La méthode est d’offrir une présentation standardisée comprenant l’étude du contexte historique et religieux, la vie de l’homme, puis son œuvre. Chaque présentation se clôt par un texte de cet auteur, occasion de découvrir le style et la pensée. Chaque chapitre ouvre par une représentation iconographique du personnage et se termine par l’extrait choisi. De nombreuses illustrations sont réparties au fil des pages, en noir et blanc, pour l’essentiel des reproductions d’oeuvres d’art. Le résultat est médiocre, car la résolution des reproductions est faible et les contrastes d’impression mauvais. C’est le mauvais point de ce livre. Pour le reste, il est très bien fait, écrit dans un style alerte, facile à lire et n’abusant pas des termes théologiques abscons qui pourraient désorienter le lecteur lambda. L’auteur a une grande érudition en la matière, c’est très sensible à la lecture. Il a aussi une belle objectivité, notamment quand il décrit le caractère ou le comportement de ces hommes. Il ne se livre pas à un travail hagiographique, mais essaie de rester dans l’humanité de ces auteurs.
Ce livre atteint parfaitement son but. Il donne envie de mieux connaître certains Pères et apporte de bonnes connaissances de base. L’anthologie de textes est également précieuse, car elle aborde des sujets divers et précise certaines pratiques ou croyances de l’Eglise primitive.
Pour toutes ces raisons, je recommande vivement la lecture ce livre, qui peut se lire dans le désordre, auteur par auteur. Il deviendra une référence de la bibliothèque chrétienne de base.
Annexe : liste des Pères de l’Eglise : source : https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8res_de_l%27%C3%89glise
Les Pères présentés dans le livre sont en caractères gras dans la liste ci-dessous.
Les Pères anténicéens (jusqu’en 325)
Articles détaillés : Patristique et Premier concile de Nicée.
Les Pères apostoliques
- · l’auteur de la Didachè (ier siècle)
- · Clément de Rome (mort en 101)
- · Ignace d’Antioche (mort entre 105 et 135)
- · l’auteur de l’Épître de Barnabé (vers 130/132)
- · Hermas, auteur du Pasteur (entre 130 et 140)
- · Papias d’Hiérapolis (mort v. 140)
- · Polycarpe de Smyrne (mort entre 155 et 167)
Les Pères du iie siècle
Les apologètes
- · Aristide d’Athènes (né v. 130/140)
- · Justin de Naplouse (mort en 165)
- · Athénagoras d’Athènes (né v. 180)
- · Tatien le Syrien – Disciple de Justin (av. 155 – ap. 172)
- · Méliton de Sardes (né v. 160/170)
- · Théophile d’Antioche (né v. 180)
- · l’auteur de l’Épître à Diognète (entre 140 et 200)
La littérature anti-hérétique
- · Irénée de Lyon – Docteur de l’Église, évêque de Lyon (v. 120 – 208)
- · Hippolyte de Rome (v. 170 – v. 235)
Les Pères du iiie siècle
Pères grecs
- · Origène (185 – 254) (n’a pas fait l’objet du consensus ecclésiastique)
- · Clément d’Alexandrie (vers 150 – vers 220)
- · Denys d’Alexandrie (mort en 264/265)
- · Pierre d’Alexandrie (mort en 311)
- · Méthode d’Olympe
Pères latins
- · Tertullien (vers 155 – après 220) (n’a pas fait l’objet du consensus ecclésiastique)
- · Minucius Félix (né vers 200)
- · Cyprien de Carthage (vers 200 – 258) ; saint fêté le 16 septembre
- · Lactance (vers 260 – vers 325), appelé aussi le Cicéron chrétien.
L’âge patristique (325-451)
Pères opposés à l’arianisme
Article connexe : Arianisme.
- · Eustathe d’Antioche (230 – 327 ou 330)
- · Cyrille de Jérusalem – Docteur de l’Église (mort en 387)
- · Alexandre d’Alexandrie (mort en 328)
- · Athanase d’Alexandrie – Docteur de l’Église (v. 296 – 373)
- · Didyme l’Aveugle (313 – 398)
- · Hilaire de Poitiers (315 – 367)
- · Marius Victorinus (mort apr. 362)
- · Ambroise de Milan – Docteur de l’Église (339 – 394)
Pères cappadociens et Jean Chrysostome
- · Basile de Césarée ou Basile le Grand – Docteur de l’Église (330 – 379)
- · Grégoire de Nazianze le Théologien – Docteur de l’Église (329 – 390)
- · Grégoire de Nysse le Mystique (335 – 394)
- · Jean Chrysostome – Docteur de l’Église, patriarche de Constantinople (345 – 407)
Autres pères : 2e, 3e et 4e conciles (ve siècle)
Pères grecs
- · Cyrille d’Alexandrie – Docteur de l’Église, le « sceau des Pères » (v. 380 – 444)
- · Épiphane de Salamine (mort en 403), répertoire des hérésies.
Pères latins
- · Jérôme de Stridon – Docteur de l’Église (v. 347 – 420)
- · Ambroise de Milan, Docteur de l’Église, évêque (v. 340 – 397)
- · Augustin d’Hippone – Docteur de l’Église, évêque (354 – 430)
- · Léon le Grand – ( mort en 461)
Pères syriens
- · Éphrem le Syriaque, docteur de l’église (mort en 379),
- · Diodore de Tarse (mort av. 394)
- · Théodoret de Cyr (mort v. 466)
Les Pères de tradition chalcédonienne (après 451)
Pères grecs antérieurs à la crise iconoclaste
- · le Pseudo-Denys l’Aréopagite (fin ve siècle).
- · Sophrone de Jérusalem (mort en 644), patriarche.
- · Maxime le Confesseur – moine byzantin, théologien mystique (v. 580 – 662).
Pères grecs défenseurs des saintes images
- · Germain Ier de Constantinople (mort en 740).
- · Jean Damascène (v. 675 – 749), Docteur de l’Église.
- · Théodore Studite (mort en 826).
Pères latins
- · Eucher de Lyon (mort en 449/455 ?)
- · Boèce – le Philosophe (480 – 524)
- · * Grégoire le Grand – pape et Docteur de l’Église (v. 540 – 604)
- · Isidore de Séville – Docteur de l’Église (v. 560 – 636)
Pères propres à une seule confession
Pères propres à l’Église orthodoxe
- · Photios Ier de Constantinople (mort en 891).
- · Théophylacte d’Ohrid (xiie siècle)
- · Grégoire Palamas (xive siècle).
- · Marc d’Éphèse (xve siècle).
Pères propres aux Églises non chalcédoniennes
- · Sévère d’Antioche (456 – 538)
- · Jacques de Saroug (vers 450 – vers 521)
- · Jacques d’Édesse (vers 633 – 708)
Pères propres à l’Église de l’Orient
- · Théodore de Mopsueste (mort en 428)
- · Narsaï (av. 437 – 503)
Jean-Michel Dauriac – Décembre 2023
Leave a Comment