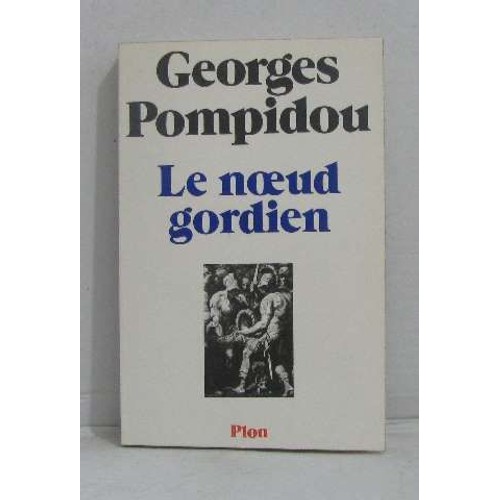L’Église ignorée ou Le pèlerinage douloureux de l’Église fidèle à travers les âges[1].
E. H . Broadbent – Nyon (Suisse) éditions Je sème, 1955.
Je voudrais vous entretenir d’un ouvrage ancien, écrit il y a plus d’un siècle, dont la démarche et le contenu méritent d’être présentés au lectorat d’aujourd’hui. En effet il s’agit là d’un ouvrage qui va véritablement à contre-courant des histoires classiques de l’Église. D’où le titre choisi, parlant de contre-histoire de l’Église. Mon propos sera d’abord de présenter le livre lui-même et de donner des endroits où se le procurer. Puis je développerai quelques points soulevés par cette lecture et son oubli actuel. Je me livrerai à une discussion critique sur les mœurs des diverses facultés de théologie, avant de tirer quelques exemples et points théologiques de ce livre. J’agrémenterai ces propos d’extraits significatifs de la version française de l’ouvrage.
L’ouvrage et son auteur
Je connais la couverture de ce livre depuis mon enfance, pour l’avoir vu sur les étagères de mon père, sous le titre de la première édition, devenu le sous-titre de la seconde édition dans laquelle je l’ai lu. Seule la couverture a changé, le contenu n’a subi aucune modification.
Ce livre important a été traduit en français assez tardivement, peut-être après la mort de son auteur – nous n’avons pas assez de précisions biographiques sur lui. Il demeure, en langue anglaise un ouvrage de référence dans les milieux évangéliques, on en trouve une édition en livre de poche encore disponible. L’ouvrage est disponible en version papier chez CLC[2]. En occasion, en éditions originales, il faut parcourir les sites de bouquinistes, mais on le trouve assez facilement. Grâce à la numérisation, on peut le trouver complet sur le net. Le site suivant en donne le contenu par chapitres, mais on ne peut charger le texte complet en un seul fichier, c’est donc très bien pour consultation sur un point précis :
http://www.regard.eu.org/Livres.2/Pelerinage.douloureux/Depart.html .
Enfin, vous pouvez télécharger une version complète en PDF sur le site suivant :
Revenons à l’ouvrage lui-même et à son auteur. Edmund Hammer Broadbent est un pasteur et missionnaire anglais, né en 1861 et décédé en 1945. Il est assez difficile de trouver des éléments de biographie. La page Wikipédia est, pour une fois, inconsistante et reprend des informations sur le seul site qui fournit des données précises sur cet auteur : Plymouth Brethren Writings[3]. Les Frères de Plymouth représentent une branche protestante évangélique que l’on nomme généralement « les Frères ». Ces mouvements et églises sont caractérisés par deux aspects majeurs :
- Il n’y a pas de clergé dans ces assemblées, ce sont les Frères qui assurent à tour de rôle les charges dévolues ailleurs aux pasteurs. C’est un choix théologique qui fait référence aux église primitives du christianisme antique.
- Les Frères sont fondamentalistes, au sens protestant du terme, c’est-à-dire qu’ils fondent toutes leurs croyances et actions sur la Bible seule, qu’ils la croient entièrement inspirée et sans contradictions internes et qu’ils en font le plus souvent une lecture littérale.
Il est important de bien retenir cela pour comprendre l’orientation de ce livre et le choix de démarche de l’auteur. Broadbent fut un pasteur et missionnaire très actif et très populaire dans toute une série de pays d’Europe, centrale surtout. Il créa de nombreuses églises et en encouragea encore plus. Lors de ses très longues tournées missionnaires, il a eu l’occasion de réunir beaucoup de renseignements sur l‘histoire locale des mouvements protestants marginaux. Cela se remarque facilement dans son travail. Par ailleurs, il parlait couramment le français et l’allemand, langue dans lesquelles il pouvait prêcher. Il avait aussi acquis des notions de russe. Voici comment il présente son œuvre dans la préface originale :
« L’histoire de l’Église – l’ensemble de ceux qui par la foi ont reçu Christ et sont devenus ses disciples – est encore incomplète ; elle se poursuit. […]
Les pages qui suivent sont une contribution à l’exposition de cette histoire. Pour leur préparation, il a été fait usage de matériaux que beaucoup d’autres chercheurs ont trouvés ou classés. Ce livre est donc une compilation, accompagnée de résultats acquis par l’auteur en participant personnellement à l’œuvre qu’il narre. » Pages VII et VIII.
Le lecteur trouvera en effet de nombreuses références en notes de bas de page ; toutes sont en anglais ou allemand. On rencontre également une liste d’ouvrages de base au début du livre pages XV & XVI), que nous donnons ci-dessous :
Liste des livres consultés ou cités
Quelques autres, omis ici, se trouvent notés au bas des page.
« The Ante-Nicene Christian Library».
« Marcion. Das Evangelium vom Fremden Gott », Ad. von Harnack.
« East & West through Fifteen Centuries », Br.-Gnl. G. F. Young, C. B.
« A select Library of the Nicerse and Post Nicene Fathers of the Christian Church »,
translated and annotated by J. C. Pilkington M. A. Edited by Philip Schaff.
« Latin Christianity », Dean Milman.
« Priscillian ein Neuaufgefundener Lat. Schriftsteller des 4 Jahrhunderts ». Dr Georg.
Schepss, who discoverd the MS. in the Würzburg University, 1886.
« Priscillianus, ein Reformator des Vierten Jahrhunderts », Friedrich Parer.
« Die Paulikianer im Byzantischen Kaiserreiche, etc. »,, Karapet Ter Mkrttschian, Archi-
diakonus von Edschmiatzin.
« The Key of Truth. A Manual of the Paulician Church of Armenia », translated and
edited by F. C. Conybeare. Document found by the transiator in 1891 in the Library of
the Holy Synod at Edjmiatzin.
« An Officiai Tour through Bosnia and Herzegovina », J. de Asboth, Member of Hun-
garian Parliament.
« Through Bosnia and the Herzegovina on Foot, etc. », A. J. Evans.
« Essays on the Latin Orient », William Miller.
« Le christianisme dans l’Empire perse sous la dynastie sassanide (224-632) ». J. Labourt.
« The Syrian Churches », J. W. Etheridge.
« Early Christianity outside the Roman Empire », F. C. Burkitt M. A.
« Das Buch des Synhados » Oscar Braun.
« Nestorius and his Teachings », J. Bethune-Baker.
« The Bazar of Heraclides of Damascus », J. Bethune-Baker.
« Cathay and the Way thither », Col. Sir Henry Yule. Hakluyt Society,
« Nestorian Missionary Enterprise. The story of a Church on Fire », Rev. John Stewart
M. A., Ph. P. T. & T. Clark, Edinburgh.
« The Ancient Valdenses and Albigenses », G. y. Faber.
« Facts and Documents illustrative of the History Doctrine and Rites of the Ancient
Albigenses and Valdenses », S. R. Maitland.
« Die Réformation und die älteren Reformparteien », Dr Ludwig Keller, K. Staats-
archivar.
« Life and Letters of Erasmus », J. A. Froude.
« A Short History of the English People », John Richard Green.
« England in the Age of Wycliffe », George Macaulay Trevelyan.
« John Wycliffe and his English Precursors » Lechier, translated by Lorimer.
« The Dawn of the Réformation, the Age of Hus », H.-B. Workman M. A.
« Das Netz des Glaubens », Peter Cheltschizki, translated from Old Czech to Germant
by Dr Karl Vogel.
« History of Moravian Church », J.-E. Hutton.
« Das Testament der Sterbenden Murter », J. A. Comenius, translated into German by
Dora Pexena.
« Stimme der Trauer » J. A. Comenius, rranslated iota German by Franz Slaménik.
« Unium necesserarium », J. A. Comenius.
« A History of the Reformation », Thos. M. Lindsay.
« Die Taufe. Gedanken über die urchristliche Taufe, ihre Geschichte und ihre Bedeu-
tung fur die Gegenwart », J. Warns.
« Ein Aposted der Wiedertäufer », Dr Ludwig Relier.
« Vorträge und Aufsätze aus der Comenius Gesellschaft 7ter Jahrgang », I u. 2 Stücks.
« Georg Blaurock und die Anfänge des Anabaptismus in Graubiinden u. Tirol ».. Aus
dem Nachlasse des Hofrates Dr Joseph R. v. Beck, herausgegeben von Joh. Loserth.
« Fontes Rerum Austriacarum », Oesterreichische Geschichts-Quellen. Abth. 2 Bd. 43.
« Die Geschichts-Bücher der Wiedertaufer in Oesterreich-Ungarn us-w, in der Zeit von
1526 bis 1785 », Gesammeit, Erläutert und Ergänzt durch Dr Joseph Beck.
Archiv für oesterreichische Geschichte, 78 Band. « Der Anabaptismus in Tirol usw ».
Aus dem Nachiasse des Hofrates Joseph R. von Beck. Herausgegeben von Job. Losertb.
« Geschichte der Wiedertufer und ihres Reichs zu Münster », Dr Ludwig Relier.
« Geschichte der AIt-Evangelisehen Mennoniten Briiderschaft in Russland », P. M.
Friesen.
« Fundamente der Christiichen Lehre usw », Joh. Deknatci.
« Vermanung usw », Pilgram Marbeck.
« Schwenckfeld, Luther und der Gedanke einer Apostolischen Reformation », Kart Ecke.
« History of the Reformation of the Sixteenth Century », J. H. Merle d’Aubigné, D. D.,
translated by H. White B. A.
« Life of William Farel », Frances Bevan.
« The Reformation in Europe in the Tjme of Calvin », J. H. Merle d’Aubigné, D. D.
« The Huguenots, their Settlements Churches and Industries in England and Ireland »,
Samuel Smiles.
« Un martyr du Désert », Jacques Roger, Daniel Benoit,
« Memoir of William Tyndale », George Offor.
« A History of the Free Churches of England », Herbert S. Skeats.
« A Popular History of the Free Churches », C. Silvester Home.
« Laws of Ecclesiastical Polity», Richard Hooker.
« Journal of George Fox ».
« Geschichte des Christiichen Lebens in der rheinisch-westphälischen Kirche », Max
Goebel.
« Geschichte des Pietismus in der reformierten Kirche », Albrecht Ritechi.
« Geschichte des Pietismus und der Mystiit in der reformierten Kirche usw », Heinr.
Heppe.
« John Wesley’s Journal ».
« The Lift of William Carey, Shoemaker and Misssonary », George Smith C. J.E., LL. D.
« Lives of Robert and James Haldane », Alexander Haidane.
« Russland und das Evangelium », Joh. Warus.
« Johann Gerhard Onckcn. His Life and Works », John Hunt Cooke.
« Memoirs of Alexander Campbell », Richardson. The Standard Press, Cincinnati, Ohio.
« Autobiography of B, W. Stone », The Standard Press, Cincinnati, Ohm.
MSS Ed. Cronin, J. G. Bellet, etc.
« A History of the Plymouth Brethren », W. Blair Neatby.
« Memoir of the late Anthony Norris Groves, containing Extracts from his Letters
and Journals », compiled by his Widow.
« A Narrative of some of the Lord’s Dealings ‘with George Müller ».
« Robert Cleaver Chapman of Barnstaple », W.-H. Bennet.
« Collected Writings of J.-N. Darby », edited by William Kelly. Ecclesiastical Vol. 1.
« Nazarenes in Jugosiavia », Apostolic Christian Publishing Co, Syracuse., N. Y., U.S.A.
« Einzelne Briefe und Betrachtungen aus dem Nachlasse von S. H. Frohiich ».
On le voit, c’est une bibliographie conséquente, surtout en un temps où la consultation des ouvrages était beaucoup plus difficile qu’aujourd’hui. Même si le référencement n’est pas conforme aux normes actuelles, on peut aisément retrouver les livres. À la lecture attentive de l’ouvrage, il est aisé de mesurer ce gros travail de sources, mais aussi de distinguer ce qui vient de l’expérience de terrain de l’auteur. En effet, celui-ci a fait de très longues tournées d’évangélisation dans toute l’Europe centrale, l’Allemagne et l’Autriche, sans oublier la Russie, et il a profité de ces séjours pour accumuler des témoignages directs, surtout sur le XIXe siècle et le début du XXe siècle. Il s‘agit donc d’un travail associant l’histoire et la sociologie.
Un ostracisme signifiant
La question importante qu’il faut se poser est celle qui m’est venue à l’esprit lors de mes études de théologie à la Faculté Protestante de Strasbourg : pourquoi de tels livres sont-ils absents et ignorés des enseignants de cette faculté ? Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, nombreux. J’ai déjà chroniqué des livres forts intéressants pour la théologie protestante, qui n’ont pas droit de cité dans les grandes facultés de théologie protestantes, luthériennes ou calvinistes. La réponse est facile à trouver si l’on devient familier de ces lieux de savoir. Elle a deux aspects : une face « scientifique », toujours mise en avant, et une face religieuse et/ou théologique, plus difficile à formuler, donc implicite en ces murs académiques.
La réponse scientifique est celle de toutes les facultés et de tous les universitaires qui veulent évacuer un problème un peu gênant. Il s’agit simplement de décréter que ces ouvrages ne sont pas dignes d’être dans ces bibliothèques et d’être conseillés ou étudiés, car ils ne sont pas oeuvres universitaires obéissant aux canons de la maison. Je suis maintenant assez vieux et j’ai passé tant d’années à étudier dans les Universités, tant en géographie, à Bordeaux, qu’en théologie à Strasbourg pour ne plus accepter cet avis. Je connais les dessous de l’Université de l’intérieur et je sais que c’est un royaume qui se protège de tout ce qui pourrait nuire à son image de temple exclusif du savoir. Le prétexte de la scientificité est un moyen très pratique d’éliminer les pensées critiques, marginales ou jugées déviantes. Disons-le tout net : ce n’est pas la norme respectée d’un appareil de notes ou le type de plan qui peut suffire à écarter des ouvrages. Pas plus que le fait que l’auteur ne soit pas un universitaire. Que je sache, tant Voltaire que Tolstoï ou Rosenzweig et Péguy n’ont jamais été professeurs d’Université, et l’on a fait de nombreuses thèses et publications sur leurs écrits et leur pensée. Ce serait donc la valeur de la pensée qui serait à prendre en compte ? Mais par qui et sur quelles bases ? C’est là que l’on rejoint la deuxième face de cette exclusion, celle que j’appellerais « idéologique » au sens large du terme.
Il faut bien, en effet, parler du contenu, et c’est ici qu’interviennent des facteurs divers. Le premier est le filtre idéologique en cours dans telle ou telle université. Quand on a longtemps fréquenté les salles de cours des facultés françaises, on finit par savoir ce que cela signifie. Il y a des facultés de gauche et des facultés de droite et, par les temps présents, cette seule distinction suffit à éliminer. Plus largement, il y a les facultés au corps professoral plutôt progressiste et celles plus conservatrices – ce qui n’est qu’une illusion, puisque, en réalité, elles sont toutes conservatrices, en ce sens qu’elles visent à conserver leur ordre propre. Mais au-delà de ces oppositions classiques, il y a la capacité à accepter la diversité de pensée et la remise en question. Ce qui devrait être le propre d’une entreprise éducative réussie est en fait très rare. L’Université est une formidable machine à conformer les esprits, hier comme aujourd’hui. Or, il est bien plus facile de conformer en écartant les ferments de doute ou de trouble. Donc, tacitement, en ignorant tout ce qui pourrait rompre « l’esprit maison ». Ainsi, en géographie, il a été très longtemps impossible d’entendre parler d’Élisée Reclus, anarchiste communard, pourtant un des deux pères fondateurs de la géographie française. Puis, après 1968, il devint une bonne référence, et il fut sacrilège et complètement ringard de se référer à Paul Vidal de La Blache, l’autre fondateur. Des générations entières de professeurs d’histoire-géographie ont donc été hémiplégiques toute leur carrière durant. En théologie, ce que je puis déduire de ma propre expérience est qu’il y a une certaine interpénétration entre les deux facultés en ce qui concerne les grands théologiens catholiques et protestants. Les références croisées sont courantes dans les bibliographies des deux cursus. Mais, du côté protestant, elles ne portent que sur les deux courants officiels et historiques, à savoir les luthériens et les calvinistes. Pour un étudiant sérieux et respectueux, il est impossible de deviner qu’il existe bien d‘autres courants protestants, souvent numériquement très puissants, tout simplement parce qu’ils ne sont jamais évoqués. Et pourquoi ne sont-ils pas évoqués ? Eh bien, à ma grande surprise, je dois avouer que la première raison est tout simplement que les enseignants ne les connaissent pas ou très mal. J’ai ainsi eu un cours sur le pentecôtisme , en sociologie religieuse, mais illustré seulement par des exemples brésiliens ou latino-américains. Le professeur ignorait le pentecôtisme français ! J’ai eu l’occasion de le tester personnellement sur ce point. Ce n’est donc pas d’abord un jugement réprobatif ou des discordances théologiques qui expliquent ces mises à l’écart, mais bien plutôt l’ignorance. Cela ne peut que nous interpeller sur le travail universitaire : chaque professeur-chercheur fouille à vie son petit champ d’études, depuis sa thèse jusqu’à sa retraite, et se moque de tout ce qui pourrait l’en détourner. Le système s’autoreproduit dans l’étroitesse, sauf par un élargissement vers un nouveau « terrain de thèse », qui va faire naître un nouveau spécialiste. Ainsi depuis bientôt 30 ans, il y a un spécialiste de l’évangélisme protestant en France, un seul, c’est Sébastien Fath, qui laboure ce champ très consciencieusement, mais sans connaissance intime du sujet. J’arrête ici mon excursus sur l’ostracisme universitaire, qui n’est absolument pas un règlement de compte, puisque je n’ai jamais été universitaire et très heureux de cela, mais que j’ai pu vérifier cet état de fait et en être, à l’occasion, la victime ignorante, surtout lors de mes études de géographie, car j’étais moins expérimenté.
Mon but, en menant cette courte discussion, était de faire comprendre pourquoi des livres comme celui dont il est ici question, ne seront jamais connu des étudiants en théologie protestante, sinon dans les facultés évangéliques de type Vaux-sur-Seine ou Nogent-sur-Marne, où l’ostracisme fonctionne à rebours, envers les grands courants historiques ou le courant historico-critique ou libéral. Il est assez navrant de constater que la fameuse liberté académique à laquelle sont si attachés les universitaires ne sert qu’à défendre leurs chapelles respectives.
Trois points à souligner
Ce livre a toute sa place, selon mon jugement, dans les rayonnages des bibliothèques protestantes et les bibliographies, à la rubrique histoire de l’Église. Je vais m’efforcer, rapidement, de le prouver. Ceci sans nier les défauts de l’ouvrage.
Le premier point qui le rend utile, voire incontournable, dans une bibliographie sérieuse sur l’histoire de l’Église, est le positionnement initial revendiqué et assumé par l’auteur :
« L’histoire générale n’entre pas en ligne de compte, sauf quand les expériences de certaines églises exigent une référence aux événements de l’époque. Il n’est pas non plus tenu compte de ce que l’on entend généralement par l’« histoire de l’Église », excepté dans ses relations avec les congrégations de croyants pratiquant les enseignements de l’Écriture, qui font l’objet de cette étude. » Page VIII, préface originale.
Ce livre ne va donc nullement répéter ce que les Histoires de l’Église font souvent, avec des variantes selon le point de vue. Il fait le choix de raconter l’aventure des croyants d’un certain type, dans une perspective interne. Ce qui implique qu’il n’est utile et compréhensible pleinement que pour un lecteur qui connaîtra au moins les grandes lignes de cette histoire de l’Église. Celle-ci n’apparaîtra, malheureusement, le plus souvent, que par les pressions et répressions que les grandes Églises feront subir à ces croyants marginaux qui se revendiquent d’une fidélité au modèle premier. Ainsi en sera-t-il des Vaudois, Cathares et autres Bogomiles, persécutés par l’Église Catholique romaine, ou pour les Anabaptistes, violemment combattus lors de la Réforme, par les autres protestants. L’Église orthodoxe russe se signalera également par sa répression envers les Vieux-Croyants et les sectes évangéliques sorties de son sein. Les seules irruptions de l’Histoire dans ce livre sont donc le rappel d‘épisodes douloureux (d’où le premier titre français).
Le second point découle du premier. L’auteur met en évidence des groupes de chrétiens totalement ignorés jusqu’alors, même par les chrétiens de même mouvance évangélique et fondamentaliste. C’est dans les apports les plus personnels qu’il est le plus riche. Ainsi quand il raconte la succession d’hommes de Dieu (pour ne pas dire d’apôtres) qui ont traversé l’histoire de l’Angleterre, on découvre des hommes ordinaires devenus des missionnaires en leur propre pays. J’ai découvert l’existence des deux frères Haldane, Robert ( 1764-1842) et James Alexander Haldane (1768- 1851)[4]. Ces deux Écossais ont implant 85 églises en Écosse et en Irlande, sur des bases évangéliques strictes (baptême par immersion, communion hebdomadaire et autonomie des communautés. Broadbent s’appuie, pour son récit sur le livre autobiographique rédigé par J. Alexander Haldane, Lives of Robert and James Haldane[5], qu’il cite en bas de la page 312, en sus de la bibliographie donnée au-dessus. Les Églises officielles, notamment l’Église nationale d’Écosse, réunie en Synode, les interdirent de prédication et excommunièrent ceux qui allaient aux réunions où les frères Haldane prêchaient. Ce qui n’empêcha en rien le développement de leur ministère apostolique. Robert se rendit en Europe en 1816 et vint se fixer à Genève où, par des études bibliques avec des étudiants en théologie, il a suscité le début d‘un réveil évangélique qui se répandit ensuite sur le continent. Parmi ses auditeurs, Broadbent cite Merle d’Aubigné et Frédéric Monod. Cet exemple montre quelles informations de détail peut apporter cette lecture. Le chapitre sur la Russie est également très intéressant, venant apporter des précisions sur des mouvements et des acteurs très mal connus en Occident, notamment sur le baptisme allemand qui connut un succès réel en Russie. Souvenons-nous que Ivan Denissovitch, mis en scène par Alexandre Soljenitsyne[6], est baptiste, et emprisonné sous Staline pour ce seul fait. Ce livre est donc une mine d’or pour découvrir des acteurs inconnus dans de nombreux pays et territoires.
Le troisième point nous ramène, d’une certaine façon, à la théologie protestante. Il est frappant, à la lecture de cet ouvrage, de constater que deux points de croyance sont particulièrement en débat tout au long des siècles : le baptême et le rôle de la Bible. Ces deux points conduisent logiquement à un troisième point de discorde, celui des sacrements et de ceux qui les donnent. Le combat de l’Église ignorée que décrit Broadbent porte essentiellement sur ces questions fondamentales. À l’inverse, certains points de dogme, montés en épingle dans l’histoire officielle de l’Église, sont peu présents, comme la christologie ou la Trinité. D’autres semblent faire consensus, car ils ne sont pas cités souvent et ne sont pas à l’origine de conflits et de scissions. C’est le cas de la résurrection ou du jugement final. Il me paraît judicieux, à ce moment de mon article, de citer un extrait du livre, inséré dans le chapitre consacré aux Anabaptistes, qui donne la position de l’auteur, à partir des faits historiques constatés.
« Les disputes doctrinales n’eurent pas toujours affaire avec la défense de la vérité par un parti opposé à l’erreur d’un autre. Les dissensions découlèrent souvent de l’exagération d’un certain côté de la vérité, au détriment d’un autre côté de la même vérité. De part et d’autre, on insistait sur les portions de l’Eeriture qui appuyaient un point de vue particulier, en sous-estimant d’autres portions avancées par l’adversaire comme très importantes. On en a tiré la conclusion que tout peut se prouver par l’Écriture et que, pour cette raison, clic n’est pas un guide sûr. Au contraire, cette caractéristique est justement ce qui établit sa perfection. La Bible ne présente pas la vérité sous un seul aspect, mais les envisage tous à tour de rôle. Ainsi la doctrine de la justification par la foi seule, sans les oeuvres, y est pleinement enseignée. Toutefois l’Écriture nous présente aussi la vérité correspondante de la nécessité des bonnes oeuvres qui sont la conséquence et la preuve de la foi. Il est encore enseigné que l’homme déchu est incapable de tout bien, de tout mouvement de la volonté vers Dieu, et que le salut découle de l’amour et de la grâce de Dieu envers les hommes. Mais il est aussi dit que l’homme a la capacité d’être sauvé, ayant la faculté de répondre à la lumière divine et à la Parole, en condamnant le péché et en approuvant la justice révélée. De fait, toute doctrine essentielle de l’Écriture se trouve avoir son complément en une autre, et toutes deux sont nécessaires pour comprendre toute la vérité. En ceci la Parole de Dieu ressemble à l’oeuvre de Dieu en création, où nous voyons des forces opposées concourir à l’accomplissement du but désiré.
On pense souvent que, lors de l’établissement de la Réformation, l’Europe fut divisée en deux camps: les protestants (luthériens ou suisses) et les catholiques romains. On perd de vue un grand nombre de chrétiens qui n’appartenaient à aucun des deux camps. La plupart d’entre eux formaient des églises indépendantes. Ne comptant pas, comme les autres, sur l’appui du pouvoir civil, elles s’efforçaient de pratiquer les principes de l’Écriture comme aux temps apostoliques. Ces églises étaient si nombreuses que les deux grandes confessions liées à l’Etat les craignaient, pensant qu’elles constituaient une menace pour leur propre pouvoir, voire pour leur existence. Si un mouvement si important occupe peu de place dans l’histoire de cette époque, c’est parce que les grandes Églises, catholique et protestante, faisant constamment appel au pouvoir civil, l’anéantirent presque totalement. Les quelques adhérents qui survécurent furent exilés, ou ne formèrent plus que des milieux religieux faibles et comparativement sans importance. Le parti victorieux réussit encore û détruire une partie considérable de la littérature des frères puis, se constituant historien de ces églises indépendantes, il les représenta comme attachées à des doctrines qu’elles ont constamment répudiées, et leur donna des noms ayant une signification odieuse. » (pages 172-174)
Les idées énoncées dans cet extrait sont frappées au bon sens de l’histoire et de la connaissance de détail des communautés chrétiennes. Toute lecture des histoires officielles met le lecteur au contact des crises récurrentes à propos des interprétations doctrinales, à partir desquelles, le pouvoir dominant forgea le concept d’hérésie, avec toutes les conséquences graves que ces livres classiques nous présentent. Quand Broadbent nous dit : « Les dissensions découlèrent souvent de l’exagération d’un certain côté de la vérité, au détriment d’un autre côté de la même vérité. De part et d’autre, on insistait sur les portions de l’Eeriture qui appuyaient un point de vue particulier, en sous-estimant d’autres portions avancées par l’adversaire comme très importantes. », il ne fait que résumer les affrontements qui émaillent l’histoire ecclésiastique. Souvenons-nous de la longue crise arienne ou du nestorianisme, dont il faut bien admettre, in fine, que leur contenu ne change rien au cœur du christianisme : la foi au salut apporté par le Christ, confirmé par sa résurrection et le don du Saint-Esprit. On retire de la lecture entière de cet ouvrage, effectivement, le retour quasi systématique de crises et de scissions-excommunications-persécutions et cela sur des sujets qui, là encore , pouvaient aboutir à des positions de conciliation, avec un peu de souplesse. C’est d’ailleurs ce qu’il dit dans la suite de son texte : « De fait, toute doctrine essentielle de l’Écriture se trouve avoir son complément en une autre, et toutes deux sont nécessaires pour comprendre toute la vérité. En ceci la Parole de Dieu ressemble à l’oeuvre de Dieu en création, où nous voyons des forces opposées concourir à l’accomplissement du but désiré. » La question du baptême est assez représentative de cette attitude. Si l’opposition principale est celle concernant le baptême des enfants et ceux des seuls adultes, elle s’est ensuite doublée d’une querelle formaliste sur l’immersion, l’aspersion ou l’ondoiement. Ce qui donne une palette plutôt large de pratiques. Or, c’est la question de fond qui est majeure : qu’est-ce que le baptême, en chrétienté ? On sait que la réponse à cette question renvoie depuis plus de 1700 ans à une dichotomie entre Églises de multitudes et Églises de professants ou confessants[7]. Or, l’histoire de l’Église ignorée est celle des assemblées de professants-confessants[8] seulement, puisque, selon la préface citée au début de cet article, l’Église est, pour notre auteur, « l’ensemble de ceux qui par la foi ont reçu Christ et sont devenus ses disciples ». Le baptême est donc réservé aux adultes ou, du moins, à des êtres capables de faire un choix conscient, donc sûrement pas des nourrissons. Mais pourquoi alors trouve-t-on, dès la Réforme, un retour au baptême des enfants, alors qu’il a été initialement rejeté, pour des raisons évangéliques par les luthériens et Luther lui-même ? Broadbent dit à plusieurs reprises qu’il s’agit d’un compromis pour rassurer les familles, à une époque où les morts de bébés étaient pléthoriques et où l’Église catholique assortissait leur salut au baptême. Les Églises protestantes se sont affrontées sur ce thème qui a entraîné de nombreuses scissions. Aujourd’hui, la coupure est nette entre les Evangéliques, qui sont, de facto, anabaptistes, et les protestants luthéro-réformés qui pratiquent les deux baptêmes. Dans l’optique de cet ouvrage, le choix fidèle au Chris est le baptême adulte, celui que le Christ a lui-même reçu.
Cet exemple du baptême est étroitement corrélé à la place que l’on donne à la Bible dans la vie de la communauté. On sait que ce fut une ligne de partage entre catholiques et Réformateurs, qui ont rappelé le sola scriptura au sens étroit de la seule Parole de Dieu écrite dans la Bible. Si cela demeure un point central et commun à toutes les Églises protestantes, l’usage et la doctrine varient considérablement. Le spectre des positions va du libéralisme critique au fondamentalisme strict et littéral. L’extrait donné ci-dessus montre clairement que Broadbent admettait la diversité des avis, sur la base de la pluralité des angles donnés par la Bible. Il est donc possible, selon lui, de ne pas être tout le temps unanime sur les lectures et interprétations bibliques, sans que l’unité ecclésiale soit remise en cause. Mais, dans les études qu’il présente sur diverses espaces, on assiste à des affrontements durs et cassants parfois, autour de l’autorité de la Parole de Dieu. Certains n’admettent qu’une seule lecture, la plus littérale possible, et condamnent sévèrement ceux qui ne sont sur cette seule ligne, définie par eux comme la Vérité. C’est ainsi que le comportement sectaire, au sens actuel du terme, peut se développer, avec toutes ses dérives. L’histoire du catholicisme en apporte une longue série de preuves, avec moult délibération conciliaires sur ce thème.
C’est ici le moment de se souvenir de l’identité religieuse d’E.H. Broadbent. Ce n’est pas du tout le fait du hasard si la seule biographie un peu étoffée est celle des Plymouth Brethern. Plymouth fut le port de départ des Pilgrim Fathers, en 1620, en route vers la Nouvelle-Angleterre, où ils allaient chercher un peu plus de tolérance. Ils sont connus sous le vocable « puritains », devenu au fil du temps péjoratif. Dans son livre, Broadbent consacre des pages précises à cette assemblée de Plymouth et à deux de ses prédicateurs les plus célèbres : Benjamin Wills Newton et J.N. Darby. Il y montre les succès et les conflits de ces assemblées, dans le détail. Mais il reste, quant à lui, proche de cette théologie, sans donner cependant de preuves d’allégeance à quelque courant que ce soit dans son livre. Or, un des points caractéristiques de cette mouvance des Frères est de ne pas admettre de clergé professionnel, mais d’organiser la vie de la communauté sur les dons de chacun. Cette pratique existe encore de nos jours, mais il faut bien dire qu’elle est numériquement très minoritaire dans le monde protestant. La raison de ce choix est la lecture fondamentaliste du Nouveau Testament et le modèle de l’Église de Jérusalem. Tout au long de l’histoire du christianisme a subsisté une fraction des croyants qui ont voulu s’organiser selon ce modèle des Actes des Apôtres. C’est le grand mérite de ce livre de nous permettre de les suivre dans le temps long.
Trois questions essentielles en conclusion
En conclusion de son ouvrage, E.H. Broadbent revient sur trois questions, dont celle de ce modèle néotestamentaire. Il livre un résumé des positions en six points que je trouve utile de proposer au lecteur, car il me semble encore rentrer dans le débat sur la forme de l’Église, au-delà des grandes formes institutionnelles (Cléricalisme hiérarchisé, modèle synodal, modèle congrégationaliste…).
« 1. Est-il possible de se conformer à l’enseignement du Nouveau Testament
La question, de savoir si nous pouvons et devons continuer à appliquer l’enseignement et l’exemple du Nouveau Testament, quant à l’organisation des églises, a été envisagée de bien des manières:
1. La théorie du « développement » rend la chose indésirable, car – au dire des églises ritualistes, l’Église romaine, l’Église orthodoxe grecque et d’autres – on est parvenu à quelque chose de meilleur que ce qui fut pratiqué au début, et les Écritures ont été modifiées, voire supplantées par la tradition.
2. Le rationalisme donne la même réponse; il considère comme un mouvement de recul le retour au modèle original, puisqu’il refuse d’accepter la Bible comme autorité permanente.
3. Quelques réformateurs d’églises existantes ont essayé d’un compromis. Luther, Spencer et d’autres sont revenus en partie seulement à « ce qui était au commencement ».
4. D’autres ont abandonné toute tentative, tels les mystiques qui se vouèrent entièrement à la recherche de la sainteté personnelle et de la communion avec Dieu; entre autres Molinos, Madame de Guyon et Tersteegen. Puis les Amis, qui délaissèrent l’observance du baptême et de la Sainte Cène pour s’occuper davantage du témoignage de la lumière intérieure, que de celui des Écritures. Enfin Darby et ses disciples, qui rejetèrent cette obligation et la remplacèrent par le témoignage rendu à « la ruine de l’Église ».
5. Le réveil évangélique considéra la question comme sans importance et concentra ses efforts sur la conversion des pécheurs et sur l’organisation des moyens répondant le mieux aux besoins pratiques. Ainsi agirent les sociétés méthodistes de Wesley et l’Armée du Salut.
6. Mais il y a eu de tout temps, des frères répondant « oui » à cette question. On leur a donné des noms nombreux: cathares, novatiens, pauliciens, bogomiles, albigeois, vaudois, lollards, anabaptistes, mennonites, stundistes, et d’autres encore. Puis, plusieurs congrégations de baptistes et d’indépendants, ainsi que les assemblées des Frères: tous ont été fidèles dans leur effort d’obéir au Nouveau Testament et de suivre l’exemple des églises primitives. » (pages 471-418).
Il est assez net que le point 6 représente pour l’auteur un acte de fidélité, selon la trame de son récit. Quand on considère les structures et rites des grandes Églises, cela suffit à comprendre les conflits, mais n’excuse nullement les persécutions.
Il s’interroge également, dans cette conclusion sur l’‘annonce de l’Évangile :
« Est-il possible aujourd’hui de prêcher l’Évangile comme au début, et, si on le faisait, l’Évangile ne se répandrait-il pas beaucoup plus rapidement ? » (Page 418).
Manifestement, cette question est étroitement liée à celle de la forme ecclésiale. Une communauté qui ne reçoit que des adultes faisant profession de foi personnelle comme membres ne peut s’accroitre que par une prédication intense et une démarche prosélyte. Nous touchons là un point très sensible, beaucoup plus aujourd’hui qu’à l’époque de la rédaction de ce livre, il y a un siècle. La sécularisation est passée par là, ainsi que l’irruption de religions non chrétiennes, par l’immigration. Il est de bon ton, dans notre pays, pour mes chrétiens, d’affirmer haut et fort qu’ils sont attachés à la laïcité et ne font pas de prosélytisme. Or, les deux faits sont totalement disjoints, contrairement à une pensée commune ignorante. La laïcité est un cadre de vie, posé par la loi de 1905, dite « Loi de séparation de l’Église et de l’Etat » (où d’ailleurs le mot laïcité ne figure à aucun moment). Ce cadre implique le respect de toutes les croyances et les opinions conformes aux lois de la République, en termes de dignité humaine et de liberté. Mais il n’interdit nullement la parole prosélyte des religions. C’est uniquement une forme de peur larvée et de tiédeur spirituelle qui adhère à cette interdiction tacite, qui est tout à fait fausse dans son principe profond. Tout croyant aspire à partager sa foi et ses expériences avec autrui, et tout croyant se réjouit de voir de nouvelles personnes rejoindre la communauté. C’est le sens des baptêmes d’adultes à Pâques dans l’Église catholique et celui des baptêmes d’adultes chez les protestants également. Dans cette attitude se trouve la grande opposition entre les Evangéliques et les autres chrétiens : eux font ouvertement du prosélytisme et déploient un grand zèle à cette fin. Cela répond d’ailleurs à la question posée par Broadbent ci-dessus : l’Évangile se répand beaucoup plus vite dans les milieux évangéliques, qui sont partout en forte croissance, car ils font connaître le choix de salut de l’Évangile. Il est donc possible, pour répondre à la question de l’auteur, d’annoncer l’Évangile comme autrefois. Même si les moyens sont très modernes, et là aussi, les Evangéliques le montrent bien : ils usent de toutes els nouvelles technologies avec talent.
Enfin, son dernier point de réflexion concerne la position de l’Église dans le monde.
« 3. L’Église en pèlerinage
En jetant un regard rétrospectif sur la longue route déjà parcourue par l’Église « en pèlerinage», certains points saillants apparaissent. S’élevant au-dessus de la masse des détails si poignants pour ceux qui alors jouèrent un rôle actif, ces points réclament l’attention, car ils font de l’expérience du chemin parcouru une orientation utile pour le reste du voyage.
L’un d’eux, c’est que l’Église, dans son pèlerinage, a possédé dans les Écritures, dès la Pentecôte jusqu’à nos jours, un guide sûr et suffisant, et qui lui suffira jusqu’à ce que la clarté de cette lampe, brillant en un lieu obscur, pâlisse devant la gloire de la présence de Celui qui est la Parole vivante (2 Pierre 1. 19).
Le second point est que l’Église en pèlerinage est séparée du monde; bien que, dans le monde, elle n’en fasse pas partie. Elle ne devient jamais une institution terrestre. Elle est ici-bas un témoin et une bénédiction. Mais le monde qui a crucifié Christ ne change pas et, puisque le disciple accepte d’être comme son Maître, les pèlerins s’exhortent les uns les autres par ces paroles: « Sortons donc pour aller à Lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n’avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir » (Hébr.13. 13, 14).
Troisièmement enfin, l’Église est une. Du moment que nous nous savons être nous-mêmes membres de l’Église en pèlerinage, nous reconnaissons comme « co-pèlerins » tous ceux qui marchent sur le chemin de la Vie. Les divergences passagères, si pénibles momentanément, perdent leur acuité lorsque nous cherchons à avoir la vision complète du pèlerinage placé devant nous. Profondément humiliés en pensant à la petitesse de notre propre effort, et nous réjouissant cordialement en nos compagnons de route, saluons-les comme tels. Leurs souffrances sont les nôtres, leur témoignage, le nôtre; car leur Sauveur, leur Chef, leur Seigneur est aussi Celui que nous adorons. Éclairés par le Saint-Esprit, nous avons appris avec eux à nous réjouir avec le Père, lorsqu’Il dit: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection » (Matth. 3. 17). Avec eux aussi nous nous réjouissons à la perspective de ce jour où le Fils nous fera paraître devant Lui comme « une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable » (Eph. 5. 27). » (Pages 423-424).
Nous avons là les trois piliers qui ont guidé le pasteur Broadbent à accomplir cette tâche assez remarquable d’écrire une contre-histoire de l’Église. La Parole est suffisante pour guider les croyants, ce qui invalide tout l’appareil catholique de décisions conciliaires et de bulles pontificales. Mais elle est intégralement la sola scriptura, ce qui invalide aussi les approches libérales protestantes. Demeure donc, in fine, le mode de lecture de cette parole, qui est source de divergences oud e conflits, voire de scissions, dont son livre est très riche. Mais cela ne vaut-il pas mieux qu’une Parole figée dont un seul homme ou un seul groupe d’hommes a le pouvoir de dire le contenu réel ?
L’Église est « séparée du monde ». Nous savons combien ce second point a été piétiné et l’est encore aujourd’hui. Dans La subversion du christianisme, Jacques Ellul établit fort bien le rôle du constantinisme comme épisode fondateur de cette collusion de César et Dieu, tout à fait contraire à l’Évangile. La Réforme est, dès son origine, retombée dans la même ornière, avec Luther et les Princes allemands. Nous assistons aujourd’hui à un bel exemple de liaison douteuse entre l’Église orthodoxe russe et le pouvoir de Vladimir Poutine, ou entre les dénominations évangéliques et des leaders très éloignés du Chris, comme Donald Trump ou Jaïr Bolsonaro. Le pèlerin est en marche vers une cité qui n’est pas ici. L’Église est-elle en pèlerinage aujourd’hui ?
Enfin l’Église ne peut être qu’une, selon tout l’enseignement du Nouveau Testament. Mais nous savons aussi, en le lisant, qu’il y eut loin de l’idéal évangélique à la réalité primitive. L’unité est réelle en Christ, mais non réalisée dans les hommes. Certes il existe un Mouvement œcuménique, avec son conseil (le COE), mais ses avancées restent ponctuelles et modestes. L’unité en peut se faire qu’autour de la personne du Christ et de son message. Pour cela, il faut que les diverses communautés acceptent de se défaire de tout ce qui a été ajouté à cet enseignement pour revenir aux origines. Broadbent a des phrases très fortes, surtout pour son époque : « Profondément humiliés en pensant à la petitesse de notre propre effort, et nous réjouissant cordialement en nos compagnons de route, saluons-les comme tels. Leurs souffrances sont les nôtres, leur témoignage, le nôtre; car leur Sauveur, leur Chef, leur Seigneur est aussi Celui que nous adorons. » Même cela n’est pas encore réalisé.
Conclusion
Dans ce contexte, je voudrais clore ce petit essai en citant l’adresse aux lecteurs français de cet ouvrage, par Ruben Saillens, dont j’ai parlé au tout début. Ce texte mérite d’être médité dans le contexte actuel.
« Aux lecteurs français
par M. le pasteur Saillens
Le caractère le plus douloureux de l’histoire du christianisme, depuis ses origines jusqu’à nos jours, c’est la tendance de la majorité des chrétiens professants à s’unir aux puissances temporelles pour persécuter les minorités qui voulaient, ou veulent encore, demeurer fidèles à l’esprit comme à la lettre de l’Évangile.
Ces minorités ne furent certes pas sans faiblesses, ni même, trop souvent, sans professer de graves erreurs. Mais c’est de leur côté, cependant, qu’il faut chercher les témoins du Christ, qui voulaient maintenir le principe fondamental de la doctrine évangélique: la nécessité, pour être vraiment chrétien, d’une foi personnelle en Christ, « mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification ».
Dès que le christianisme devint une religion héréditaire, dès que l’Église devint partie intégrante de l’État, dès que la naissance et la nouvelle naissance furent confondues. le christianisme devint un nouveau paganisme, et, par la force des choses, il fut persécuteur. Cette tendance, hélas! s’est retrouvée jusque dans les Églises de la Réforme, tant il est vrai que l’intolérance est naturelle au coeur humain!
Nous remercions de grand coeur les frères qui nous ont donné une traduction du présent livre, dans lequel nous est racontée la longue et tragique épopée de l’Église sous la croix. Nous souhaitons vivement que cet ouvrage soit largement répandu dans nos milieux de langue française, et surtout parmi notre jeunesse, dont la devise doit être : croire tout ce que Dieu a dit; faire tout ce qu’Il ordonne; recevoir tout ce qu’Il donne; aimer tous ceux qu’Il aime; souffrir patiemment tout ce qu’Il permet; attendre enfin le triomphe du Christ, par son retour certain et glorieux !
R. SAILLENS. » (page X).
Comme je me suis efforcé de le montrer, cet ouvrage a toute sa place dans les bibliothèques chrétiennes des facultés, car il apporte des informations et un regard nouveaux sur tout un peuple croyant, au fil du temps. Il peut aisément être consulté comme source de référence, car il est doté d’un index très précis. Il nous parle aussi des convictions de son auteur et révèle un angle de vue ignoré de beaucoup sur l’Église de Christ. Bien sûr, il n’est pas exempt de défauts. L’universitaire trouvera le plan critiquable, notamment par les chevauchements chronologiques inévitables. On pourra parfois lui reprocher une vision partisane des faits, mais ceci est le fait de tous les écrits humains, même de ceux qui se réclament le plus de l’objectivité rationnelle et scientifique. Ces défauts pèsent peu à côté de l’intérêt de fond de l’ouvrage.
Jean-Michel Dauriac – Août 2023 – Les Bordes.
[1] J’emprunte ce titre à Michel Onfray et à ses cours à l’Université Populaire de Caen : une contre-histoire de la philosophie.
[2] https://www.clcfrance.com/produit/leglise-ignoree-edmund-hamer-broadbent-impe010-9782890820081
[3] Voici le lien direct à cette biographie, en anglais : https://plymouthbrethren.org/article/62 . Ce site fournit une série de biographie de personnalités du monde protestant évangélique tout à fait appréciable et rare.
[4] Pour James Alexander, il existe un article en anglais sur Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/James_Haldane , et un autre pour Robert, en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Haldane .
[5] Peut télécharger ce texte sur le site suivant, en multiples formats : https://archive.org/details/memoirsofliveso00hald/page/n9/mode/2up .
[6] Une journée d’Ivan Denissovitch, Alexandre Soljenitsyne, Paris, Robert Laffont, 2015, 240 pages.
[7] Certains théologiens établissent une distinction entre professants et confessants : le confessant se définit par rapport à une Confession de foi préexistante (le Symbole des Apôtres, par exemple), alors que le confessant fait une profession de foi personnelle et publique lors de son baptême. Si l’on s’en tient au Nouveau Testament, les deux termes sont synonymes.
[8] Voir l’article Confession, in Vocabulaire de théologie biblique, Paris, éditions du Cerf, 1971 pour la deuxième édition, colonnes 192 à 195.
Leave a Comment