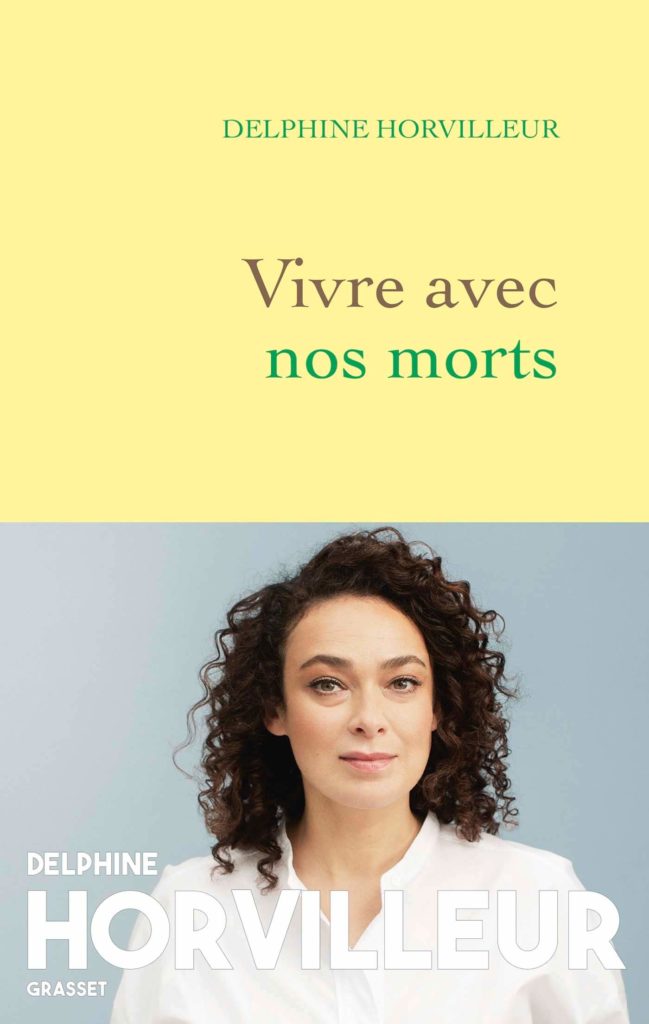Voici la version audio de cette méditation:
Nous allons encore une fois considérer une histoire de sortie et de départ. Celle-ci est très célèbre, car elle appartient en commun aux trois grands monothéismes, judaïsme, christianisme et islam. Il s’agit de ce qu’on peut appeler, au sens propre du terme, la « vocation[1] » de l’homme qui s‘appelle encore Abram. Cet épisode est devenu légendaire et, de ce fait, il est le plus souvent résumé à l’appel de l’Eternel adressé à Abram. Il est utile de se pencher sur le texte de la Genèse qui ouvre la biographie sélective du patriarche, car il est plus nuancé que la légende.
Lecture de base : Genèse 11 : 31-32 (version Bible de Jérusalem)
« 31 Térah prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils de Harân, et sa bru Saraï, femme d’Abram. Il les fit sortir d’Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan, mais, arrivés à Harân, ils s’y établirent.
32 La durée de la vie de Térah fut de deux cent cinq ans, puis il mourut à Harân. »
Le contexte de la vocation
Ce sont ici les deux derniers versets du chapitre 11, lequel sert de transition entre l’épisode de la Tour de Babel et le récit de la vie d’Abraham. Les versets 10 à 27 de ce chapitre présentent une généalogie des fils de Sem, peut-être le fils aîné de Noé (on ne sait pas vraiment si sa mention en premier est synonyme d’ainesse). Il est l’ancêtre des peuples dits « sémites », qui peuplèrent l’Arabie et le Proche-Orient. Donc l’ancêtre commun des Hébreux, des Arabes, Palestiniens, Syriens… Cham, son frère serait le père des Cananéens et des Egyptiens, Ethiopiens…, Japhet, le troisième fils serait à l’origine des peuples asiatiques du Moyen-Orient et des peuples de l’Occident européen.
Cette généalogie, comme la plupart de celles du Premier Testament a un but politique, celui d’établir les filiations ; c’est une pratique orientale classique, qui nous est étrangère. L’étude de détail de ces généalogies ne fait sens que pour l’exégète. Cependant, à la fin de cette liste, au verset 27, nous arrivons enfin à ce qui en est le but : introduire la famille d’Abram. Nous faisons alors connaissance avec Térah, le père, avec les trois fils, Abram, Nahor et Hâran, et avec son fils Loth.
Nous apprenons la mort de Hâran, : Loth est donc orphelin et, de fait, selon les coutumes de l’époque et du lieu, il est sous la protection de ses oncles. Ceux-ci se marient, on apprend le nom de leurs épouses : Saraï pour Abram et Mika pour Nahor – Mika est la sœur de Loth, donc la cousine de son mari. En trois versets, le décor est planté. Le verset 30 semble glisser un détail, au passage : Saraï était stérile, ce qui était un vrai problème dans la culture orientale où la mission de la femme était de procréer et de donner de préférence des fils. Nous savons combien de point sera important pour le devenir des trois religions dites Abrahamiques.
Maintenant que nous connaissons le contexte et les personnages, nous pouvons en venir à l’action décrite dans les versets 31-32.
La décision de Térah
Térah, le chef de famille – vous noterez le cadre patriarcal total : nous ignorons le nom de la mère – prend la décision de quitter sa ville natale, Our (ou Ur selon les graphies). Et il part avec Abram, Saraï et Loth.
Deux questions se posent immédiatement :
- -pourquoi cette décision de partir ?
- -Pourquoi Nahor et Mika ne sont-ils pas du voyage ?
Sur ces deux questions importantes, la Bible ne donne aucune réponse. Depuis des millénaires, les hommes religieux cherchent les explication et ils en sont réduits à des conjectures. Nous ne savons absolument rien de sûr de la cause du départ de Térah, car c’est bien SA décision et non celle d’Abram.
Il y a bien sûr un facteur déclenchant, mais il ne nous a pas été révélé. Ce qui compte est le fait brut : Térah s’exile volontairement loin d’une ville riche et prospère, capitale de la Mésopotamie de l’époque. Les motivations de Térah peuvent être économiques, politiques ou religieuses. Il peut fuir une crise de subsistance ou de travail, s’enfuir devant une invasion, ou partir loin d’une religion idolâtre qui le gêne. Il peut aussi avoir envie d’un nouveau destin. Nous n’avons pas la réponse, et il serait hasardeux de suggérer un appel religieux de Dieu adressé à Térah. Jusqu’à la mention de sa mort, rien ne nous sera dit.
Nous savons seulement qu’il partit pour se rendre au pays de Canaan, donc à l’étranger, chez les fils de Cham, parlant une autre langue. Là aussi, nous n’avons aucune lumière. Le pays de Canaan était un « bon pays », fertile et arrosé grâce aux montagnes intérieures de la Palestine. Mais Our était au cœur du double delta du Tigre et de l’Euphrate, donc dans un pays encore plus riche. Avouons notre perplexité.
Térah s’arrête à Hâran[2] (ou Charan dans certaines versions) et s’y installe avec sa famille. Il ne va donc pas au terme de son projet. Nous n’en savons pas plus. On peut avancer l’idée que Térah a été un instrument (conscient ou pas) dans le projet d’alliance de Dieu-Yahvé. Mais nous ne savons même pas s’il croyait en l’Eternel. Il peut représenter un type répandu dans la Bible : celui qui aide à la réalisation de la volonté de Dieu sans en être conscient. Ainsi en fut-il du prophète Balaam ou de Rahab la prostituée de Jéricho. Le résultat de la vie de Térah est là : il a emmené une partie de sa famille à Hâran, à des centaines de kilomètres de sa ville natale, il s’y est installé, il y a vécu un certain temps, il y est mort et enterré. Mais son fils Nahor et sa femme Mika ne l’ont pas suivi, la famille s’est donc scindée. Le contact ne sera rétabli qu’avec l’envoi du serviteur d’Abraham vers le lieu où vit Nahor, pour trouver une épouse de son sang à son fils Isaac (lire le chapitre 24 de la Genèse, qui ressemble à un conte oriental).
La vocation directe d’Abram
Lecture de base : Genèse 12 : 1-2 (version La colombe)
« 1 Yahvé dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t’indiquerai.
- Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom ; sois une bénédiction ! »
Jusqu’ici nous n’avons vu Abram que dans une situation passive de fils, oncle et mari, qui suivait son père dans son départ d’Our. Certains commentateurs affirment que ce serait Abram qui aurait motivé le départ et choisi la destination de Canaan. La Bible ne permet nullement d’étayer cette interprétation et les sources sur Abram sont rares et incertaines, hors de la Bible[3]. Il faut donc s’en tenir à ce que dit le texte de Genèse 11 et 12.
Pour confirmer cette ignorance initiale d’Abram, nous disposons par contre d’un verset de la Lettre aux Hébreux, chapitre 11 verset 8 :
« 8 Par la foi, Abraham obéit à l’appel de partir vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant où il allait. » Version Bible de Jérusalem.
Le texte nous dit bien : « Il partit ne sachant pas où il allait. » Nous devons donc accepter de lire le texte dans sa chronologie, avec des incertitudes.
- L’appel à Abram est donné à Hâran.
- Térah est mort et enterré dans cette ville.
- L’appel concerne la mise en marche, mais ne dit rien sur la destination finale.
- Abram avait alors 75 ans au moment de son départ (rappelons que son père Térah a vécu 205 ans – ch. 11 verset 32)
- Il part en compagnie de son neveu Loth et de tous ses biens de nomade (troupeaux et serviteurs).
Le mot « Canaan » n’est pas dans l’appel initial de l’Eternel et n’est cité qu’au verset 5.
Abram part donc sur une simple injonction, avec très peu de renseignements. Notons que c’est l’Eternel qui parle directement à Abram. Jusque là, nous ne savons rien de la religion de Térah et ses fils. Mais, nés à Our, ils sont nécessairement polythéistes. Il en semble pas que Térah ait eu une révélation personnelle, ni qu’il fut un croyant en l’Eternel.
Le verset 1 du chapitre 12 est donc une première, celle de l’irruption du Dieu unique dans la vie d’Abram. Il nous faut admettre notre perplexité face à ce contact et à cette vocation.
Comment Dieu s’adressa-t-il à Abram ? Comment Abram réagit-il en entendant cette parole ? Cela nous ne le savons nullement.
Et c’est justement ce départ avec si peu de précisions qui est cité dans le verset 8 du chapitre 11 de la Lettre aux Hébreux : « Par la foi, Abraham… », donc en faisant confiance à cette voix inconnue qui donne un ordre très vague. Bien sûr, cet ordre est assorti d’un promesse proprement incroyable par son ampleur (verset 2). Mais que vaut la promesse d’un Dieu inconnu ? Elle vaut uniquement par la confiance (c’est le même mot que la foi) qu’on met en elle. Prenons l’image du billet de banque, très présent et banal dans notre vie : ce n’est que du papier, et pourtant nous l’échangeons contre des marchandises bien réelles et de valeur. Et cela uniquement parce que nous avons confiance en ce billet, qui vaut ainsi « de l’or ». Ici est le saut de la foi.
L’exemple d’Abram est intéressant en ce qu’il nous montre que la foi est le déclencheur de toute marche avec Dieu. Ce n’est pas la précision de l’appel qui est décisive, pas plus que la grandeur de la promesse. C’est simplement le dit de Dieu. Il n’y a pas besoin d’avoir beaucoup de connaissances pour saisir la foi, ou pour se laisser saisir par elle. Jésus dit bien à ses disciples qu’il faut être ou devenir des petits enfants (Marc 10 : 14). Ce qui est important est d’entendre ce que dit la voix de Dieu. C’est la capacité d’écoute (la qualité de la recherche) qui est capitale.
Abram saisit par la foi cette vocation, très vague, mais glorieuse. Il n’a pas pour l’heure besoin d’en savoir plus. Il apprendra en marchant. Et cette marche va durer cent ans : Genèse 25 : 7-8.
« 7 La durée de la vie d’Abraham fut de 175 ans.
- Puis Abraham expira. Il mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié (de jours), et il fut réuni à ses ancêtres décédés. » Version La colombe.
Relisez les chapitres 12 à 25 de a Genèse ; vous verrez qu’être un homme de foi ne protège pas des erreurs (donc du péché occasionnel), mais permet de toujours garder le contact avec Dieu. C’est la grande leçon d’Abraham pour nous.
Jean-Michel Dauriac, Mars 2021.
[1] Une vocation, au sens littéral est un appel réalisé par une voix. C’est donc exactement ce que vit l’acteur du récit de Genèse 12.
[2] Ce n’est pas le même mot que le nom du fils de Térah.
[3] La religion juive dispose de ce qui est appelé la « Torah orale », révélation complémentaire faite aux Hébreux au fil du temps. Mais le christianisme ne reconnaît pas cette source dans son canon.
Leave a Comment