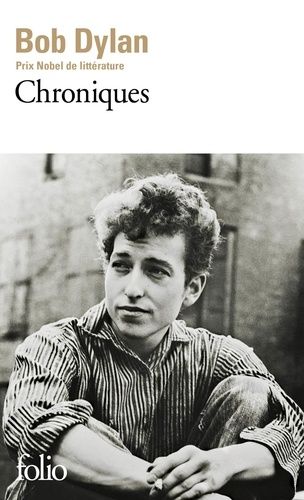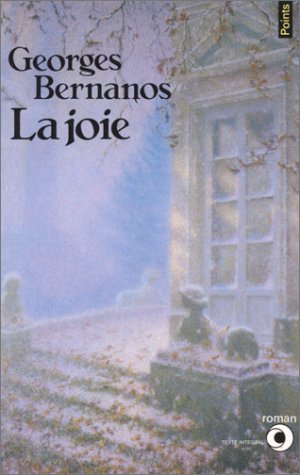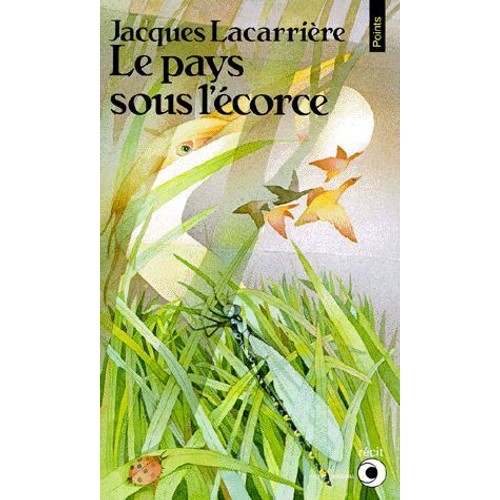Robert Zimmerman se souvient…
A propos de Chroniques volume 1 de Bob Dylan
« A-t-on idée de donner un Prix Nobel à un type qui écrit des chansons et chante mal d ‘une voix nasillarde ? » Voilà ce que qu’on a pu entendre en 2016, à l’annonce de l’attribution du Prix Nobel de Littérature à Robert Zimmerman, plus connu sous son nom de scène, Bob Dylan. Ceux qui s’exprimaient ainsi étaient sans nul doute des lettrés, amoureux des livres et la Littérature avec majuscule, et ne pouvaient envisager que la chanson soit une forme de la poésie, elle-même à l’origine de la littérature. Un auteur de chansons, en eût-il écrit des centaines, n’aurait créé aucune œuvre. Je ne chercherai pas à combattre un jugement aussi stupide, qui s’appuie, de plus, sur la méconnaissance ou l’ignorance des dites-chansons du dit-Bob Dylan. Lequel a dû bien rire en apprenant qu’il avait le Nobel, puis est allé pisser tranquillement, comme avant.
En 2005 est parue en France le livre qui nous intéresse ce jour, Chroniques volume I, de Bob Dylan. Ceux qui ont accueilli avec la moue sa promotion au Nobel auraient été bien inspirés de lire cet ouvrage et de tourner sept fois leur langue dans la bouche de leur voisine (comme disait très vulgairement Pierre Desproges, ce bateleur télévisuel !) avant de parler. Car ce volume est bien de la littérature, et de la bonne !
On imaginerait mal Dylan livrant une bonne petite autobiographie linéaire, un biopic à l’américaine. Le titre choisi, Chroniques, est d’ailleurs tout à fait clair. Il va nous livrer quelques tranches de souvenirs sur sa vie, sous la forme de la chronique des jours qui passent. Comme dans ses chansons, nous serons assez souvent dépaysés, voire un peu perdus. Chaque chapitre pourrait être autonome. Ils sont livrés sans souci chronologiques. Ils dessinent cependant un portrait, mais à la manière impressionniste. C’est de loin qu’on le reconnaît le mieux, quand on achevé la lecture. Il reste alors une image, celle qu’il a bien voulu nous donner, comme tous les auteurs d’autobiographie.
La première conclusion qu’on peut tirer de cette lecture, c’est qu’il parfaitement évité de s’épancher sur sa vie privée et sur ses états d’âme. Celui qui attendait des détails croustillants sur ses amours ou ses addictions en sera pour ses frais. Bien sûr, il ne parvient pas absolument à tout cacher et nous pouvons, avec attention, collecter des indices qui nous aideront à approcher la personnalité du chanteur. S apprendrons ainsi qu’il se veut avant tout un auteur, et en aucun cas comme un porte-drapeau d’un quelconque courant politique. Il nous répète à plusieurs reprises qu’il y a eu un gros malentendu à ce propos et que rien ne l’énerve plus que de s’entendre qualifier de représentant des aspirations de la jeunesse américaine. Si cela fut le cas, c’est à son corps défendant, simplement parce qu’il ressentait était aussi partagé par toute une génération. Mais il se définit avant tout comme un individualiste. Un individualiste plutôt timide, qui n’aime pas la foule et les lieux à la mode. En creux se dessine le portrait ; finalement classique du poète provincial monté à la capitale. Il nous fait partager son évolution personnelle d’auteur-compositeur, car c’est son unique but que d’être reconnu à ce titre.
C’est le second thème de ce livre : la chanson et la musique à la fin des années cinquante et au début des années soixante du XXe siècle. Le grand homme de Robert Zimmerman se nomme Woodie Guthrie, le baladin qui avait écrit sur sa guitare « cette guitare tue les fascistes » et a comosé un grand nombre de folk-songs classiques. La culture de Dylan est vraiment celel du folk-song. Ce livre nous permet de saisir à quel point il en a été pétri et combien ce style a pesé sur ses œuvres. Il partage avec nous les noms de ceux qui furent ses inspirateurs, ces chanteurs pour la plupart tombés aujourd’hui dans l’oubli. Comme le fera après lui Bruce Springsteen, sans doute inspiré par lui, il a sorti en même temps que le livre un double CD portant le même titre, sur lequel il a réuni les chansons qui l’ont marqué dans sa jeunesse, contenu du premier CD. Le deuxième disque est une compilation de ses chansons par ceux qui les ont reprises, de Cher aux Byrds, entrelardées de certaines de ses interprétations de chansons bien particulières évoquées dans le livre. Dylan assume une culture anté-rock and roll, nettement plus acoustique. Il lui faudra d’ailleurs attendre un certain nombres d’années avant de paraître sur scène avec une guitare électrique et se faire accompagner par un groupe de rock, en l’occurrence The Band, avec lequel il enregistra quelques albums marquants. Mais chez Dylan, le texte reste premier, toujours écrit avant les musiques. Il reviendra à ses amours de jeunesse, en enregistrant un album qui a surpris, dans lequel il rend hommage à Franck Sinatra, en reprenant certains de ses grands succès, album titré Shadows in the night. Dans le livre, il partage avec nous la conception de deux albums, sous la forme d’une sorte de journal. On y voit peu à peu l’album prendre forme, on y ressent les doutes, on y assiste à des expériences… C’est excellent pour comprendre cette face cachée de la musique populaire, où le travail de studio est capital. On trouve des éléments comparable dans la grosse autobiographie de Bruce Springsteen dont j’ai rendu compte par ailleurs.
Il y a d’ailleurs de nombreux points communs entre ces deux monstres sacrés de la musique pop américaine. Tous deux sont de purs produit de l’Amérique, parfaitement symboliques de leur temps. S’ils critiquent très durement, tous deux, la société et la politique leur pays, ce n’est pas pour le détruire, mais pour le corriger, l’améliorer. Tous deux ont eu ce désir indestructible de faire leur chemin dans la chanson et la musique populaire. Ils ont connu des débuts modestes, ont été critiqués durement : de Dylan on disait qu’il ne savait pas chanter, tout comme pour Springsteen. Leur parcours a démarré lentement mais a connu une progression constante, jusqu’à les mener au firmament de leur rêve. Pour les deux hommes, la famille est très importante et on trouve sur ce thème des pages émouvantes, somme toutes très banales car communes à tous les humains.
Les différences existent et sont cependant nettes. Dylan a toujours voulu se garder d’un engagement politique net, alors que Springsteen est né démocrate et a soutenu des candidats de ce parti. Springsteen est un enfant du rock, quand Dylan est fils du folk. Dylan est d’origine WASP, Springsteen est un mix très américain d’italiens, d’irlandais et d’américains.
Mais tous les deux ont écrit des chansons qui ont marqué des générations du monde entier et dont les textes sont des modèles de travail d’auteur.
Bob Dylan occupe une place unique dans la chanson américaine. Comme l’a fait Miles Davis dans le jazz, il a su s’adapter à l’évolution de la musique et l’intégrer dans son travail. On aimerait beaucoup que sorte le volume II de ces chroniques, mais rien de tel n’est annoncé de certain pour le moment. Il faut lire ces pages, fort bien écrites et agencées de manière très personnelle. Elles démontrent sans contestation que le Prix Nobel de littérature qu’il a obtenu n’est pas une escroquerie.
Jean-Michel Dauriac – Août 2022
Leave a Comment