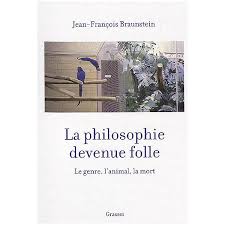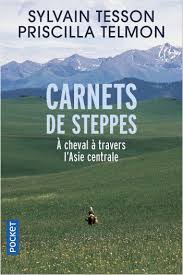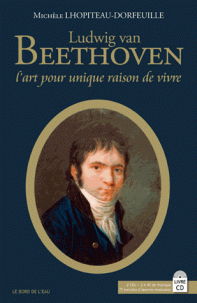La philosophie devenue folle
Le genre, l’animal, la mort
Jean-François Braunstein
Paris, Grasset, 2018– 394 pages – 20,90 €
Un livre au titre attirant car très provocateur : la philosophie, n’est-ce pas la sagesse ? Or, si la sagesse devient folle, que nous restera-t-il pour être sages.
Le sous-titre éclaire aussitôt notre lanterne : ce n’est pas toute la philosophie qui est devenue folle, mais les trois sujets cités qui l’y poussent. Le lecteur attentif à l’actualité éthique et politique aura reconnu dans ces trois thèmes les grands débats « post-modernes » qui agitent le landerneau politique progressiste et la caste éclairée de nos penseurs.
Les trois thèmes donnent lieu chacun à une partie du livre, dans cet ordre. Le volume de chaque partie est assez important pour bien aborder le sujet. Un très bonne conclusion de synthèse ferme cet ouvrage.
Il faut d’abord signaler que l’auteur ne jargonne pas, ce qui est appréciable pour un livre de professeur de philosophie. Il nous épargne l’exposé des concepts mis en jeu et préfère les faire apparaître dans l’étude des théories incriminées. Ce qui est beaucoup plus agréable et plus accessible à un large public : il n’est en effet pas besoin d’avoir fait de longues études pour se saisir de cet ouvrage. On peut parler de vulgarisation critique.
Chaque thème fait l’objet d’une présentation théorique, d’un résumé de son historique où sont présentés les inventeurs ou propagateurs de ces courants. La démonstration s’appuie sur un large choix de citations fort bien référencées, ce qui valide la démarche critique.
Braunstein ne mène pas un combat polémique. Il a choisi de présenter les arguments des propagateurs du genre, de l’anti-spécisme et de l’euthanasie avec une ironie mordante qui fait mouche. Il faut dire que nombre de citations sont absolument délirantes, il faudrait en faire une anthologie. Je laisse le lecteur les découvrir à chaque page du livre. Une fois ces présentation bien faîtes, il n’est effectivement nul besoin de détruire ces thèse, elles se disqualifient d’elles-mêmes, à moins que vous n’apparteniez à la même confrérie du délire.
Ainsi le genre apparaît comme une pensée a priori séduisante qui est devenue hors contrôle par une surenchère de non-sens. L’apport théorique de la notion de genre a permis d’aborder des sujets jusque là ignorés ou repoussés. Mais ce qui s’appelle le genre aujourd’hui dans ces cercles philosophiques dépasse toutes limites de la raison. On y croise toutes les variantes de genre revendiquées et on s’aperçoit vite que le sigle LGBTQ est totalement dépassé. La typologie est tellement farfelue et étoffée sans cesse qu’il n’y aura pas assez de lettres dans l’alphabet pour en faire l’acronyme. Derrière ces revendications se cache en réalité la haine du corps et sa négation. Le corps comme le sexe biologique n’existent plus pour ces penseurs. La preuve par les partisans de l’amputation volontaire qui veulent faire reconnaître le droit de se débarrasser d’un membre qui ne leur convient pas. Il n’y a en réalité plus aucune limite au désir de chaque individu, au nom de la liberté. Or les théories les plus en pointe ne sont pas connues du public qui ne connaît que la face présentable du genre, lequel est souvent confondu avec le féminisme, qu’il veut éliminer en fait car perçu comme réactionnaire. Ce livre remplit donc une belle mission de dévoilement avec des bases solides.
Le thème de l’animal est tout aussi effrayant. La vitrine nous présente les « droits de l’animal » et le végétarisme comme produits d’appel, mais il n’est pas vraiment question de cela. Il s’agit, là aussi d’une révolution anthropologique qui distingue initialement entre « l’animal humain » et « l’animal non-humain », mais s’en éloigne ensuite très vite pour abolir la notion même d’espèce, pour accorder les mêmes droits à tous les vivants ; Les textes présentés sont effarants mais surtout ridicules. Cela va de l’apologie de la zoophilie à la révision du droit pour contourner l’absence de consentement de l’animal. On sort très secoué de ces pages, car la raison vacille ; et ce qui est le plus triste c’est que ces lignes émanent de sommités universitaires qui font autorité dans leur microscopique spécialité. La palme de l’énormité revient au professeur Singer et à ses traités d’éthique. Il est patent que l’Université ne sort pas grandie de cette étude, car on découvre – si on ne le savait pas – qu’elle offre asile au sens plein du termes à de véritables fous délirants. Or, encore une fois, les question initiales ne sont pas sans intérêt : réfléchir à la place de l’animal dans nos cultures est utile et doit amener à corriger de grosses erreurs ; mais là n’est plus la question. Les « animalitaires » sont par-delà le bien et le mal, le juste et l’injuste, ils sont emportés par une pensée destructrice dont ils ne sont pas capables de voir que, si elle n’avait jamais été formulée auparavant, c’est parce qu’elle est absurde et non parce qu’ils sont des génies.
La dernière partie sur la mort est le couronnement de cette folie. L’auteur présente successivement les partisans de l’infanticide, l’euthanasie, banale dans ces discours, mais surtout l’évolution de la notion même de mort, avec la « mort cérébrale », concept non médical, qui amène à prélever des organes sur des « morts » qu’on prend la peine d’anesthésier ! La logique du profit, abritée derrière la santé, brise tout même les choses les plus sacrées, car s’il est une chose sacrée pour l’homme, c’est la mort !
On sort de ce livre plutôt secoué, mais c’est un trouble très salutaire, car il met au jour ce qui est masqué et nous force à regarder en face des concepts pour lesquels nous avons pu avoir de la sympathie, mais sans savoir vraiment ce qu’ils recouvraient. D’un point de vue philosophique, il y a là des discours de rupture qui ne peuvent relever de la philosophie. Du point de vue éthique, les questions en jeu sont de première grandeur, puisqu’elles remettent en cause les fondements même de l’anthropologie humaine. Du point de vue théologique, c’est un tissu d’assertions aberrantes. Mais à l’issue de cette lecture, le lecteur comprend alors que le projet transhumaniste est le couronnement de tous ces délires : il prévoit en effet de mettre fin ultimement à la notion d’humain, pour faire naître le post-humain. Ce n’est plus de la science-fiction, c’est déjà dans les laboratoires et en test par petits morceaux dans nos vies. Je pense qu’il y a là matière à mobiliser ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y croient pas, mais qui trouvent que l’humanité de l’homme, avec toutes ses limites et potentialités est une richesse.
Un livre à lire et faire lire.